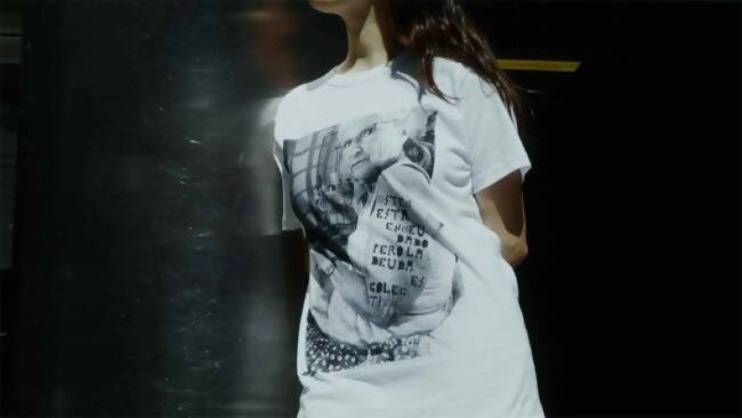Ces artistes, à travers une diversité de médiums, explorent des thématiques telles que la mémoire, l’identité, la culture et les luttes sociales, tout en proposant des réflexions inédites sur les frontières – qu'elles soient culturelles, sociales ou disciplinaires. Leurs créations ouvrent de nouvelles perspectives sur le monde, mettant en évidence l’interconnexion entre l’individu et son environnement. La mise en lumière des 34 lauréats de l’Aide individuelle à la création (AIC) de la DRAC Île-de-France en 2024 révèle une richesse artistique qui interroge les enjeux contemporains.
Une diversité de pratiques au service de questionnements contemporains
Parmi ces voix plurielles, Sharon Alfassi initie une méditation sur l’amour, le désir et l’empowerment féminin en mêlant costumes, films et sculptures. Ses œuvres, oscillent entre pop culture et mythologie, comme en témoigne son court métrage "Question de feeling" et son installation immersive "Gan Eden". Ce questionnement intime trouve un écho chez Cindy Bannani, qui, en interrogeant les ombres d’un passé colonial oublié, réinvente les récits de l’immigration à travers des projets intimistes et collaboratifs – comme dans "Car (si) le soleil n’a pas de patrie".
Entre engagement politique et expérimentations plastiques
Dans une quête de transformation des objets et du quotidien, Charlie Boisson transcende la matière en sculptant des installations aux allures de machines surréalistes, rappelant cette "métamorphose" observée lors d’une promenade au Père-Lachaise. Un procédé qui rappelle la recherche d’authenticité que l’on retrouve aussi chez Julien Bouillon. Cet artiste puise dans l’histoire et la modernité en fusionnant techniques traditionnelles et innovations numériques et s’attache à évoquer l’esprit communautaire de Longo Maï pour repenser le lien entre l’humain et la nature.
Sur un registre plus politique et contemporain, Cloé Brochart interroge les mécanismes de contrôle – de la reconnaissance faciale aux héritages industriels – établissant ainsi un parallèle saisissant avec la performance collective de "The Groom’s Monologue", fruit de la collaboration entre Chloé Charrois, Aurélie Massa et Andréa Le Guellec. Tandis qu’ils déconstruisent les masques sociaux, Anne-James Chaton et Hélène Combal-Weiss transforment les objets du quotidien – qu’il s’agisse de tickets de caisse ou d’objets-relais numériques – en vecteurs d’une poésie engagée, invitant à repenser la mémoire collective et les liens intergénérationnels.
La réflexion sur la technologie et son impact se poursuit avec Agnès de Cayeux de Senaport, qui, en s’inspirant de l’héritage pionnier de Vera Molnár, questionne la vulnérabilité des outils numériques et la pérennité des arts du code. Sur un registre plus personnel, Sirine Fattouh interroge ses souvenirs et l’exil à travers des installations poignantes telles que "Chaises musicales", où l’enfance se fait le théâtre d’une métamorphose cruelle. À l’opposé, Elsa Fauconnet propose une approche ludique et poétique en transformant des téléphones portables en instruments de dialogue avec l’au-delà dans "Appel en absence", brouillant ainsi les frontières entre réalité scientifique et imaginaire féerique.
Mémoire, identité et transformation : une cartographie artistique
L’héritage matériel et les traditions se révèlent avec force dans les pratiques de Garance Früh, qui, en réassemblant objets sportifs et accessoires de puériculture avec la technique ancestrale du boro, interroge la fragilité des identités de genre, tout en rejoignant la critique sociale incisive de Pauline Ghersi – dont les vidéos et performances déconstruisent les dynamiques de pouvoir et d’appartenance. Parallèlement, Jérôme Girard fait vibrer l’espace par le biais du son, mêlant "field recordings" et synthèse analogique pour offrir une écoute renouvelée de notre environnement naturel, alors que Zohreh Haghir Zavareh transforme les objets en personnages théâtraux, rappelant l’importance du récit et du symbolisme dans l’art.
L’expérimentation visuelle se poursuit avec Charlotte Houette, qui réinvente la peinture en y introduisant des mécanismes ludiques et des références aux écrits de Marcel Duchamp ou Niki de Saint Phalle, tandis qu’Ismaël Joffroy mêle cinéma et art contemporain dans une "cinématière" où documentaire et poésie se confondent. La question du déracinement et de l’exil se trouve quant à elle au cœur du travail de Bani Khoshnoudi, dont les installations témoignent de son propre parcours et des cicatrices de l’Histoire, tandis que Jean de Sagazan, en travaillant la matière acrylique, évoque des "machines désirantes" où le sacré et l’éphémère se conjuguent.
Les enjeux environnementaux et la transformation du paysage social s’expriment dans les œuvres de Flavie Lebrun-Taugourdeau, qui réinvente la perception spatiale par des dispositifs sculpturaux, et de Samuel Lecocq, dont les films plongent le spectateur dans des univers post-apocalyptiques où se confrontent violence sociale et urgence climatique. Jérémie Léon documente quant à lui les métamorphoses de nos paysages à travers l’observation sensible des infrastructures énergétiques, offrant ainsi une méditation sur la nature et la modernité.
L’héritage ouvrier et la transmission intergénérationnelle se font le fil conducteur du propos de Pauline Pastry, qui, en collaborant avec son père, revisite les gestes ancestraux du travail, tout comme Pierre Paulin qui, en mêlant mode, écriture et installation, réinterprète l’histoire culturelle du vêtement dans un univers empreint de poésie.
Les interrogations sur l’identité et la mémoire culturelle se poursuivent chez Hatice Pınarbası, dont les peintures – aux signes mystérieux et aux drapés qui débordent – s’inscrivent dans une quête de régénération par l’eau et la tradition kurde, et chez Harilay Rabenjamina, qui, par une mise en scène satirique des codes journalistiques, questionne avec ironie la représentation médiatique. Caroline Saquel et Liv Schulman poursuivent cette réflexion en jouant avec la temporalité et le pouvoir du langage, transformant gestes et images en une chorégraphie sensible, tandis que Louise Siffert et Ana Vega ouvrent de nouveaux espaces narratifs en interrogeant archives féministes et mises en scène immersives, brouillant les frontières entre fiction et réalité.
Manuel Vieillot et Laura Sellies sont deux artistes dont les pratiques explorent les frontières du visible et du récit. Le travail de Manuel Vieillot interroge la matérialité des images et la manière dont elles façonnent nos perceptions. À travers installations et dispositifs immersifs, il joue avec la tension entre réalité et fiction, créant des espaces où le regard se trouble et se réinvente. Laura Sellies, quant à elle, inscrit sa recherche à la croisée du cinéma, de l’installation et de l’écriture. Son approche sensible du temps et de la mémoire transforme ses œuvres en expériences immersives où le langage visuel et sonore dialogue avec l’intime et l’indicible. Son film "Elia", réalisé en 2023 en collaboration avec Bastien Gallet, s’inscrit dans cette démarche. Porté par la présence d’Anne Alvaro, Johnny Rasse et Lucy Railton, il explore les métamorphoses intérieures et la porosité entre l’humain et son environnement.
Enfin, Sergio Verastegui et Alicia Zaton concluent ce panorama en transformant objets et miroirs en talismans et métaphores de la fragilité humaine, invitant le spectateur à une introspection sur les fardeaux invisibles et les reflets déformés de notre identité.
À travers cette fenêtre aux multiples voix et registres, ces lauréats se répondent et se complètent, tissant ensemble une cartographie contemporaine où se croisent mémoire, identité et transformation. Leur démarche collective témoigne d’un art en perpétuel dialogue avec les enjeux sociaux et esthétiques de notre temps, offrant au public une expérience immersive où chaque création ouvre une fenêtre sur de nouveaux possibles.
Si leurs pratiques restent distinctes, elles partagent une même quête : celle de réinventer les formes du récit et d’interroger notre relation aux images et au réel.
Découvrez en images les projets des artistes lauréats de l'AIC 2024 en Île-de-France
Partager la page