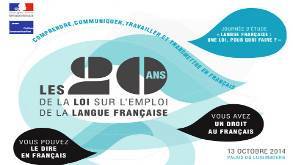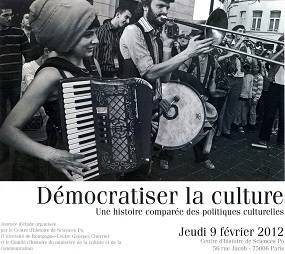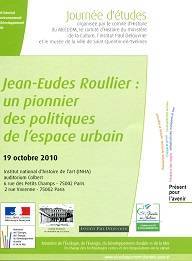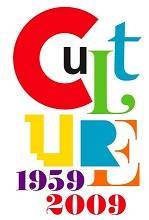2016
Journée d'études organisée en partenariat avec le Comité d'histoire le 15 juillet 2016 en Avignon, cloître Saint-Louis (84000)
Lieu de rencontres et d’échanges privilégiés entre artistes, professionnels de la culture et élus, Avignon s’inscrit dans le paysage des festivals avec une particularité, celle d’être devenu, très peu de temps après sa création, un espace de mise en débat des politiques culturelles. Les rencontres Jean Vilar en sont un événement moteur et central. Elles sont l’un des lieux de construction des politiques culturelles par les sujets qu’elles proposent et les figures qui y prennent la parole. Néanmoins, de nombreux autres lieux de débats se sont développés en Avignon entraînant une dispersion des publics et réduisant l’impact des messages élaborés. Dans un contexte en pleine mutation, tant d’un point de vue de l’organisation territoriale que de la construction des politiques publiques, il est nécessaire de rassembler artistes, professionnels et élus pour remettre en débat, construire une nouvelle pensée et apporter une ambition à la culture.
Le Festival d’Avignon, le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture, et l’Observatoire des politiques culturelles se saisissent du soixante-dixième anniversaire du festival pour organiser le 15 juillet une journée de réflexion et de débats mettant en regard de l’histoire du festival et son influence sur la construction des politiques publiques les perspectives actuelles pour les politiques culturelles.
A cette occasion, le Comité d'histoire réédite en version numérique à la Documentation française La naissance des politiques culturelles et les Rencontres d'Avignon sous la présidence de Jean Vilar (1964-1970) et la Revue de L’Observatoire des Politiques Culturelles consacre un "cahier spécial Avignon" dans son n° 48 (été 2016) avec des textes de Bernard Faivre d'Arcier, Florian Salazar-Martin, Emmanuel Wallon, Michel Debeauvais et un entretien avec Olivier Py.
Programme
(susceptible de modification)
10 h : Ouverture de la journée par Olivier Py, Jean-Pierre Saez et Florian Salazar-Martin
10h15 : Dialogue entre Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du Comité d'histoire et Pascal Ory, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 : Les Rencontres Jean Vilar et leurs rôles dans la construction des politiques culturelles locales
11h 15 : dialogue entre Emmanuel Wallon, professeur de sociologie politique à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et Bernard Faivre d'Arcier, ancien directeur du théâtre et des spectacles, ancien directeur du festival d'Avignon : Les échos du Festival d'Avignon
12h30 - 14h : Pause
14h : Introduction de l'après-midi par Florian Salazar Martin, Vincent Guillon et Jean-Pierre Saez
L'après-midi, chaque thématique fera l'objet d'une discussion entre des élus, des chercheurs, des professionnels, des artistes et des jeunes et la salle
14h15 : Une économie de la culture en mutation : comment en être acteur ?
15h15 : Reconstruire une nouvelle ambition pour la culture ?
16h15 : Arts et culture, des ressources pour se construire et vivre ensemble
17h15 : Conclusion
- [verbatim]
____________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire.
Journée d’étude organisée par l’ENSSIB, la BPI et le Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, le 2 février 2016 à la Bibliothèque publique d’information (75004)
Cette journée d'études s'est inscrite dans la continuité du séminaire "La démocratisation culturelle au fil de l'histoire contemporaine" qui s'est déroulé pendant deux années successives (2012-2014) à l'initiative du Comité d'histoire, en partenariat avec le Centre d'histoire de Sciences Po.
Elle avait pour objet d'interroger ce que le champ du livre et de la lecture peut apporter à l'éclairage de l'histoire des politiques de démocratisation culturelle ; de confronter des approches qui se situent au croisement de l’histoire culturelle (représentations, pratiques, discours et débats publics) et de celle des politiques culturelles ; de réunir spécialistes confirmés et de jeunes chercheurs.
Contexte problématique de la journée d'études
Au regard de l’ensemble des activités de production de biens culturels (artisanales ou industrielles), des marchés et des champs professionnels spécifiques qui les organisent, la place du livre et de la lecture est originale : les logiques industrielles et commerciales de la diffusion de l'imprimé sont, et de loin, antérieures à la problématique plus récente des « industries culturelles ».
Par ailleurs, tout un pan de l'histoire culturelle du livre et de la lecture s'est joué en dehors des politiques publiques. En vrac, pour la période récente : Le Club du Livre, France Loisirs, le Livre de poche, le livre et l'édition à la télévision (émissions littéraires mais aussi présence du livre et des écrivains dans des émissions grand public) ; multiplication des jury littéraires « populaires » : (Prix du livre Inter, des lectrices de Elle, Goncourt des lycées) ; « festivisation » et prolifération des salons et fêtes du livre ; retour de la « lecture » au théâtre, à la radio, ou par le biais des livres-CD...
La place du livre et de la lecture est tout aussi particulière dans l'ordre de l'action publique : elle constitue le socle des politiques d'alphabétisation et de développement de la scolarisation et imposerait, en toute rigueur, d'approfondir l'histoire des formes et de la culture scolaires. En vrac : corpus respectifs du primaire et du secondaire, lecture à haute voix et silencieuse, passage de l'explicitation de texte au commentaire, de la dissertation au résumé, lecture d’œuvres intégrales, étude d’œuvres contemporaines, légitimation par l’institution scolaire de genres considérés auparavant comme « mineurs »...
Comment l'entreprise scolaire républicaine s'est-elle prolongée dans des actions en direction de publics plus larges ? (cf. Discours sur la lecture et Des bibliothèques populaires à la lecture publique et autres travaux de la même veine).
La lecture occupe, enfin, une place spécifique dans les problématiques de démocratisation culturelle particulièrement perceptible lors des constats récurrents sur « baisse de la lecture » dont ceux objectivés par les enquêtes Pratiques culturelles des français, (baisse considérée comme bien plus grave que celle de la fréquentation des théâtres ou des salles de concerts).
Au-delà des généralisations apocalyptiques (qui culminent avec la question de l’illettrisme) il est souhaitable d’analyser plus finement la réception contrastée des résultats de ces enquêtes dans le débat public, au sein des leaders d'opinion, dans le monde intellectuel et celui les professionnels du livre et de la lecture publique.
________
(Ré)écoutez les interventions de la journée d'études
Ouverture
Christine Carrier, directrice de la Bpi, Yves Alix, directeur de l’Enssib et Jean-Sébastien Dupuit, inspecteur général des affaires culturelles, vice-président du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication
La lecture publique dans son contexte.
Présentation, animation : Jean-Claude Pompougnac, correspondant du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication.
- Livres, lecteurs et politiques culturelles à l’école au tournant du XXIe siècle, Max Butlen, maître de conférences honoraire, université de Cergy-Pontoise, ESPE Versailles, Agora.
- Lecture publique et éducation populaire, rencontres et défis communs, Guy Saez, directeur de recherche émérite au CNRS, Pacte, Grenoble et membre du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication.
Travaux récents
Présentation, animation : Thierry Ermakoff, responsable du département des services aux bibliothèques, Enssib.
- Qu’est-ce qu’une bibliothèque de quartier : un espace, une institution, un acteur ?, Denis Merklen, Sociologue, professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle.
- Le plaisir, outil de démocratisation culturelle ?, Charlotte Perrot-Dessaux,doctorante à l’université Paris 7 Diderot.
- Les pratiques adolescentes de la lecture vues à partir des bibliothèques, Cécile Rabot, maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, au pôle Métiers du livre de Saint-Cloud.
Politiques publiques, démocratisation culturelle et « baisse de la lecture » ?
Présentation, animation : Christophe Evans, sociologue, chef du service Études et recherche à la Bpi.
- « Rhétorique de l’échec » et réception des études sur les pratiques culturelles par les professionnels de la lecture publique, Gwenaëlle Cousin-Rossignol,directrice adjointe de la bibliothèque municipale de Versailles.
- Retour sur un moment charnière : le tournant des années 90, Olivier Donnat,sociologue au département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la Communication.
> en écoute sur le site de la Bpi
_____
Bibliographie sélective (2015)
- Bertrand Anne-Marie (avec Martine Burgos, Claude Poissenot et Jean-Marie Privat), Les bibliothèques municipales et leurs publics. Pratiques ordinaires de la culture, Paris, Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou, 2001.
- Bouchareb Hind, « De la bibliothèque populaire à la lecture publique », (in : Des bibliothèques populaires à la lecture publique, sous la dir. d’Agnès Sandras, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2014).
- Butlen Max, Les politiques de lecture et leurs acteurs, Paris, INRP, 2008.
- Cousin-Rossignol Gwenaëlle, les bibliothèques face à l’échec de la démocratisation culturelle, mémoire d’études, enssib, 2014.
- Donnat Olivier, Les pratiques culturelles des Français à l’heure numérique. Enquête 2008, Paris, La Découverte / Ministère de la culture et de la communication, 2010.
- Donnat Olivier, « Les inégalités culturelles. Qu’en pensent les Français ? », Cultures études, 2015-N°4.
- Evans Christophe, « Les publics populaires, aux abonnés absents en bibliothèque ? », Bulletin des bibliothèques de France, 2014-N°1.
- Merklen Denis, Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ?, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2013.
- Perrot-Dessaux Charlotte, « Les bibliothèques populaires argentines, ou quand la promotion de la lecture est prise ne charge par la ‘communauté’ », (in : Des bibliothèques populaires à la lecture publique, sous la dir. D’Agnès Sandras, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2014).
- Perrot-Dessaux Charlotte, Ce que les bibliothécaires disent de leurs quartiers (avec Denis Merklen), Université Paris Diderot, 2010.
- Rabot Cécile, La construction de la visibilité littéraire en bibliothèque, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2015.
- Saez Guy, « Frères ennemis ? Les projets de culture populaire et de démocratisation culturelle (1944-1970) », Bulletin des bibliothèques de France, 2014-N°1.
- Saez Guy (sous la direction, avec Jean-Pierre Saez), Les nouveaux enjeux des politiques culturelles. Dynamiques européennes, Paris, La Découverte 2012.
- Sandras Agnès (sous la direction) Des bibliothèques populaires à la lecture publique, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2014.
2015
Journée d’études organisée par le Comité d'histoire le 17 mars 2015 au Centre d’histoire de Sciences Po (75006 Paris)
2015 : Centenaire de la naissance de Marcel Landowski, musicien, compositeur, premier directeur de la musique nommé par André Malraux en 1966. La politique musicale qu’il met en place a durablement inscrit l’accès de tous à la musique comme objectif de l’action publique.
À l’occasion de cet anniversaire et de la sortie de l’ouvrage « Marcel Landowski. Une politique fondatrice de l’enseignement musical, 1966-1974 » par Noémi Lefebvre, docteur en sciences politiques, le Comité d’histoire a organisé une journée d’études le 17 mars 2015 à Sciences Po afin de mieux faire connaître cette politique fondatrice.
Après une communication qui a décrit la situation en 1966, moment ou Marcel Landowski prend ses fonctions, cette journée s'est attachée à montrer combien la décision de Malraux de créer une direction en vraie grandeur a donné un véritable élan à la politique publique de la musique, qui s’est concrétisé en 1969 par « le Plan de 10 ans ».
Si Marcel Landowski accorde une place essentielle à l’enseignement, il s’attache à développer une politique musicale globale en soutenant la création et la diffusion. En créant l’Orchestre de Paris, il met en œuvre sa politique de soutien aux professionnels. De même, il exige que les œuvres soutenues soient jouées. Dans la dynamique de la décentralisation, il organise les régions musicales autour des conservatoires et des orchestres. Il développe également une politique du lyrique et de la danse. Devenu directeur des affaires culturelles de la ville de Paris (1977-1979), il trouvera là un magnifique terrain d’action.
Une table ronde animée par Maryvonne de Saint Pulgent et réunissant des personnalités ayant œuvré autour de Marcel Landowski, a permis d'évoquer les principaux aspects de cette politique ambitieuse qui nous laisse aujourd’hui des institutions et des procédures fécondes qui ont favorisé le développement des pratiques culturelles des Français.
* * *
PROGRAMME
Journée d’étude le mardi 17 mars 2015 au Centre d’histoire de Sciences Po (56, rue Jacob – 75006 Paris) « Marcel Landowski : l’invention d’une politique musicale » à l’occasion du centenaire de sa naissance.
« La musique fait partie intégrante de l’éducation, car elle est un des éléments de base de la culture humaine. » (Marcel Landowski, 1965)
___
- Matin
9h30 – Ouverture par Michel Decoust, compositeur
Interventions
- La musique sans ministère : les institutions musicales et l’État de la Libération aux années 1960, par Karine Le Bail, chargée de recherches au CNRS (Centre George Simmel, EHESS)
- Un ministère en pleine croissance : que signifie créer une direction ministérielle, par Guy Saez, directeur de recherches au CNRS
Table ronde
La politique musicale au temps de Marcel Landowski, animée par Maryvonne de Saint Pulgent, présidente du Comité d’histoire
Avec Michel Decoust, André Dubost, Hugues Gall, Jean-Claude Casadesus, Jean-Charles François
___
- Après-midi
14h30
Interventions
- Marcel Landowski, la création de la direction de la Musique et la politique d’enseignement et de l'animation musicale, par Noémi Lefebvre, docteur en sciences politiques
- La ville de Paris comme « laboratoire », par Frédéric Poulard, maître de conférences, Lille I
- Les pratiques musicales en France : l’effet Landowski, par Philippe Coulangeon, directeur de recherches au CNRS
___
Informations
Lieu : Centre d’histoire de Sciences Po, 56, rue Jacob, 75006 Paris, salle de conférences (rez-de-chaussée)
Date : 17 mars 2015
Horaires : 9h30 – 18h30
[Le programme] (pdf)
_______
Biographie de Marcel Landowski
Fils du sculpteur Paul Landowski, Marcel Landowski étudie le piano et envisage très tôt le métier de compositeur. Après son baccalauréat, il entre en 1935 au Conservatoire de Paris. Proche du groupe des Six, il est surtout profondément marqué par l’influence d’Arthur Honegger. Il travaille avec le chef d’orchestre Pierre Monteux, et celui-ci crée ses premières œuvres dès 1937. Déjà remarqué avec l’oratorio Rythmes du monde (1939-1941), il connaît un grand succès après guerre, d’abord avec Le Rire de Nils Halerius, légende lyrique et chorégraphique (1948), puis avec les opéras Jean de la Peur (1949) et Le Fou (1956).
Directeur du conservatoire de Boulogne-Billancourt (1960-1964) et directeur de la musique à la Comédie-Française (1961-1965), il est nommé inspecteur de l’enseignement musical en 1964. André Malraux lui confie, en 1966, la direction d’un service de la Musique afin de lancer une politique ambitieuse de démocratisation de la musique.
Premier directeur de la Musique, de l’Art lyrique et de la Danse, Marcel Landowski est à l’origine d’une réforme profonde des structures musicales d’enseignement et de diffusion.
Inspecteur général de la Musique au Ministère de l’Education nationale (1975-1977), Directeur général des Affaires culturelles de la Ville de Paris (1977-1979), Président du Théâtre musical de Paris-Châtelet (1979-1991), il a été Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, où il est entré en 1975, puis Chancelier de l’Institut de France.
Eléments bibliographiques
- Marcel Landowski / Claude Baignères; Préf. de René Nicoly. – Paris : Vantadour, 1959.
- Batailles pour la musique / Marcel Landowski ; à partir d’entretiens avec Edith Walter. – Paris : Editions du Seuil, 1979.
- Commission nationale pour l’étude des problèmes de la musique / G. Picon, R. Siohan, G. Auric, H. Barraud, rapport général 1963-1964, ministère d’ Etat des Affaires Culturelles.
- Situation artistique et sociale du musicien en 1964 / Académie des Beaux-Arts. – Paris : éditions A. & J. Picard & Cie, 1964.
- Marcel Landowski : l’homme et son œuvre / par Antoine Goléa. – Paris : Seghers, cop. 1969.
- La politique musicale de la France, réalités et perspectives. Communication faite à la séance du mercredi 18 février 1981 à l'Académie des Beaux-Arts / par Jacques Charpentier. - Paris : Institut de France, 1981.
- Les perspectives de la musique et du théâtre lyrique en France / Rapport de Daniel Moreau; Avis adopté par le Conseil économique et social, au cours de sa séance du 26 novembre 1980.- Paris : Journal Officiel du 11 février 1981.- (Avis et rapports du Conseil économique et social).
- L' Education musicale en France / [textes réunis par D. Pistone], Paris : Presses de l'université de Paris-Sorbonne, 1983.
- L’orchestre de Paris / préface de Marcel Landowski ; J.-P. Guillard, A. Tubeuf, P.-J. Rémy, … [et al.]. – Paris : Hachette, 1987.
- Marcel Landowski / Ouvrage collectif. – Paris : Editions Salabert, 1992.
- L’Etat, le créateur et le public : 20 ans d’une politique musicale de la création : France 1966-1986 / texte de Daniel Durney, 1993.
- Le Conservatoire : des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique (1795-1995) / Sous la direction d’ Yves Gérard.– Paris : Buchet-Chastel, 1995.
- Marcel Landowski, un anniversaire / Publication éditée par la ville de Boulogne-Bilancourt à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de Marcel Landowski, 1995.
- La création d'une politique musicale en France / Marcel Landowski, in Augustin Girard et Geneviève Gentil (éd.), Les Affaires culturelles au temps d'André Malraux 1959-1969. Journées d'étude des 30 novembre et 1er décembre 1989. - Paris : La Documentation française, Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 1996.
- Rappel historique : la place singulière de la musique dans la politique culturelle à partir des années soixante / Anne Veitl, in Guy Saez (dir.), ''La musique'', Institutions et vies culturelles. – Paris : La Documentation française, 2004.- (Les notices).
___
Une bibliographie détaillée est consultable dans l'ouvrage de Noémi Lefebvre Marcel Landowski : une politique fondatrice de l'enseignement musical, 1966-1974, co-édité par le Cefedem Rhône-Alpes et le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, Cahiers de recherches du Cefedem, 2014, 358 p.- (coll. Enseigner la musique, n° 12).
2014
Journée d'études organisée en partenariat avec le Comité d'histoire le 13 octobre 2014 au Palais du Luxembourg (75006 Paris)
Le 4 août 1994 était adoptée la loi dite "loi Toubon" relative à l’emploi de la langue française qui tirait les conséquences, dans la vie sociale, de la disposition constitutionnelle adoptée deux ans auparavant, aux termes de laquelle « La langue de la République est le français ».
Cette loi garantit en effet à nos concitoyens un « droit au français », en leur permettant, en tant que salarié, consommateur, citoyen ou usager d'un service public, de recevoir une information et de s'exprimer en français, sans pour autant exclure l'usage d'autres langues.
Ce texte joue ainsi un rôle essentiel pour l'égal accès de tous aux savoirs, aux droits et à la culture. Contrairement à certaines idées reçues, il n'a pas vocation à chasser les mots étrangers de notre langue, dans la mesure où il porte sur la présence du français, et non sur son contenu.
La loi du 4 août 1994 a illustré, par-delà les alternances politiques, une volonté commune de maintenir le français comme une dimension essentielle de notre pacte social.
A l'occasion du vingtième anniversaire de la loi, le Comité d'histoire et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ont décidé d'organiser conjointement une journée d'études qui a permis de restituer le contexte dans lequel fut adopté ce texte, les débats qu'il suscita, et de présenter un bilan.
Vincent Dubois (Université de Strasbourg) a proposé une réflexion sur les conditions et les modalités d'élaboration de cette loi. Frédéric Chateigner (Université de Tours) a réalisé une étude sur la réception de la loi dans les médias. Dans son rapport, Bernard Notari (Inspection générale des affaires culturelles), après avoir dressé brièvement le contexte politique, a évalué le degré d'application de la loi en détaillant ses différents champs d'application.
Réunissant les témoignages et les analyses de nombreux responsables impliqués dans l'élaboration ou la mise en œuvre de ce texte, cette journée a évoqué l'écho rencontré par la loi chez nos partenaires européens et francophones. C'est aussi l’occasion de se pencher sur sa pertinence dans un contexte de profondes mutations affectant la transmission et la circulation des savoirs et de l'information.
La ministre de la Culture et de la Communication a clôturé ces travaux, en vue d'en tirer des enseignements pour la politique de la langue française.
______
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire.
2013
Journées d'études organisées par le Comité d'histoire les 23 et 24 janvier 2013 à l'Institut national d'histoire de l'art (75002)
Le Comité d'histoire du ministère a organisé en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (HiCSA) deux journées d'études Autour de la politique du cinéma en France (1945-1970) : enjeux et contextes.
Ces journées d'études avaient vocation à rendre compte des travaux menés dans le cadre d'un chantier de recherche sur la politique du cinéma, et en particulier sur le moment de rattachement du Centre national de la cinématographie au ministère des Affaires culturelles, à la création de ce dernier en 1959.
L’approche privilégiée est celle de l’histoire culturelle, qui cherche, en l’occurrence, à établir des liens entre les aspects administratifs et les dimensions économique, politique, sociale et culturelle de cet objet. Ce « moment 1959 » a donc été, dans un premier temps, envisagé sous ces divers aspects, et, dans un second temps, réintroduit dans une durée plus longue permettant d’envisager les relations entre la mise en œuvre d’une politique du cinéma par les pouvoirs publics et les grands enjeux de la place du cinéma dans la société française des années cinquante et soixante. La création et l’évolution du CNC, le soutien financier au secteur cinématographique, l’apparition des notions de « qualité » et de « patrimoine » et les modalités de leur progressive prise en compte par les pouvoirs publics, les mutations de la culture cinéphilique avec l’essor du mouvement des ciné-clubs, les formes concurrentes d’appropriation du cinéma dans le corps social (exemples des catholiques ou du mouvement communiste) : ces différents éclairages, entre autres, ont permis de mettre en lumière les enjeux et les particularités du « moment 1959 » et de l’évolution de la politique française du cinéma au début de la Ve République.
- [Programme] (pdf)
_________
Les captations audiovisuelles de ces journées d'études sont consultables sur rendez-vous au Comité d'histoire
2012
Journée d'études organisée en collaboration avec le Comité d'histoire le 9 février 2012 au Centre d'histoire de Sciences Po (75006)
Cette journée organisée le 9 février 2012 par le Centre d'histoire contemporaine de Sciences Po, l'Université de Bourgogne-Centre Georges Chevrier et le Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication avait pour objectif d'examiner différentes modalités nationales des politiques publiques visant à démocratiser l'accès à la culture (Espagne, Etats-Unis, Bulgarie, Belgique et Italie). La perspective historique et comparative permet d'éclairer les enjeux du présent.
Participaient à ce rendez-vous :
Anne-Marie Autissier (Institut d'études européennes),
Carla Bodo, (Vice-présidente de l'Association pour l’Économie de la Culture en Italie),
Cécile Doustaly, (Université de Cergy-Pontoise),
Jean-Louis Genard, (Université libre de Bruxelles),
Pascale Laborier, (Université Paris Ouest-Nanterre),
David Looseley, (Université de Leeds),
Laurent Martin, (Centre d'histoire de Sciences Po),
Svetla Moussakova, (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle),
Xavier North, (délégué général à la langue française),
Philippe Poirrier, (professeur des Universités en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne, vice-président du Comité d'histoire),
Maryvonne de Saint Pulgent, (présidente du Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication),
Jean-François Sirinelli, (directeur du Centre d'histoire contemporaine de Sciences Po),
Alexandra Slaby, (Université de Caen),
Jean-Michel Tobelem, (Option Culture)
[Programme] (pdf)
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2010
Journée d'études organisée en partenariat avec le Comité d'histoire le 19 octobre 2010 à l'Institut national d'histoire de l'art (75002)
Journée d'études organisée par le Comité d'histoire du MEEDDM, le Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, l'Institut Paul Delouvrier et le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cette journée a associé un certain nombre de chercheurs qui souhaitaient contribuer à saluer la mémoire d'un homme pour qui la recherche a beaucoup compté, et des témoins, pour la plupart collaborateurs de Jean-Eudes Roullier. Son parcours a été évoqué depuis l'époque de l'Inspection des Finances, jusqu'au Programme d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles en passant par le Secrétariat général des villes nouvelles, la Délégation à la recherche et à l'innovation.
_________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2009
Journée d'études organisée avec le concours du Comité d'histoire le 11 décembre 2009 au Palais du Luxembourg (75006)
Journée d'études organisée par l'Observatoire des politiques culturelles dans le cadre du 20ème anniversaire de sa création et le Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication.
Ce rendez-vous a été l'occasion de réaliser un bilan de 50 ans de partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Ce bilan s'appuie notamment sur l'ouvrage édité par le Comité d'histoire, sous la direction de Philippe Poirrier et René Rizzardo, coordonné par Geneviève Gentil et intitulé Une ambition partagée ? La coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, 1959-2009, (La Documentation française, 2009).
Cette journée a permis également d'interroger l'évolution des politiques culturelles territoriales et leurs perspectives à l'aune de la réforme des collectivités territoriales. Elle avait aussi pour vocation de mettre en valeur les enjeux artistiques et culturels, les enjeux de société, les enjeux politico-institutionnels et la question de leur articulation soulevés tout au long de ce parcours. Comment le 21e siècle relèvera-t-il le défi de la culture ? Quelle pourrait être une politique de développement artistique et culturel durable ?
- [Programme] (pdf)
__________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
Colloque du 50e anniversaire du ministère de la Culture et de la Communication organisé par le Comité d'histoire les 13, 14 et 15 octobre 2009 au Théâtre national de l’Opéra Comique (75002)
"Culture, Politique et Politiques Culturelles"
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du ministère de la Culture et de la Communication, le Comité d’histoire a organisé à Paris les 13, 14 et 15 octobre 2009, au Théâtre National de l’Opéra Comique, un colloque international intitulé « Culture, Politique et Politiques Culturelles ». Il se déroulait sous la présidence scientifique de M. Elie Barnavi, historien, conseiller scientifique auprès du Musée de l'Europe (Bruxelles) et ancien ambassadeur d'Israël en France. Le ministre Frédéric Mitterrand a prononcé le discours d’ouverture.
Les précédents ministres à l'honneur. Ce colloque a présenté les différents modèles de politiques culturelles menées depuis cinquante ans dans différents pays et sur divers continents. Il a permis ainsi d’engager une réflexion sur les grandes missions du ministère de la Culture et de la Communication (relatives au patrimoine, à la création ou aux industries culturelles) au regard de l'expérience des différents pays invités.
Les tables rondes étaient présidées par d’anciens ministres de la Culture : Jack Lang, Jacques Toubon, Jean-Philippe Lecat, Catherine Tasca, Renaud Donnedieu de Vabres ainsi que par Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.
Outre les présidents de sessions, ce colloque a réuni plus de quarante personnalités politiques, intellectuelles, scientifiques et artistiques de vingt nationalités différentes qui ont confronté leurs expériences lors de ces trois jours de débats.
Les tables rondes :
- Les politiques culturelles publiques (13 octobre 2009)
Table ronde 1 : "Les différents modèles de politiques culturelles : un exercice comparatiste"
Table ronde 2 : "La construction de l’Europe suppose-t-elle une politique culturelle commune ?"
Table ronde 3 : "Aide à la création : par qui et comment ?"
- Le patrimoine (14 octobre 2009)
Table ronde 1 : "Le champ du patrimoine a-t-il des limites ?"
Table ronde 2 : "Valeur du patrimoine et développement durable"
Table ronde 3 : "Patrimoine et identités collectives"
Table ronde 4 : "Patrimoine européen, patrimoine méditerranéen"
- Les industries culturelles (15 octobre 2009)
Table ronde 1 : "Les industries culturelles à l’heure des bouleversements technologiques "
Table ronde 2 : "Industries culturelles et diffusion de la création : des relations nécessairement conflictuelles ?"
Table ronde 3 : "La production culturelle entre l’État, l’Europe et la Région"
-----------
- [Programme détaillé] (pdf)
- [Les actes]
L'ouverture du colloque par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication
_________
La captation audiovisuelle de ce colloque est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2008
Journée d'études organisée en partenariat avec le Comité d'histoire le 17 novembre 2008 à l'Institut national d'histoire de l'art (75002)
Cette journée d'études a permis, près de 40 ans après les premiers symposiums d'art public dans les villes nouvelles, à revisiter cette expérience exceptionnelle par son ampleur et sa démarche inédite. Le dernier colloque sur ce thème "l'art renouvelle la ville" datant de 1992, au moment où de nombreuses commandes monumentales étaient en cours de réalisation ou sur le point de s'achever, n'avait pas permis alors d'en faire réellement l'évaluation. La journée d'étude a tenté donc de convoquer tous ceux qui ont participé à cette expérience, et de leur donner la parole, ces derniers ayant sans doute pris assez de recul pour témoigner aujourd'hui.
Le programme s'est appuyé en grande partie sur une trame et un questionnement historiques, notamment sur la question des origines avec les commandes publiques des grands ensembles et l'évolution du 1%. Parallèlement, des intervenants venant de différents horizons ont assuré un éclairage pluridisciplinaire indispensable. Les ethnologues se sont penchés sur les modes d'appropriation de l'art public par les habitants, les historiens de l'art ont tenté de restituer ces réalisations dans une plus ample histoire de la création du XXe siècle.
Les contributions et témoignages se sont articulés autour des origines et de l'état des lieux. Conscientes de leur engagement et de leur responsabilités face à ce patrimoine tant historique qu'artistique après la disparition des EPA (Etablissements publics d'aménagement), les collectivités en assument désormais la prise en charge. C'est ce moment charnière et clef de l'histoire qui a été questionné ici enclenchant par la même des tentatives de patrimonialisation comme à Cergy-Pontoise autour de l'Axe majeur ou à Saint-Quentin-en-Yvelines devenue en 2006 Ville nouvelle d'art et d'histoire.
Si cette journée visait à enrichir et conserver la mémoire, elle s'est ouverte aussi sur le présent et l'avenir. L'héritage des villes nouvelles a été mis en perspective à l'aune de la commande publique aujourd'hui afin d'évaluer les évolutions et les permanences, du point de vue des artistes, des politiques et des habitants.
Au moment où la commande publique semble se redéployer dans les villes autour de grands projets d'aménagement urbain, qu'il s'agisse de l'arrivée de tramways, de requalification de quartiers ou encore de tentative de dialogue avec un patrimoine prestigieux et ancien, il a semblé pertinent de revenir sur l'histoire en tirant les enseignements de l'art public dans les villes nouvelles. Ces dernières ont constitué depuis le début des années 70 de vastes terrains d'expérimentation pour les artistes dont les créations intégraient, sans doute pour la première fois à cette échelle, les logiques urbaines. Source d'inspiration et de contrainte, la ville devenait un laboratoire pour ces recherches formelles. Ce champs à la fois vaste et étroit, en mettant les oeuvres en tension avec le tissu urbain, a incontestablement produit un renouveau de la sculpture et au-delà, des arts plastiques.
Cette journée a été organisée par Loïc Vadelorge (Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et Julie Corteville (Musée de la ville, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), avec la collaboration du Comité d'histoire de ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France et de la Délégation aux arts plastiques.
_____
[Programme] (pdf)
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2006
Journée d'études organisée par le Comité d'histoire le 23 novembre 2006 à l'Institut national d'histoire de l'art (75002)
Organisée à l'occasion du 30e anniversaire de la mort d'André Malraux, cette journée organisée par le Comité d'histoire avait pour but de rappeler quelles furent les actions du ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles dans le domaine de l'architecture et dans celui qui est devenu depuis lors, à part entière, le patrimoine, d'analyser dans l'œuvre de l'écrivain la place qu'occupe l'édifice, le monument, comment la sensibilité malrucienne peut expliquer les orientations de l'homme public.
Des spécialistes se sont employés à analyser la place de l'architecture sacrée dans ses écrits, à décrypter ses discours du Sénat et de l'Assemblée nationale sous l'angle littéraire. L'émergence de la notion de patrimoine du XXe siècle dans les protections au titre des Monuments historiques, l'architecture des maisons de la culture, le développement des secteurs sauvegardés et le ravalement des façades parisiennes, la réforme de l'enseignement de l'architecture, le projet de musée du XXe siècle par Le Corbusier puis Wogensky, l'amitié de Malraux pour Jean Faugeron, autant de sujets qui ont mis en lumière affinités et correspondances entre l'homme, l'écrivain et le ministre.
- [Programme] (pdf)
___________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2004
Journée d'études organisée en collaboration avec le Comité d'histoire le 3 juin 2004 à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (75007)
Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (CHCSC), le Programme interministériel d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises, le Comité d’histoire du ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, ont organisé le 3 juin 2004, à l’École Nationale des Ponts et Chaussées à Paris, une journée d’études sur le thème "L’action culturelle dans les villes nouvelles."
L’histoire de l’action culturelle dans les villes nouvelles - riche à plus d’un titre - témoigne de façon significative de l’évolution des politiques culturelles au cours des trente dernières années.
Les actions expérimentales de “ pré-animation ”, nées à la fin des années soixante dans des lieux très modestes mais grâce à un réseau d’animateurs militants, ont été suivies, dans les années soixante-dix, par une politique de “ grands ” équipements culturels largement inspirés des “ équipements intégrés ”, bientôt relayés par des programmes culturels tantôt communaux, tantôt intercommunaux, parfois concurrents, parfois complémentaires dans l’esprit des nouvelles compétences accordées aux communes par la loi Rocard de 1983.
C’est dire que l’action culturelle dans les villes nouvelles a connu plusieurs moments forts, illustrés par des supports institutionnels différents.
A l’heure où les villes nouvelles rejoignent le droit commun de l’intercommunalité, il est apparu utile de reconstituer cette histoire importante à travers les archives et divers témoignages d’acteurs, et, au-delà, de répondre à certaines interrogations :
- Qu’est-il advenu des actions expérimentales initiales ?
- Dans quelle mesure et dans quels domaines le développement de la vie culturelle doit-il relever de l’initiative communale ou de la solidarité intercommunale ?
- Quelles nouvelles configurations d’acteurs et de partenariats se dessinent-elles aujourd’hui dans les jeunes communautés d’agglomération ?
Autant de questions qui intéressent au premier chef les élus locaux mais aussi les animateurs et professionnels des sphères culturelle, socioculturelle et associative, et enfin les représentants des milieux de recherche et des ministères.
-----------
_________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
2003
Journée d'études organisée avec le concours du Comité d'histoire le 23 mai 2003 à la Bibliothèque nationale de France (75013)
Cette rencontre-débat organisée sur l'initiative de l'Association Amitiés internationales André Malraux (AIAM) avec le concours de l'Inventaire général et du Comité d'histoire du ministère de la Culture a réuni :
- Isabelle BALSAMO, conservateur en chef du patrimoine,
- Augustin GIRARD, président du Comité d'histoire du ministère de la Culture,
- Alexandra KOWALSKI-HODGES, New-York University, EHESS (Paris),
- Xavier LAURENT, chercheur,
- Michel MELOT, chargé de la sous-direction de l'Inventaire,
- Yves MORAUD, président de l'association des Amitiés internationales André Malraux,
- Christian PATTYN, chef de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles,
- Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, directeur de recherche au CNRS,
- Jean-Pierre ZARADER, agrégé de philosophie.
----------
- [L'invitation] (pdf)
- [Programme] (pdf)
- [Les actes]
_________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
Journée d'études organisée par le Comité d'histoire le 25 avril 2003 à l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe)
Cette journée initiée par le Comité d'histoire en collaboration avec l'IMEC à l'Abbaye d'Ardenne a été consacrée à l’histoire de la loi Lang, entrée en vigueur le 1er janvier 1982. Cette rencontre a réuni plusieurs protagonistes et témoins de la bataille du prix unique du livre.
En 2001, Jack Lang résumait les vingt ans de cette loi en ces termes : « Une fois la loi votée, tout ne faisait que commencer. »
Intervenants et participants à la journée d'étude :
Francis BECK, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ancien conseiller technique au cabinet de Jack Lang ministre de la Culture (1981-1984), chargé de mission (1984-1985), directeur de l'administration générale (1985-1986),
Christian BOURGOIS, éditeur, président de l'IMEC,
Olivier CARIGUEL, chargé de mission auprès du président de l'Etablissement public de la Villette, ancien secrétaire scientifique du programme de recherche 1981-1988,
Olivier CORPET, directeur de l'IMEC,
Mireille DELBEQUE, secrétaire générale de l'Institut national du patrimoine, ancien chef du bureau de l'édition et de la diffusion à la DLL (1978-1984),
Jean-Sébastien DUPUIT, directeur de la DLL (1993-2003), ancien conseiller technique au cabinet de François Léotard ministre de la Culture et de la Communication (1986-1988),
André ESSEL, fondateur et ancien président de la Fnac,
Elizabeth GAUTIER-DESVAUX, directrice des Archives départementales des Yvelines, ancienne directrice régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie,
Geneviève GENTIL, secrétaire générale du Comité d'histoire du ministère de la Culture,
Augustin GIRARD, président du Comité d'histoire du ministère de la Culture,
Patrick LAMARQUE, sous-directeur à la Direction des ressources humaines de la Délégation générale à l'armement, ancien membre du cabinet de Jack Lang ministre de la Culture, chargé du livre en 1981,
Jack LANG, député, ancien ministre de la Culture,
Jean-Patrice DE LA LAURENCIE, avocat, ancien conseiller technique au cabinet de Jacques Delors ministre de l 'Economie et des Finances (1981-1986),
Lê Nhat BINH, inspecteur à l'Inspection générale de l'administration du ministère de la Culture, ancien chef du département de l'édition et de l'exportation à la DLL (1982-1985),
Maurice MALINGUE, ancien président de la FFSL,
Jean-Yves MOLLIER, professeur d'histoire contemporaine de l'université de Versailles / Saint-Quentin-en-Yvelines,
Jean-Claude MUET, libraire, président de l'ULF en 1981,
Simone MUSSARD, ancienne directrice du livre de la Fnac (1974-1990),
Rodolphe PESCE, ancien député-maire de Valence et rapporteur de la loi sur le prix unique du livre en 1981,
Bernard PINGAUD, écrivain, ancien membre du Secrétariat national à l'action culturelle du Parti socialiste et président de la Commission du livre et de la lecture (1981-1982),
Hervé RENARD, responsable des études économiques à la DLL,
François ROUET, ingénieur de recherche au département des Etudes et Prospective du ministère de la Culture,
Alain TRAPENARD, président de chambre honoraire à la Cour des comptes, membre du Comité d'histoire.
----------
________
La captation audiovisuelle de cette journée d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
1999
Journées d'étude organisées par le Comité d'histoire les 25 et 26 novembre 1999 au Studio de l'Opéra Bastille (75012)
Placées sous la direction scientifique de Jean-Pierre Rioux et Philippe Poirrier, ces journées d'étude ont été organisées par le Comité d'histoire du ministère de la Culture, avec la Fondation nationale des sciences politiques (Centre d'histoire de l'Europe du XXe siècle), le Centre Georges-Chevrier de l'université de Bourgogne (Institut d'histoire contemporaine) et de la Fondation Maison des sciences de l'homme, Paris.
Ces journées sont nées des travaux de deux groupes de travail du Comité d'histoire "Histoire des politiques culturelles locales" et "Histoire des directions régionales des affaires culturelles". Elles visaient à contribuer à l'histoire de la déconcentration et de la décentralisation dans des domaines d'activité culturelle qui ont fait l'objet de travaux de chercheurs au cours des trois dernières années.
Conformément à la méthode des comités d'histoire, les journées d'étude ont visé, notamment grâce aux tables rondes, à instaurer un dialogue entre historiens et témoins acteurs du domaine culturel considéré.
Quatre thèmes principaux ont été développés tout au long de ce rendez-vous :
- L'implantation du ministère de la Culture en région, séance présidée par Guy Brajot, ancien directeur de l'Administration générale, président du groupe de travail "Histoire de la déconcentration",
- Partenariat avec les collectivités locales, séance présidée par Guy Saez, directeur de recherche au CNRS, CERAT-Grenoble,
- Institutions et territoires, séance présidée par Philippe Poirrier, maître de conférences à l'université de Bourgogne,
- Création et territoires, séance présidée par Jean-Pierre Rioux, vice-président du Comité d'histoire, inspecteur général de l'Education nationale, rédacteur en chef de Vingtième Siècle.
________
1993
Journées d'études organisées par le Comité d'histoire les 7 et 8 décembre 1993 à l'Unesco (75007)
Préparées par le Centre d'histoire de l'Europe du XXe siècle (Fondation nationale des sciences politiques) et organisées par le Comité d'histoire, deux journées d'études se sont tenues les 7 et 8 décembre 1993 sous le titre "Les affaires culturelles au temps de Jacques Duhamel" au cours desquelles quatre thèmes ont été développés avec les interventions de témoins et d'acteurs :
- L'environnement politique et administratif du ministère Jacques Duhamel, 1ère session présidée par René Rémond (président de la Fondation nationale des sciences politiques),
- Une politique "globale" de développement culturel ?, 2e session présidée par Christian Pattyn (chef du service de l'Inspection générale de l'administration au ministère de la Culture),
- La tradition rénovée ?, 3e session présidée par Dominique Ponnau (directeur de l'Ecole du Louvre, ancien conseiller technique de Jacques Duhamel),
- Les avancées de politique culturelle dues au ministère Duhamel, 4e session présidée par Augustin Girard (président du Comité d'histoire du ministère de la Culture).
--------
- [Programme] (pdf)
- [Compte rendu]
- [Les actes]
La captation audiovisuelle de ces journées d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
1989
Journées d'étude organisées à l'occasion du trentième anniversaire du ministère de la Culture les 30 novembre et 1er décembre 1989 à la Bibliothèque nationale (75002)
Ces journées d'études tenues à l'occasion du trentenaire de la création du ministère de la Culture portaient essentiellement sur la période fondatrice, marquée par André Malraux et réunissaient pour la première fois des témoins ou des acteurs de cette période.
Les débats ont été présidés par Pierre Moinot (conseiller technique au cabinet d'André Malraux 1959-1961, directeur général des Arts et des Lettres 1966-1969), André Holleaux (directeur du cabinet d'André Malraux 1962-1965), Jacques Rigaud (directeur du cabinet de Jacques Duhamel 1971-1973), Jacques Renard (directeur du cabinet de Jack Lang 1982-1986).
-------
______
La captation audiovisuelle de ces journées d'étude est consultable sur rendez-vous au Comité d'histoire
Partager la page