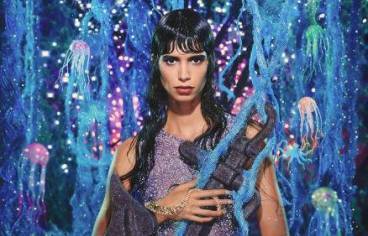Les opérations de fouilles archéologiques qu’il conduit ou qu’il accompagne, avec le soutien du ministère de la Culture, font rayonner la France à travers le monde. C’est le Drassm, qu’il est plus simple d’appeler ainsi, par son acronyme. Quant à son nom, le voici : Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. Il a été créé par André Malraux en 1966, ce qui lui confère le titre de premier service public au monde à avoir été entièrement dédié à l’archéologie sous-marine.
Doté de deux navires de recherche, l’un en Méditerranée, l’autre en Atlantique, et enraciné au berceau de la plongée sous-marine, à savoir Marseille, il est compétent sur tout le littoral français (qui se distribue sur toute la planète), et dédié à l’inventaire, à l’étude scientifique et à la conservation du patrimoine sous-marin.
Il s’est signalé au mois de juin dernier, à la conférence des Nations-Unies sur les Océans, en communiquant à la presse des photos fascinantes, prises à plus de 2500 mètres de fond par un robot de la Marine nationale, annonçant la découverte d’une épave exceptionnelle et de sa cargaison de céramiques parfaitement conservée depuis 450 ans.
Arnaud Schaumasse, directeur du Drassm, revient pour nous sur cet événement.
Racontez-nous cette découverte d’une épave exceptionnelle, et qui a fait, comme on dit, les gros titres : « Camarat 4 »…
C’était au large de Ramatuelle. La Marine nationale, qui développe ses propres outils de maîtrise des grands fonds marins, testait là ses équipements, parce qu’on y trouve très vite de grandes profondeurs. Tout à coup, l’un de leurs drones sous-marins, équipé d’un sonar, a identifié la forme d’une épave. C’était en avril dernier, et elle nous en a informé aussitôt. Nous sommes en dialogue constant, en effet, avec la Marine nationale, la Gendarmerie maritime, les Douanes et les Affaires maritimes au sujet de la protection du patrimoine sous-marin contre le pillage, mais aussi quant à l’identification des épaves. Une fois informés, nous avons aussitôt interrogé la base archéologique Patriarche et nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’épave répertoriée de cette nature dans cette zone.
Il se trouvait que nos amis de la Marine nationale, pour leur propre programme, avaient affrété un robot capable de descendre à 4000 mètres de profondeur. Ils l’ont donc envoyé sur place avec une caméra de haute qualité, qui nous a rapporté trois minutes trente de balayage du site en images couleur. Et c’est ainsi que nous avons pu relever les premiers éléments d’identification de cette épave, la plus profonde connue dans les eaux territoriales françaises.
Et il s’est trouvé également que la conférence des Nations-Unies sur les Océans allait très bientôt se tenir à Nice (9 au 13 juin 2025). Le préfet maritime de la Méditerranée nous a invité à y annoncer cette découverte – qui a stupéfié les journalistes ! Et puis, de surcroît, nous avions à cœur de révéler, puisqu’il s’agissait de la conférence sur les Océans, que le site de l’épave – cela saute aux yeux sur les photographies – est pollué de macro-déchets contemporains. La mer ne digère pas facilement nos plastiques. A 2567 mètres de fond, on trouve encore des canettes de soda, des bouteilles d'eau minérale et des boîtes de gâteaux.
Comment allez-vous procéder, à présent, pour étudier ce site ?
Là où elle se trouve depuis 450 ans, l’épave n’est pas immédiatement en danger. Nous avons donc le temps de bien réfléchir au protocole scientifique et aux coopérations à mettre en œuvre.
Notre navire scientifique, l’Alfred Merlin, est un véritable laboratoire de recherche flottant, conçus par les archéologues, parfaitement adapté. Il est formidable, pour nous, de pouvoir immerger un robot depuis notre bateau, car il lui envoie ses images en temps réel. On peut le diriger ici ou là, en fonction de besoins qu’on identifie sur le moment. Il peut faire des prélèvements dont on dispose presque immédiatement et dans les conditions optimales de préservation des échantillons.
Or nous développons, avec le laboratoire LIRMM de l’université de Montpellier, un programme de robotique totalement dédié à l’archéologie sous-marine, pour travailler de manière précise et rigoureuse au-delà de la zone de plongée humaine – ce qui concerne la plupart des épaves que nous connaissons aujourd’hui. Jusqu’à présent nous disposons de trois robots : les deux premiers descendent respectivement à 150 et 500 mètres. Et depuis 2021, nous en avons un troisième, « Arthur », dont nous sommes très fiers, capable de descendre jusqu’à 2500 mètres, et qui a donné entière satisfaction lors de sa première opération à 1000 mètres de profondeur.
Seulement voilà, Camarat 4 échappe, à une centaine de mètres près, aux capacités d’Arthur… ce qui nous conduit à compter sur l’intérêt de la Marine nationale, par exemple, ou de l’IFREMER, qui sont nos partenaires quotidiens sur ces questions robotiques. C’est la Marine nationale qui a découvert l’épave. Nous savons par ailleurs que, techniquement, nous pouvons embarquer sur l’Alfred Merlin le robot Ariane de l’IFREMER, car nous l’avons testé sur une autre épave au printemps dernier. De plus Ariane pourrait avoir la capacité de plongée qui manque à Arthur. Autant de possibilités à étudier.
Une fois les partenaires trouvés, quel projet scientifique et patrimonial allez-vous mettre sur pieds ?
Il est clair qu'on ne remontera pas cette épave et que, dans l’état actuel de nos capacités techniques, et même à l’horizon des vingt prochaines années, on n’en fera pas non plus une fouille exhaustive. Quelle démarche scientifique, la plus rigoureuse et la plus respectueuse possible du site pouvons-nous définir et entreprendre, voilà notre question.
Nous procéderons par étapes. Un robot adéquat nous permettra tout d’abord de réaliser une couverture photogrammétrique : il prendra plusieurs milliers de photos qui seront digérées par les ordinateurs, pour obtenir un modèle 3D. Cela pourrait être achevé fin 2027.
Les spécialistes pourront alors commencer à étudier de très près cet objet. Il aura aussi valeur de constat d’état, qui pourra être comparé à d'autres numérisations ultérieures, qui permettront de comprendre comment le site évolue.
Que pourra-t-on apprendre de ce modèle 3D ?
Pour l’instant, sans supputation sur ce qui peut demeurer enfoui dans le sédiment au fond de la mer, on observe un tumulus de pichets du XVIe siècle d’origine ligure, intacts. On a vu aussi une centaine d’assiettes empilées soigneusement. On peut ainsi imaginer un naufrage relativement lent qui n’a pas bouleversé la cargaison.
Ensuite, l’idée est aussi de mieux regarder les alentours du tumulus. Identifier d’autres objets qui apparaîtraient sous la couche de sédiment – à l’étape suivante on pourrait tenter d’aller les regarder de plus près. L’idée est aussi de comprendre l’architecture du bateau. Et puis il faut aussi envisager de dépolluer le site.
Ces nouvelles étapes, qui nous font passer à une logique d’intervention, relèvent d’un programme correspondant à notre savoir-faire, sans engager des sommes déraisonnables. Pouvoir, par exemple, dégager délicatement une fine couche de sédiments, au moyen d’aspirateurs et de souffleurs qu’on sait déployer à 800 mètres de profondeur. Il faudra s’adapter à la profondeur de 2500 mètres, sachant que l’impératif est d’agir de manière ni destructive, ni intrusive, pour conserver aux archéologues des générations futures la possibilité de travailler avec une technologie supérieure. Et vu la rapidité des progrès de la robotique, cette responsabilité n’est pas un vain mot.
Vous prélèverez sans doute au moins quelques-uns de ces pichets ?
C’est probable, sachant que ces premiers prélèvements seront très limités. Prélever un pichet de céramique du 16e siècle à 2500 mètres de profondeur, qui est resté là 450 ans, nécessite un travail préparatoire, mené entre autres avec des spécialistes des matériaux du ministère de la Culture, au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH), au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), mais aussi au Musée de la Céramique. Comment se saisir de l’objet, comment le remonter, comment le conserver une fois qu’il est à l’air libre – tous ces premiers gestes doivent être parfaitement maîtrisés, sous peine de le dégrader irrémédiablement. Pour se décider à prélever, il faut donc de sérieuses garanties à tous égards.
Lorsqu’on aura identifié la localisation de la coque du navire, on pourra procéder aussi à de petits prélèvements de bois, à fins de datation et de localisation, car l’un des moyens de connaître l’origine et l’âge d’une épave, c’est d’identifier la forêt d’où vient son matériau, ce qu’on sait faire aujourd’hui, quasiment à la saison près.
Chacun aimerait, naturellement, en savoir plus. Quand pensez-vous pouvoir communiquer publiquement tous les éléments que vous aurez recueillis sur l’histoire de cette épave ?
Il faudra être patient ! Il s’agit d’un travail scientifique, qui va mobiliser plusieurs partenaires et beaucoup de préparatifs techniques. On peut estimer que d’ici la fin de la décennie, on donnera un ou deux rendez-vous au public. Souhaitons que notre travail aura été fructueux !
Mais l’essentiel, encore une fois, c’est de passer aux archéologues qui nous suivrons un maximum de documentation faite proprement et déjà quelques hypothèses prudentes. Aujourd’hui on a une certitude : ces pichets ligures du XVIe siècle. Mais on ignore tout de ce navire. D’où venait-il ? de Gênes...? Impéria ? Ou la Liturie n'était-elle qu'une escale ? Où allait-il ? vers Marseille...? Barcelone...?
Explorer, protéger, étudier et valoriser les archives englouties de l’humanité
Comptant trente-huit personnes dont douze archéologues-plongeurs, deux navires, trois robots et quelques drones, le Drassm est une toute petite équipe lancée à plein régime sur tous les fronts de l’archéologie sous-marine, grâce au ministère de la Culture et à ses partenaires fidèles.
Il est au cœur, en effet, d’un écosystème extrêmement vertueux qui relie de petites structures associatives, des labos du CNRS, des partenariats nationaux et internationaux. Il est présent sur tous les continents, de Taïwan au Mexique en passant par l’Italie, le Maroc, le Sénégal…
Parmi ses chantiers emblématiques, citons la toute première carte archéologique des épaves de l’opération Dynamo (le rapatriement du corps expéditionnaire anglais depuis Dunkerque en juin 1940) ; une épave antique époustouflante au pied du fort de l’île Sainte-Marguerite au large de Cannes (largement médiatisée à cause d’un coup de filet magistral opéré sur les pilleurs d’épave qui détruisaient le site) ; une épave moderne d’une richesse exceptionnelle échouée aux Iles Sanguinaires, à l'entrée du golfe d’Ajaccio ; les épaves de la bataille de la Hougue (défaite navale de Louis XIV contre la marine anglaise) ; une épave antique au large de la Bretagne qui témoigne de la route romaine maritime vers la Grande-Bretagne ; les épaves corsaires au large de Saint-Malo (ce qui fut à l'époque le plus grand chantier archéologique immergé d’Europe, où se forma toute une génération, et qui va nourrir en 2028 un musée maritime édifié par la ville) ; en Guadeloupe la découverte de sites amérindiens aujourd’hui immergés ; en région Auvergne-Rhône-Alpes, en appui de la DRAC, les sites des habitats préhistoriques lacustres (Annecy, Aiguebellette…)…
On le voit, le Drassm est avant tout un service d'instruction administrative des opérations archéologiques sous-marines, préventives ou programmées, mais c’est aussi un acteur de premier plan de la recherche scientifique, de dimension internationale, par ses archéologues passionnés de leur territoire et de leur spécialité.
Partager la page