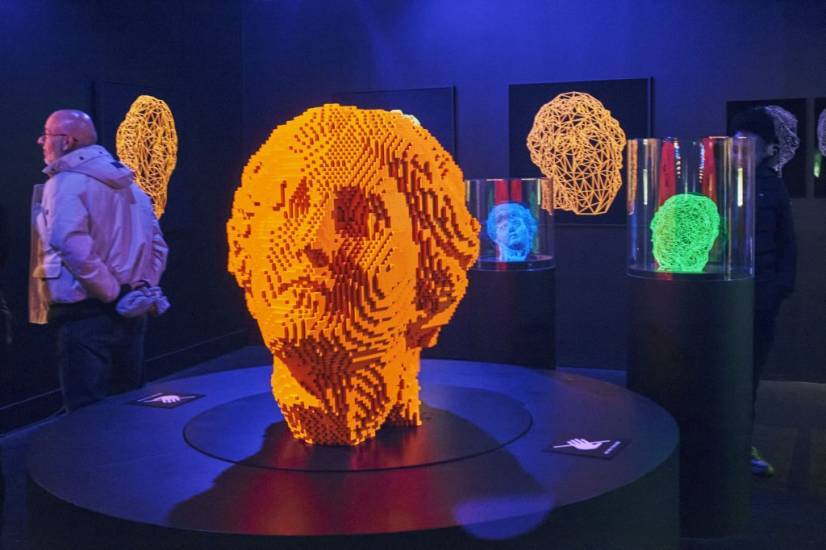En décembre dernier, le ministère de la Culture présentait un plan d’actions pour la liberté de création, de diffusion et de programmation artistiques face à la montée des cas d’atteintes à ces libertés : empêchement d’accès des publics aux œuvres, déprogrammations, actes de vandalisme, menaces et cyberharcèlement contre des artistes… Ce plan se décline en trois axes : structurer la remontée des atteintes, impliquer l’ensemble des parties prenantes dans le respect de la liberté de création et enfin mieux informer les artistes et les professionnels.
C’est pour atteindre ce troisième axe qu’a été conçu un guide juridique et pratique afin d’accompagner les professionnels du secteur culturel, qu’ils soient publics ou privés, confrontés à des atteintes à la liberté de création et de diffusion. Il rappelle, à travers onze cas pratiques qui présentent différentes situations concrètes, le cadre juridique applicable, les réflexes à adopter, les textes et jurisprudences de référence, ainsi que les interlocuteurs à connaître. Ce guide a vocation à leur apporter des réponses étayées et opérationnelles face à des situations parfois ambiguës et délicates. Présentation avec Juliette Mant, nommée haute fonctionnaire pour la liberté de création en mars dernier, dont le rôle est de coordonner les actions politiques en faveur de la liberté de création et de diffusion.
La sortie de ce guide est l'une des mesures annoncées en décembre dernier par la ministre de la Culture dans le cadre du plan pour la liberté de création et de diffusion artistiques. Quel est le sens de cette initiative inédite ?
Juliette Mant : Dans un contexte d’extension des atteintes portées aux libertés de création, de diffusion et de programmation, le ministère a annoncé la mise en œuvre d’un plan spécifique pour la liberté de création. Celui-ci comprend d’une part un volet de structuration de notre action ministérielle en observation et en défense de ces libertés publiques, d’autre part un volet d’information et d’accompagnement des artistes et professionnels, et enfin un volet de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ces enjeux.
Les premiers échanges et différentes actions menées auprès des professionnels victimes d’atteintes et d’entraves font apparaître une réelle méconnaissance des cadres juridiques entourant la liberté de création, son principe comme ses exceptions, ainsi que les voies de recours. Ce guide juridique, rédigé par le Service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général du ministère, en liaison avec la haute fonctionnaire et les directions générales du ministère se veut ainsi une première digue opérationnelle fondamentale : être solide et irréprochable sur l’État de droit et le cadre légal de notre action. Il constitue donc un outil accessible à tous, pour remettre les idées au clair sur les jalons juridiques et esquisser une méthode pour mieux anticiper et réagir en cas de questionnements ou d’atteintes aux libertés de création.
Ce guide se veut à la fois juridique et pratique. Comment a-t-il été conçu, à qui s'adresse-t-il et quel est son objectif ?
J.M. : Ce guide a été conçu par le service des affaires juridiques et internationales en lien avec la haute fonctionnaire à la liberté de création et les directions générales sur la base d’un certain nombre de constats objectivés d’atteintes et d’entraves aux libertés de création, mais aussi de questionnements qui nous sont remontés de la part d’artistes, de réseaux professionnels ou d’élus territoriaux, notamment relativement à des problématiques d’articulation de normes juridiques, d’éthique en matière d’action publique, ou encore de modalités d’actions à entreprendre face à des cas concrets d’entraves ou de menaces.
Il a été conçu dans le cadre de ce premier temps d’observation et de dialogue initié avec les différents professionnels, avec la nécessité de le publier rapidement, face au constat d’une diversification des atteintes à toutes les échelles locales mais aussi d’une amplification des saisines dont le ministère a fait l’objet.
L’objectif de ce guide est donc celui d’un outillage rapide de premier niveau pour les professionnels de la culture, avec une logique de mise à jour régulière, tant à raison des nouveaux enjeux qui nous remonteront, que de spécificités sectorielles à travailler, ou encore d’évolutions jurisprudentielles à venir.
Il sera présenté progressivement aux différents professionnels des secteurs de la création artistique, dans cette perspective à la fois de sensibilisation mais aussi d’enrichissement continu.
Il comporte également 11 fiches pratiques. Y avait-il la volonté d'en faire un outil clair pour accompagner les artistes concernés par des cas d’atteinte à la liberté de création et de diffusion ?
J.M. : Dans le cadre de l’observation menée et du dialogue initié avec un ensemble de professionnels et de parties prenantes, plusieurs grandes typologies d’atteintes ou questionnements d’articulation de normes juridiques (civiles, pénales, administratives) ont émergé. Le guide juridique présente, sur cette base de réflexion, une première partie d’ordre général rappelant le principe et les fondements de la liberté de création, son histoire ainsi que les autres libertés et principes fondamentaux avec lesquels elle doit être conciliée.
La seconde partie propose des fiches ressources, identifiant les différents cas de figure concrets susceptibles de se présenter dans les nombreuses phases de la vie d’un projet artistique. Ces 11 fiches pratiques proposent ainsi à la fois une analyse juridique des situations, des jurisprudences liées aux problématiques, des outils réflexes face à ces situations, ainsi que des bonnes pratiques à mettre en place tant pour prévenir des faits d’atteintes que réagir face à ces situations.
L’enjeu est bien celui d’accompagner les artistes et les professionnels, pour les rassurer, mais aussi pour éviter que ne se développe une autocensure de leur part, qui serait nécessairement préjudiciable à la diversité des propositions artistiques et culturelles dans les territoires, comme à leur vocation par essence émancipatrice.
Vous avez été nommée en mars dernier Haute Fonctionnaire pour la liberté de création. En quoi consiste votre rôle et, hormis ce guide, quelles autres actions allez-vous mener ces prochains mois ?
J.M. : La ministre de la Culture a souhaité un plan ambitieux pour défendre les libertés de création. Celui-ci passe par la structuration de notre organisation ministérielle interne, pour mieux répondre aux difficultés et accompagner les professionnels. La création d’un poste de Haut fonctionnaire dédié, tout comme la désignation de référents dans chacune des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et Directions des affaires culturelles (DAC) répondent à cet objectif de points de contact et d’action dans tous les territoires. Nous sommes déjà à l’œuvre, à travers une mobilisation systématique en accompagnement sur les cas d’atteinte qui nous remontent, mais aussi par une démultiplication des échanges et des temps de sensibilisation avec toutes les parties prenantes de ces enjeux, dans les instances territoriales de dialogue existantes ainsi qu’avec les réseaux professionnels.
Plusieurs outils concrets, au-delà du guide juridique, se mettent en place : une convention pluriannuelle de soutien à l’action de l’Observatoire de la liberté de création a été signée, afin d’accompagner les professionnels par la mise à disposition de ressources et de conseils. Des formations pour l’ensemble des acteurs se mettent en place avec différents partenaires. Des chartes, des plans de sensibilisation, des séminaires sectoriels, des expérimentations territoriales sont en cours de déploiement.
L’enjeu est celui de la démultiplication des approches et des coopérations, pour s’outiller, faire réseau et que la solitude comme les doutes rencontrés par les professionnels de tous niveaux s’estompe au bénéfice d’un dynamisme artistique dans tous les territoires, favorable aux expressions artistiques plurielles et à l’accès de tous les publics à la diversité des œuvres.
Partager la page