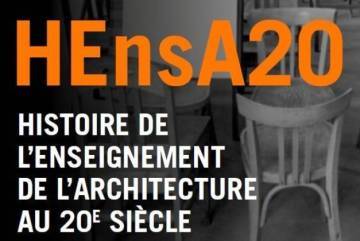1.Panorama de l’histoire de l’enseignement de l’architecture en France
On peut aussi, s’étonner du peu de travaux qu’elle a suscités au regard de l’attraction qu’ont exercée, en Europe et Outre-Atlantique, l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) et l’École polytechnique. Les premiers ouvrages de référence consacrés à l’enseignement de l’architecture au sein de l’École nationale supérieure des beaux arts témoignent néanmoins de son influence : ils ont été réalisés par des historiens anglo-saxons. En 1975, Arthur Drexler et Ann van Zanten présentaient à New York, au Museum of Modern Art, une exposition consacrée à l’enseignement de l’architecture à l’Ecole des beaux arts qui donna naissance, deux ans plus tard, à un fort ouvrage : The Architecture of the Ecole des beaux-arts . En 1978, Robin Middleton consacrait un numéro de la revue Architectural Design aux « Beaux-arts » et, quatre ans plus tard, il édita The Beaux-Arts and nineteenth-century French Architecture .
L’enseignement de l’architecture a, comme l’enseignement supérieur, une structuration particulière : il n’a jamais été dispensé au sein de l’Université mais uniquement au sein d’écoles. Des travaux ont été consacrés aux plus grandes d’entre elles : l’École des beaux arts, comme on l’a vu, l’Ecole polytechnique, embrassée sous tous ses aspects, l’Ecole spéciale d’architecture ou l’Ecole des arts décoratifs . Cependant, la myriade d’établissements qui, des écoles de dessin aux écoles régionales d’architecture, a formé des professionnels qui ont exercé l’architecture en France n’a été que très peu abordée jusqu’ici. On relève des travaux récents comme la thèse de Frédéric Morvan sur l’École gratuite de dessin de Rouen , celle de Malik Chebahi sur l’Ecole des beaux arts d’Alger , ou les recherches de Daniel Le Couédic , Jean-Henri Fabre , Anne-Marie Châtelet et Franck Storne sur certaines écoles régionales d’architecture.
Contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres pays ou d’autres disciplines, l’enseignement de l’architecture en France n’a pas d’abord été orienté vers des besoins professionnels ni dimensionné à ceux-ci. L’évolution vers un enseignement professionnalisant, la décentralisation, la démocratisation puis la massification de l’enseignement de l’architecture furent autant de conquêtes, acquises à partir de la Troisième République, sous la pression d’organisme extérieurs à l’enseignement. La création du diplôme d’architecte, celles des écoles régionales vers 1900, les débats sur le régionalisme esthétique après 1914, la rigidité doctrinale française face aux pédagogies modernes européennes dans les années trente… ne se comprennent que dans cette dynamique de contraintes extérieures forçant petit à petit l’institution à intégrer de nouveaux enjeux et à s’adapter à de nouvelles missions. Les saisir suppose la confrontation des sources propres à l’enseignement de l’architecture à des sources externes nombreuses, diverses et disséminées.
Comme le remarque E. Picard pour l’enseignement supérieur, les services d’archives concernant les établissements d’enseignement de l’architecture sont rares. L’École des beaux arts fait exception, les Archives nationales ayant récupéré ses papiers pour la période qui s’étend de 1793 à 1970. Il s’agit essentiellement de documents produits par l’administration (règlements, listes d’élèves, sujets de concours…). Fonds quantitativement important (122 ml), il a fait l’objet d’un inventaire et, depuis 2006, une équipe de l’Institut national d’histoire de l’art, placée sous la responsabilité de Jean-Philippe Garric et de Marie-Laure Crosnier Leconte, s’est attelée à l’exploitation des registres matricules en vue de constituer une base de données recensant les élèves architectes depuis le début du XIXe siècle jusqu'en 1968 . Cependant, ce fonds ne contient aucun document issu de la pédagogie qui y avait cours. Pour en retrouver des traces, il faut chercher ailleurs. Certains travaux d’élèves (dessins, projets…) sont restés à l’École même, quai Malaquais ; une partie a été numérisée et figure sur le catalogue informatique Cat’zarts . Les cours et notes des enseignants sont disséminés, déposés par les professeurs eux-mêmes ou leur famille soit aux Archives nationales, soit au Centre d’archives d’architecture du XXe siècle, soit encore dans quelque archive départementale. Quant aux autres écoles, les moins connues, tout reste à découvrir. L’exemple de l’École régionale d’architecture Strasbourg montre que les documents conservés n’ont pas encore été versés et que ce qui a trait à leur pédagogie n’a pas été gardé ; du côté des élèves comme des enseignants, c’est auprès des familles et dans les greniers que la quête a été menée.
A la différence de l’histoire de l’enseignement supérieur, l’histoire de l’enseignement de l’architecture a été faite jusqu’ici plutôt de façon « horizontale » que « verticale », par établissement plutôt que par discipline, comme nous l’avons évoqué. Se sont néanmoins développés des travaux portant sur certains enseignements et formes d’enseignement . Les envois des Prix de Rome ont naturellement fasciné ; ils ont été présentés lors de plusieurs expositions, de 1982 à 2002 . Parmi les enseignements, celui de l’histoire a été privilégié comme le montrent la thèse de Simona Talenti, l’ouvrage de Christopher Drew Armstrong sur Julien-David Leroy, le numéro spécial des Livraisons d’histoire de l’architecture et quelques autres articles . L’étude de l’enseignement de la construction a connu un récent développement, fruit de l’engouement que connaît aujourd’hui l’histoire de cette discipline pour laquelle, depuis 1985, six associations ont été créées . Les conditions matérielles et certains outils de la pédagogie ont également été l’objet d’analyses, en particulier les locaux, au premier rang desquels les bâtiments de la rue Bonaparte , les bibliothèques dont celles des ateliers . D’autres sujets témoignent du renouvellement de l’historiographie, comme l’arrivée des femmes dans les écoles d’architecture, la constitution et l’action des associations d’élèves …
Les deux siècles qui se sont écoulés depuis la Révolution ont été très inégalement étudiés. Le XIXe, durant lequel l’enseignement dispensé en France a constitué un modèle pour nombre de pays d’Europe et d’Amérique, a été privilégié. Nous avons cité les travaux fondateurs d’Arthur Drexler et de R. Middleton sur l’École des beaux arts. D’autres sont parus depuis comme ceux de Jacques Lucan, mené sous l’angle de l’analyse d’une notion centrale de sa pédagogie, la composition ; de Jean-Pierre Martinon, centré sur le parcours de ses élèves les plus brillants, les lauréats du Grand Prix de Rome ; d’Annie Jacques , conduit sous la forme d’une anthologie réunissant des témoignages sur sa vie quotidienne …Le XXe siècle a été moins exploré, à l’exception des années qui ont suivi l’effondrement du système universitaire, en mai 1968. Ainsi Jean-Louis Violeau a-t-il analysé l’effervescence qui a précédé ces bouleversements ainsi que leurs conséquences ; Michel Denès les orientations prises par les nouvelles « unités pédagogiques » d’architecture créées à partir de 1969 . Le reste, l’entre-deux guerres et les trente glorieuses, n’a, à de rares exceptions près, suscité aucun intérêt . Comme l’écrivait Bruno Foucart : « Les soixante premières années du XXe siècle feraient volontiers figure, dans l’histoire de l’École nationale supérieure des beaux arts, de désert . »
Partager la page