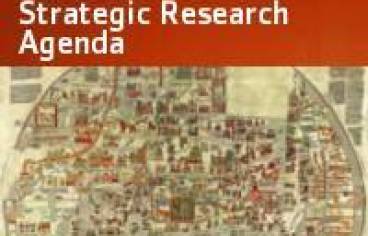Cet appel à projets de recherche transnational pilote a été lancé entre le 10 janvier et le 15 avril 2013. Il a pour but de mettre en œuvre les priorités de recherche communes aux partenaires de l’initiative de programmation conjointe (IPC) "Patrimoine culturel et changement global : un nouveau défi pour l’Europe", priorités identifiées dans l’agenda stratégique de l'IPC.
Il vise aussi à mettre en place les procédures et les bonnes pratiques en vue du lancement de futurs appels à projets de recherche.
Quatre thèmes de recherche étaient proposés
- Les méthodes, les outils et les modèles pour la compréhension des mécanismes de dommages et de dégradations du patrimoine matériel.
- Les matériaux, les technologies et les procédures pour la conservation du patrimoine culturel matériel.
- L’utilisation et la réutilisation des bâtiments et des paysages, y compris la relation entre les changements d’utilisation et les politiques publiques, ainsi que les coûts et la valeur ajoutée.
- Améliorer la compréhension des valeurs culturelles, de l’évaluation, de l’interprétation, de l’éthique et de l’identité entourant toutes les formes de patrimoine culturel (matériel, immatériel et numérique).
La France a participé aux thèmes concernant la préservation matérielle du patrimoine culturel (thèmes 1 et 2) via son Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du patrimoine.
Financement
Le financement de l'appel se fait en mode « pot commun virtuel », sur les fonds propres des organismes de financement volontaires relevant des États membres partenaires de l’IPC. Ainsi, 15 structures de 13 pays financent les projets de recherche sélectionnés : Belgique (2), Chypre, Danemark, Espagne, France, Italie (2), Irlande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Royaume-Uni.
Le budget global est de 3,5 millions d’euros. Les projets de recherche, collaboratifs et transnationaux, sont soutenus pour une durée de 2 à 3 ans.
Résultats de l’appel
89 propositions ont été déposées dont 22 impliquaient des structures françaises. Après évaluation par les pairs au niveau européen, 10 projets ont été sélectionnés et seront soutenus. Les équipes de recherche françaises sont présentes dans 4 d'entre eux, présentés ci-dessous.
Des équipes françaises dans 4 des projets retenus
■ ArCo – Étude de vieillissement des objets archéologiques composites gorgés d’eau
Les musées et les ateliers de conservation mondiaux spécialisés dans le traitement des matières organiques archéologiques sont confrontés depuis ces dernières années à un phénomène de « lèpre » sur les objets composites humides en bois. Les efflorescences qui apparaissent sur des objets après le traitement sont dues à la présence de sels instables. Après le séchage de l'objet et au contact de l'air, ces composés de sels s’oxydent en gonflant et en s’acidifiant de manière catastrophique.
L'exemple le plus représentatif d'un objet attaqué par l’acide est le navire de guerre suédois Vasa (XVIIe siècle) présenté au musée de Stockholm : on évalue approximativement à 2 tonnes la quantité d'acide présente dans tout le bateau. Un autre cas : la collection d’Oseberg, une des collections archéologiques les plus prestigieuses de Norvège, qui a été traitée par des sels d'alun au début des années 1920. Les autres pays européens rencontrent aussi ce problème pour certaines de leurs collections.
Le projet ArCo propose une approche préventive qui consiste à choisir le traitement le plus approprié pour limiter, voire stopper, l'oxydation des sels. Mais quel choix de traitement effectuéparmi ceux, nombreux, proposés par les communautés scientifiques et professionnelles ? La réponse n’est pas évidente car le comportement à long terme de concrétions instables avec les différents agents consolidants utilisés n'est pas encore bien connu. Le projet devrait ainsi permettre de développer des protocoles de caractérisation originaux pour évaluer les traitements disponibles, particulièrement parmi les plus hydrophobes. Il vise également à lister des recommandations pour choisir les traitements les plus pertinents pour les matériaux composites.
Coordonnateur du projet : Hartmut Kutzke (Museum of cultural History, Université d’Oslo)
Partenaire français : Gilles Chaumat (ARC Nucléart)
ARC-Nucléart est un groupement d’intérêt public (GIP) à but culturel créé à l’initiative de plusieurs partenaires, le ministère de la Culture, le CEA, le Conseil régional Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, l’association ProNucléart. Implanté sur le site du centre de recherche du CEA-Grenoble, il a pour mission de répondre aux besoins de préservation d’éléments du patrimoine historique et de conservation des vestiges archéologiques issus des fouilles sub-lacustres . Dans ce but, le GIP mène des projets de recherche destinés à étudier les matériaux dégradés et à développer de nouvelles méthodes de traitement.
------------------------------------------------
■ REDMONEST – Outil dynamique de monitorage dédié aux structures patrimoniales en béton armé
Si les premiers bétons datent de l’époque romaine, le béton tel qu’on le connaît aujourd’hui a été inventé et développé au cours du XIXe siècle, le béton armé n’étant finalement apparu qu’au XXe siècle. Les performances de ce nouveau matériau, armé d’acier, ont conduit non seulement à des développements industriels (production de ciment, brevets sur les systèmes d’armatures…), mais aussi à une créativité architecturale qui justifient aujourd’hui la reconnaissance de la production architecturale de cette période en tant que patrimoine culturel.
Ce patrimoine nécessite des connaissances particulières pour son identification et l’évaluation de son état de conservation, mais aussi des soins spécifiques pour en assurer la restauration, les ciments anciens de cette période étant différents des ciments actuels. Plusieurs mécanismes d’altération peuvent affecter les bétons anciens, notamment la corrosion des armatures quand le béton est armé.
Le projet REDMONEST devrait permettre de développer un outil de gestion « en temps réel », permettant d’évaluer les processus de corrosion de bétons anciens exposés à un vieillissement naturel.
Plusieurs outils de ce type sont disponibles sur le marché, mais ne sont souvent pas compatibles avec les appareils de mesure concernés ; l’interprétation peut donc être délicate. Par ailleurs, il n’existe que peu de systèmes directement dédiés à la durabilité des matériaux et structures.
L’ambition du projet REDMONEST est de développer un nouvel outil de gestion des structures en béton armé, flexible et multifonctionnel, qui sera intégré dans une démarche globale de monitorage, incluant des outils d’analyse de données, un logiciel de diagnostic ainsi que des modèles prévisionnels de durée de vie et d’actions de maintenance à prévoir, l’ensemble étant fondé sur des mesures réalisées in situ en continu.
Coordonnateur du projet : Carmen Andrade (IETCC - El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Espagne)
Partenaire français : Élisabeth Marie-Victoire (LRMH - Laboratoire de recherche des monuments historiques).
-------------------------------------
■ TANGIBLE – Technologies, outils de diagnostic et amélioration de la conservation du patrimoine culturel matériel
L’objectif de ce projet est d'évaluer et de suivre l'état de conservation d’objets du patrimoine culturel de natures différentes, tant en intérieur qu’en extérieur. L’impact des changements environnementaux sera analysé afin d’identifier les paramètres à prendre en compte pour caractériser un risque donné, en vue d'assurer une conservation sûre et une bonne gestion de ces objets.
Le projet propose de développer un système multicapteurs de pointe et hybride (basé sur les technologies 1D, 2D et 3D) qui permettra aux professionnels du patrimoine d’obtenir des solutions non destructives, rapides, fiables et économiquement abordables pour documenter, contrôler et étudier périodiquement l'état de conservation des objets d'art. Le système sera doté d’une alarme qui se déclenchera chaque fois qu'un paramètre d’évaluation de l’état de conservation sera hors norme.
Coordonnateur du projet : Stratos Stylianidis (GeoImaging Ltd, Chypre)
Partenaires français : deux équipes marseillaises : le GAMSAU (équipe de l'UMR 3495 MAP, CNRS-MCC) et le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP).
L’UMR MAP, constituée de quatre équipes, élabore des modèles et des outils de simulation en architecture. L’équipe GAMSAU développe également des projets autour de la numérisation et de la documentation des collections de musée.
Le CICRPmène une politique de recherche en conservation principalement axée sur les phénomènes d'altération des matériaux du patrimoine (peintures, patrimoine bâti, ...).
----------------------------------------------------
De nos jours, différentes techniques complémentaires permettent l’identification des principaux constituants des peintures, aussi bien organiques qu’inorganiques, mais nous disposons de peu d’informations quant à l’interaction de ces différents matériaux entre eux et avec des facteurs extérieurs tels que les traitements de restauration. Cette recherche devrait permettre de développer des méthodes analytiques afin de caractériser les interactions physico-chimiques entre les pigments blanc de plomb et blanc de zinc (deux pigments blancs qui ont été très utilisés et donnent des aspects différents à la peinture) et les molécules présentes dans les différentes catégories de liants organiques.
De nouvelles méthodes analytiques permettant d’obtenir des informations très précises sur les modifications chimiques des composés organiques seront proposées et optimisées pour l’analyse de matériaux du patrimoine. De nouveaux traitements de restauration tels que les nanogels seront également étudiés à l’échelle moléculaire. Le projet inclut l’analyse d’échantillons de valeur inestimable provenant des collections d’Antonietta Gallone (La Cène, Léonard de Vinci), de peintures murales ornant de célèbres monuments (Conseil constitutionnel de Paris, Palais-Royal de Prosper Chabrol) et de peintures de chevalet provenant des collections du musée du Louvre (œuvres de Van Gogh). D’un point de vue économique, ce projet participera au développement d’un nouveau centre de recherche dédié aux sciences et technologies appliquées à l’art et à l’archéologie à Chypre.
Partenaire français coordonnateur du projet : Caroline Tokarski (USR CNRS 3290 MSAP - Miniaturisation pour la synthèse, l'analyse et la protéomique).
Le laboratoire MSAP, unité de service et de recherche CNRS / Lille 1, est reconnu au niveau national et international pour ses développements analytiques liés à la spectrométrie de masse. Les thèmes de recherche associés à cette expertise concernent l’identification de (macro)molécules issues d’échantillons biologiques ou d’œuvres d’art, ainsi que l’élaboration de systèmes microfluidiques pour des études de réactivité en chimie organique et la synthèse de nano-particules. Le partenariat entre cette unité et le C2RMF s’est naturellement développé depuis plus d’une dizaine d’années sur l’analyse des matériaux organiques des œuvres d’art et d’archéologie.
Partager la page