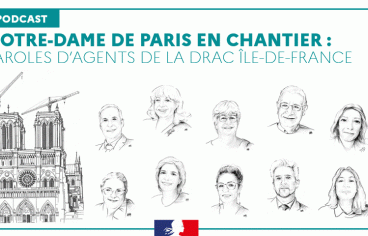Le 15 avril 2019, un spectaculaire incendie frappe la cathédrale Notre-Dame de Paris, marquant durablement les esprits. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Île-de-France, service déconcentré de l’État, alors affectataire du monument, prend immédiatement en charge les travaux de sécurisation et les premières mesures d’urgence. Avec la création, en décembre 2019, de l’Établissement public "Rebâtir Notre-Dame de Paris", chargé de la conservation et de la restauration de l’édifice, le rôle de la DRAC évolue. Elle se concentre sur le contrôle scientifique et technique des travaux de restauration, ainsi que sur les fouilles archéologiques prescrites dans ce cadre.
Parallèlement, la DRAC conserve la pleine responsabilité des objets mobiliers de la cathédrale, assurant leur conservation et pilotant leur restauration, notamment celle des tableaux et des objets du trésor. Depuis plus de cinq ans, les équipes de la DRAC collaborent avec d’autres services de l’État et le ministère de la Culture pour restaurer l’édifice et ses objets, tout en approfondissant les connaissances historiques et scientifiques sur le monument.
Premières missions et sauvegarde des vestiges
Le service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC classe immédiatement les débris comme "vestiges archéologiques" et leur confère le statut de biens mobiliers protégés au titre des monuments historiques. Ces matériaux, récupérés dans des conditions d’urgence et de forte pollution au plomb, constituent une ressource scientifique et patrimoniale unique. Ces gravats incluent des éléments de charpente, de pierre et de métal et sont inventoriés et prélevés selon un protocole scientifique rigoureux. La DRAC, en collaboration avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) et le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), met en place un relevé photogrammétrique en 3D pour documenter précisément chaque élément. Le service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC gère ensuite leur prélèvement et leur conservation, fournissant des témoignages précieux pour les chercheurs et constituant un travail de mémoire patrimoniale. Ces vestiges, découverts lors des travaux ou issus de l’incendie, offrent une perspective inédite sur l’histoire de la cathédrale.
L’incendie a détruit une partie des voûtes, la charpente, la couverture et la flèche de l’édifice. Pendant toute la nuit du drame et les jours suivants, les équipes de la DRAC Île-de-France guident les pompiers, sécurisent les lieux, mettent à l’abri 1 300 œuvres, et entreprennent les premières mesures d’urgence. Un premier état des lieux est réalisé en collaboration avec les pompiers et permet d’identifier les interventions prioritaires pour prévenir toute dégradation supplémentaire.
Ce chantier d’envergure exige et mobilise une coordination complexe entre les services de l’État, la préfecture de région, la préfecture de Police, la Ville de Paris, et le diocèse. Jusqu’en décembre 2019, la DRAC pilote l’ensemble des travaux de sécurisation et de conservation de la cathédrale.
Une mobilisation interministérielle
Les opérations de sécurisation, de sauvegarde des objets, et de traitement des vestiges sont rendues possibles grâce à la collaboration des différents services et opérateurs du ministère de la Culture. Parmi eux figurent la Direction générale des patrimoines et de l’architecture (DGPA), le musée du Louvre, le Mobilier national, le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), et l’Établissement public "Rebâtir Notre-Dame de Paris".
Un protocole scientifique inédit
Face à l’ampleur du chantier, un protocole exceptionnel a été élaboré par le SRA, le LRMH, et le C2RMF. Ce processus a combiné des techniques de photogrammétrie pour des relevés numériques précis en 3D, des méthodes de prélèvement à distance (robots télécommandés, cordistes), ainsi qu’une numérotation et un inventaire rigoureux des éléments collectés.
Ce protocole a permis de localiser chaque vestige, qu’il s’agisse de bois de charpente, de claveaux ou d’éléments métalliques, et d’enrichir les connaissances sur la cathédrale tout en offrant des données précieuses pour sa reconstruction. Tous les vestiges ont été soigneusement prélevés, conservés, et inventoriés.
Quantité et nature des vestiges
Les vestiges collectés comprennent :
10 000 bois provenant de la charpente médiévale, des bras du transept et de la flèche.
650 palettes d’éléments lapidaires, incluant l’arc doubleau effondré de la nef et des éléments de la voûte de la croisée.
350 palettes d’éléments métalliques, comprenant des crêtes de faîtage, des éléments de plomb, des agrafes en fer, et des mécanismes horlogers.
Le traitement des vestiges
Phase 1 : collecte et tri
De fin avril à novembre 2019, puis de janvier 2020 à mars 2021 (avec une interruption liée au Covid-19), la collecte et le tri sont menés en respectant les impératifs de sécurité et les enjeux scientifiques. Des robots télécommandés et des cordistes sont mobilisés pour extraire les vestiges, tandis que toutes les opérations respectent un protocole strict de prévention contre le plomb.
Phase 2 : conservation et inventaire
À partir d’avril 2021, les vestiges sont transférés dans des réserves aménagées par l’Établissement public "Rebâtir Notre-Dame de Paris". Leur traitement comprend quatre étapes : installation, classement, inventaire, et récolement. Depuis 2022, les chercheurs accèdent aux collections pour mener des études approfondies.
Les interventions sur les vestiges contaminés au plomb sont strictement encadrées. Des équipements de protection individuelle sont requis pour tous les intervenants, et les réserves sont aménagées pour limiter tout risque de dissémination. Les chercheurs bénéficient d’une formation spécifique avant d’accéder aux échantillons.
Une contribution à la reconstruction et à la recherche
Les vestiges contribuent à la restauration de la cathédrale. Par exemple, le tri des claveaux de l’arc doubleau effondré a permis un remontage à blanc, offrant de nouvelles perspectives aux architectes. L’analyse des bois de la flèche enrichit les connaissances sur les techniques d’assemblage médiévales.
En parallèle, une convention signée entre la DRAC et le CNRS en 2020, baptisée "Notre-Dame pour la recherche", ouvre la voie à des recherches sur le temps long. Les analyses incluent des études sur la datation des bois, l’analyse des matériaux utilisés et les techniques de construction gothiques, ainsi que l’étude isotopique des éléments métalliques.
Deux collections : patrimoniale et scientifique
Les vestiges collectés alimenteront deux grandes collections : une collection patrimoniale, destinée à des expositions muséographiques (sculptures, assemblages de charpente) et une collection d’étude, préservée par la DRAC pour des recherches futures, incluant des matériaux encore peu étudiés. Ce double usage garantit une valorisation pérenne du patrimoine exceptionnel issu de l’incendie de Notre-Dame de Paris, tout en nourrissant des avancées scientifiques durables.
Depuis l’incendie, la DRAC Île-de-France, en collaboration avec de nombreux partenaires, s'investit pleinement pour restaurer, protéger et mieux comprendre ce joyau du patrimoine mondial. Son action continue d’éclairer les mystères de Notre-Dame tout en préparant l’avenir de ce monument iconique.
Le 8 décembre, le portail de Notre-Dame de Paris s’ouvrira à nouveau au public. L’impressionnant travail de restauration a redonné vie à ce joyau gothique.
Repotages presse
- AFP "Les débris de Notre-Dame, des "vestiges" soigneusement conservés et étudiés"
- France 2 diffusé dans le JT de 20h du 21/11/2024 : "Notre-Dame de Paris : des images inédites des vestiges"
Partager la page