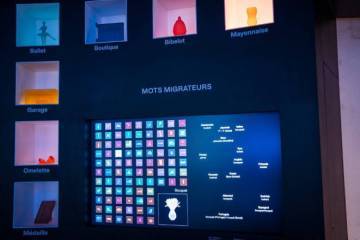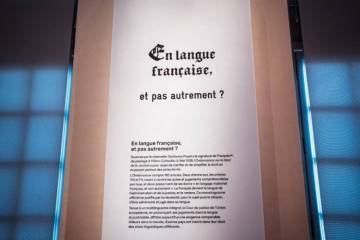Pour tout nouvel arrivant en France, la langue française est l’un des tout premiers liens avec le pays d'accueil. C’est dire l’importance de ce lien, souvent intimidant, toujours fort, aux yeux des nouveaux arrivants. C’est dire aussi l’importance toute particulière donnée au français dans les dispositifs d’accueil prévus à cet effet. Aujourd’hui, ceux-ci sont proposés à l’aune d’une valeur nouvelle dans la relation qui lie le pays d’accueil aux nouveaux arrivants : l’hospitalité.
C’est précisément cette valeur – l’hospitalité – que la table ronde « Traduire ou migrer d’une langue à l’autre » a sondé et interrogé en s’appuyant sur trois initiatives passionnantes : les « Glossaires bilingues de l’administration française, pour une compréhension réciproque » conçus par l’association Maisons de la sagesse – Traduire ; le Dictionnaire des intraduisibles, placé sous le patronage de la philosophe Barbara Cassin, de l’Académie française ; et enfin « Ici, on parle français et… », une initiative lancée par le Campus francophone en Seine-Saint-Denis.
Comprendre l’Autre
Savoir faire avec les différences : quelle formule pourrait mieux résumer la nature exacte de ce qui est, selon Paul de Sinety, délégué général à la langue et aux langues de France au ministère de la Culture, un « magnifique projet d’édition » ? Le propos des « Glossaires bilingues de l’administration française pour une compréhension réciproque », conçus par l’association Maisons de la sagesse – Traduire sous la houlette de Barbara Cassin et Danièle Wozny (lire notre entretien), en partenariat avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Intérieur, la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, les éditions le Robert, la Maison des Sciences de l’Homme et Paris Nord, reprend en effet mot pour mot cette formule, qui a valeur de programme.
Mis à la disposition des différents acteurs de l’accueil (les étrangers y trouvant l’explication de nos usages administratifs, les agents publics celle des usages des pays d’origine de leurs interlocuteurs), ces glossaires, dont trois volumes ont déjà vu le jour (« français-arabe », « français-persan » et « français-soninké ») jouent un rôle essentiel de « passeurs ». « Ils illustrent le rôle que peut jouer la traduction dans l’accueil. Plus précisément, ils sont conçus dans une démarche d’hospitalité inédite combinant science et médiation, savoir savant et urgence sociale », poursuit Paul de Sinety, en soulignant qu’ils incarnent à ce titre « une véritable politique publique linguistique à l’égard des personnes accueillies ». Une démarche qui est aujourd’hui entrée dans sa phase de numérisation afin que le plus grand nombre possible de destinataires puisse s’en saisir.
« Interprètes, policiers, assistantes sociales… toutes ces personnes nous ont aidées à comprendre ce qu’était l’hospitalité », explique Barbara Cassin, en soulignant tout particulièrement le rôle éminent de Carlos Semedo, président de la Maison des langues et des cultures d’Aubervilliers, qui a pris, au démarrage du projet, l’initiative de réunir un vaste panel de représentants de l’accueil. « Tout l’enjeu, ensuite, était de parvenir à faire le grand écart entre les problèmes lourds de traduction et les problèmes concrets ».
La traduction infinie
Un défi comme les aime l’académicienne, elle qui a également mené à bien un fascinant projet au long cours (quinze ans !), le Vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles (Le Seuil / Le Robert, 2002), qui a réuni cent cinquante chercheurs. « Par le mot intraduisible, il faut entendre non pas ce qu’on ne traduit pas mais ce qu’on ne cesse pas de traduire, c’est-à-dire ce qui nous met en face de la différence des langues », précise la philosophe, dont le parti est de montrer la richesse des significations qui naissent de « la pluralité des langues ». « Prenons l’exemple du mot « dette », qui se dit « schuld » en allemand. C’est littéralement la faute, ce qui pèse sur nos épaules, avec tout ce que cela véhicule de culpabilité. On est très loin de la conception latine, dont la signification est plus concrète. Ce n’est qu’un exemple, mais il est très riche d’enseignements sur l’Europe que nous vivons ».
« Ce dictionnaire est emblématique de la dynamique et de la solidarité entre traducteurs contemporains. Outre qu’il constitue une véritable odyssée, c’est un véritable trésor aujourd’hui traduit dans plusieurs langues », ajoute un de ses contributeurs de la première heure, le philosophe, éditeur, traducteur et professeur à l’université de Kiev Constantin Sigov, qui s’apprête à présenter sa traduction en ukrainien à l’occasion du salon du livre de Kiev. Qui dit trésor, dit thesaurus, « le lien entre les deux mots est récent », précise le philosophe qui se félicite de l’apparition « d’une génération thesaurus », celle des jeunes traducteurs. « La traduction invite les autres langues à participer au renouvellement du trésor linguistique de notre langue ». Un point de vue que confirme Barbara Cassin : « On pourrait penser que traduire le Dictionnaire des intraduisibles est un projet absurde, alors que c’est tout le contraire : à travers cette entreprise, nous réinventons d’autres langues ».
En plus d’être au cœur de ce « trésor des langues », le Dictionnaire des intraduisibles fait aussi, ce n’est pas la moindre de ses vertus, « œuvre de paix », ce dont témoigne, aux yeux de Barbara Cassin, le fait que les versions russe et ukrainienne ont été « publiées dans la même maison d’édition ». Aujourd’hui, l’un des nouveaux projets de recherche de la philosophe porte sur les « intraduisibles des trois monothéismes ». Elle propose une lecture comparée des textes sacrés – la Torah, la Bible et le Coran – à partir des langues dans lesquelles ils sont écrits. « Prenons le Coran, dit-elle. Ce sur quoi nous travaillons, c’est la façon dont l’arabe – la langue de révélation du Coran – désigne Dieu ».
« Ici, on parle français et… »
Avec 160 langues parlées, il est difficile de trouver meilleur endroit que la Seine-Saint-Denis pour faire vivre l’hospitalité du français. Une mission à laquelle s’emploie son Campus francophone. Le pacte linguistique signé avec le ministère de la Culture prévoit ainsi la mise en place de résidences d’artistes francophones dans les collèges ou encore la valorisation des compétences linguistiques des habitants lors des Jeux olympiques. Avec notamment une initiative phare, l’opération « Ici, on parle français et… » à travers laquelle les commerçants sont invités à apposer un autocollant reprenant la formule en devanture. « Les commerces de proximité sont l’endroit où la parole se libère le plus facilement, explique Pouria Amirshahi directeur du Campus francophone. L’initiative – inverse de celle qui existe au Québec où un client dans une boutique accepte d’être l’enseignant en français auprès du propriétaire – est née de ce constat ».
Le succès est au rendez-vous. « Cette initiative est un véritable élément d’apaisement », se félicite Pouria Amirshahi, en observant que « les mots reprennent ici leur graphie d’origine, ce qui en soi est déjà un signe d’hospitalité de la part d’une langue ». Le directeur du campus francophone en sait quelque chose, lui qui est d’origine iranienne : « À la maison, on parlait le farsi et le persan. Je traduisais comme je respirais ». De cette expérience, il tire la conviction que, pour une personne, l’important est, plus que de s’exprimer dans un français parfait, de pouvoir formuler « son intention ». Le Campus francophone est peut-être aujourd’hui « le laboratoire le plus avancé de la vitalité de la langue française mais aussi son lieu d’enrichissement le plus dynamique », se félicite-t-il.
Parmi ces initiatives pour rendre la langue « hospitalière », un nouvel acteur a fait son apparition : l’intelligence artificielle (IA). Appelée à jouer un rôle majeur parmi les acteurs de demain de la traduction, l’IA représente-t-elle une menace pour l’écosystème linguistique ? Face à ces enjeux, Barbara Cassin reste sereine. « Il faut rendre l’intelligence artificielle plus intelligente et que l’intelligence artificielle nous rende plus intelligents, dit-elle. Il est, de toute façon, des points de traduction qui ne pourront jamais se passer de l’intervention humaine ». La philosophe fait même un pari : « Et si demain, au lieu d’entraîner l’intelligence artificielle sur la voie des ressemblances et de l’uniformisation, on la conduisait, à partir de données sur les différences entre les langues, sur la voie des intraduisibles ? » Ce pourrait être un premier chantier de travail pour le prochain « Consortium européen dédié aux technologies des langues » dont Paul de Sinety a annoncé le lancement après le Sommet de la francophonie, qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts.
Cycle des tables rondes : questionner une actualité culturelle en pleine évolution
De la parité dans la presse au renouveau du documentaire , en passant par les archives du sport, les chapiteaux de cirque ou les questions actuelles liées à la traduction (voir ci-dessus)… Telles sont quelques-unes des problématiques abordées depuis 2022 par le ministère de la Culture lors d’un cycle passionnant, celui des tables rondes qui lui permettent de questionner sous un angle différent, celui de l’expertise et de l’innovation, une actualité culturelle en pleine évolution.
A travers ce cycle qui fait intervenir des experts de tous les horizons, laissant la parole à celles et ceux qui font, pensent et investissent dans le monde culturel de demain, le ministère de la Culture souhaite avant tout faire connaître les champs multiples de ses politiques publiques dans son aspect le plus concret. De fait, il se place, à travers ces tables rondes, dans une démarche tant de valorisation de l’information que de production de débat d’idées.
Partager la page