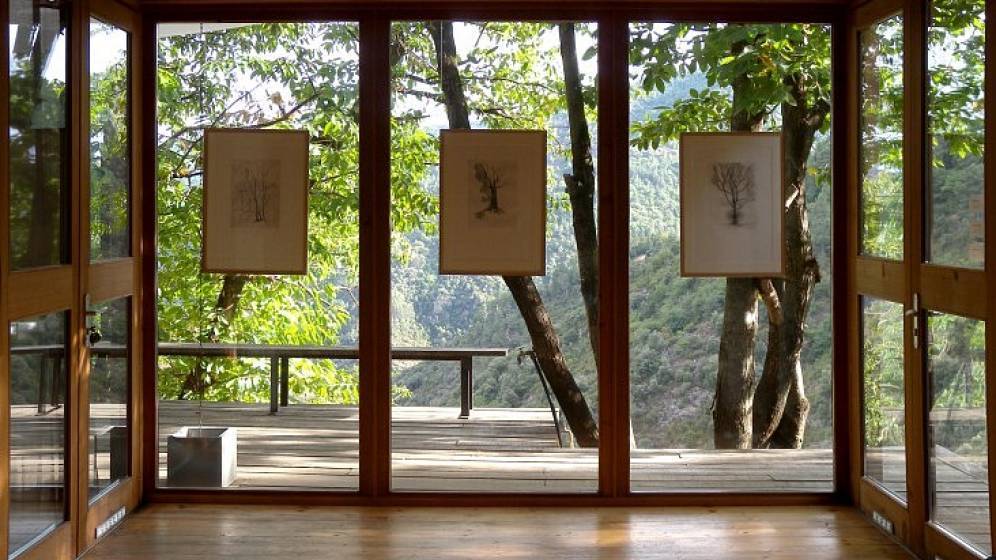Ce sont deux chantiers « stratégiques » pour l’écosystème des musées : l’écoresponsabilité et la ruralité. En matière d’écoresponsabilité, après les initiatives ciblées qui montrent que la révolution verte est partout en marche dans les musées de France, voici venue l’heure de l’approche systémique : sous le pilotage du ministère de la Culture, les professionnels des musées sont en effet en train de poser les fondements d’une norme en matière d’écoconception des expositions.
Même effervescence du côté de la ruralité. Afin de mieux faire connaître ces établissements – qui représentent un quart des musées en France, soit une part substantielle – et leurs collections, un « Guide des musées ruraux », prélude au plan musées ruraux préparé par le Service des musées de France du ministère de la Culture, sera dévoilé le 17 mai, à l’occasion de la Nuit des musées, dans un format numérique, avant une publication à la rentrée 2025 éditée par le Grand Palais - Rmn. Compte-rendu des deux tables rondes organisées lors de l’édition 2025 du Salon international des musées : « Normes et écoconception : quels leviers pour des expositions plus durables ? » et « Les musées en milieu rural, diversité et innovation ».
Une norme « militante » en matière d’écoconception des expositions
« L’écoresponsabilité, cheval de bataille des musées ». Le titre de l’édition du Quotidien de l’art publiée à l’occasion du SITEM annonçait clairement la couleur. Et en effet, les exemples illustrant la révolution verte à l’œuvre dans le secteur muséal fleurissent aux quatre coins du pays. C’est, pour ne citer que quelques exemples, les musées de Compiègne qui, depuis quelques années, réutilisent du matériel scénographique, les musées de la ville de Reims qui allouent un crédit carbone pour les expositions temporaires, ou encore le musée départemental Arles antique qui privilégie des matériaux durables. Des initiatives ciblées, donc, auxquelles il faut maintenant offrir une perspective d’ensemble. « Il reste à concevoir des expositions avec une vision systémique questionnant l’ensemble de la chaîne de conception », relève Gaëlle Crouan, cheffe du bureau de l’expertise architecturale, muséographique et technique au service des musées de France du ministère de la Culture.
Cette perspective, c’est notamment un projet de norme sur l’écoconception des expositions des biens culturels auquel travaillent depuis plusieurs mois cent professionnels des musées réunis par le ministère de la Culture, dont la fédération des concepteurs d’expositions XPO. Une norme ? Le mot, en raison de l’idée de contrainte qu’il véhicule, pouvait « inquiéter » reconnaît David Liot, conservateur général et inspecteur des patrimoines au collège musées de la délégation à l’inspection, à la recherche et à l’innovation du ministère de la Culture et président de la commission qui pilote le projet. Une inquiétude rapidement levée. Car ce projet de norme, réalisé dans le cadre de l’Association française de normalisation (Afnor) qui fournit des lignes directrices et des prescriptions techniques ou qualitatives, est fondée avant tout sur le « volontarisme ». « Il est possible ou non d’y participer », précise Svitlana Grand-Chavin, cheffe de projet normalisation.
Pour connaître l’objet de cette norme, il faut revenir à la présentation, lors de l’édition 2024 du SITEM, du manifeste de l’écoconception des expositions temporaires et permanentes, initié par XPO, qui a marqué les esprits. Des groupes de travail comprenant des professionnels des musées public ou privé (concepteurs d’expositions, scénographes, spécialistes de la conservation préventive, producteurs de contenus numérique, techniciens, éclairagistes...) sont mis en place dans la foulée. « L’idée était d’asseoir autour d’une même table des professionnels en vue de travailler collectivement à la mise en place d’un outil de facilitation », explique Hervé Groscarret, muséographe au musée d’histoire de La-Chaux-de-Fonds. « Il s’agit de proposer un outil simple qui permette à tout le monde de s’y retrouver », acquiesce Fanny Legros, fondatrice de Karbone Prod. Pour tous, selon David Liot, l’ambition de ce projet est claire : il s’agit « d’aboutir, en croisant les apports de toutes les expérimentations de normalisations déjà produites par l’Afnor dans le secteur des musées, à un projet de norme autour d’un ADN partagé par tous les professionnels ».
« Une boîte à outils »
Où en est-on aujourd’hui ? « On dispose de l’ossature de l’ensemble de l’entreprise de normalisation », se réjouit David Liot, en énumérant les différents chapitres du projet : introduction, domaine d’application, termes et définitions, principes généraux de la démarche d’écoconception basée sur le cycle de vie, mise en œuvre de l’écoconception, recommandations, annexes… « Le domaine d’application est un point particulièrement important, souligne Fanny Legros, cette norme n’arrive pas de nulle part, elle s’adosse en effet à une norme d’écoconception qui existe déjà ». Les termes et les définitions sont de même un point sensible (« nous n’avons pas tous le même vocabulaire » ajoute-t-elle) ainsi que les annexes, « qui vont dresser la liste les exemples qui existent déjà ».
Cette norme, Hervé Groscarret la voit en définitive comme « une boîte à outil ». Parmi les enjeux cruciaux, il relève la question du programme muséographique et du projet scénographique. « Nous avons souhaité regrouper sous la même entité la scénographie et la muséographie. Il nous semblait indispensable que la norme fasse la synthèse d’un projet d’exposition, fond et forme réunis ». Le processus de rédaction promet d’être passionnant. La norme pourrait voir le jour dès 2026.
Pleins feux sur les musées ruraux
S’il est aujourd’hui un autre cheval de bataille pour les musées, c’est bien celui de la ruralité. Sait-on que les musées ruraux – au nombre de 363 – représentent plus du quart du nombre de musées en France ? Voilà qui, à n’en pas douter, réjouirait Edmond Groult. Dans le contexte du centenaire de la Révolution française, cet « activiste des musées », comme le définit Bruno Ythier, conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, a été le premier à travailler au développement d’un réseau des musées cantonaux. Aujourd’hui, l’appellation regroupe des réalités variées, avec, selon Bruno Ythier, « des musées ruraux portés par des collectivités rurales et des musées en ruralité portés par des structures de taille variable ».
Il restait à les mettre en lumière. Un chantier sur lequel le service des musées de France, qui s’apprête à publier un « Guide des musées ruraux », est à pied d’œuvre. Le projet a démarré fin 2024 avec le lancement d’un appel à projet qui « a permis à chacun de s’engager sur la base du volontariat », indique Estelle Guille des Buttes, conservatrice en chef du patrimoine, adjointe au sous-directeur de la politique des musées au service des musées de France. En définitive, 150 musées ont été retenus, tous entrant dans les critères de la ruralité établis par l’INSEE. Autres critères, celui de l’équilibre territorial – le bon taux de représentation des territoires ultra-marins est à cet égard à signaler – et de la diversité de typologie des collections. « L’application numérique sera disponible le 17 mai pour la Nuit des musées, la version papier, éditée par Grand Palais-Rmn pour les Journées européennes du patrimoine », promet Estelle Guille des Buttes. Avec un objectif évident : que le guide « dynamise » la fréquentation des musées ruraux.
Partager la page