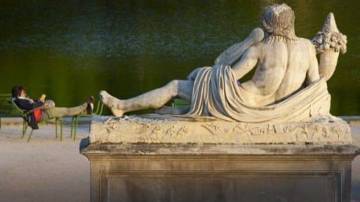Comme chaque année, la 19e édition de Rendez-vous aux jardins, qui va se tenir du 3 au 5 juin, est une occasion privilégiée de découvrir ou redécouvrir les mille et une richesses de notre patrimoine botanique. A cette occasion, plus de 2200 jardins ouvrent leurs portes dont près de 400 à titre exceptionnel ou pour la première fois.
Cette année, le ministère de la Culture a choisi de mettre en lumière une thématique très actuelle : l’impact du changement climatique sur les parcs et les jardins. Sur les 3500 animations proposées sur l’ensemble du territoire, 1500 événements abordent spécifiquement cette thématique et témoignent de la volonté des acteurs des parcs et des jardins de transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire pour accompagner les évolutions, maintenir la biodiversité et préserver les ressources naturelles indispensables au bien-être de l’homme et à l’ensemble du vivant.
Pour évoquer les problématiques du changement climatique et de la transition écologique, nous nous sommes tournés vers deux personnalités du monde des jardins. Entretien croisé avec Isabelle Glais directrice des jardins botaniques du Museum national d’histoire naturelle, et et Floriane Guihaire, cheffe, au sein de la direction du patrimoine architectural et des jardins, du service Jardins du musée du Louvre.
Isabelle Glais, Floriane Guihaire, en quoi les jardins sont-ils généralement affectés par le changement climatique ?
Isabelle Glais : Un jardin se compose principalement d’êtres vivants, qui dépendent de leur biotope, c’est-à-dire du climat et du sol qui leur conviennent. C’est un équilibre fragile où règne aussi une certaine biodiversité. Le dérèglement climatique modifie tous ces rapports et fragilise certains cycles.
Ainsi, les différences de température et les décalages de saison ont certes des effets sur les végétaux, mais aussi sur tout le système vivant qui les entoure. Les « ravageurs », notamment, c’est-à-dire leurs prédateurs, ne sont plus les mêmes, et ce phénomène s’accélère depuis dix ans.
A cela s’ajoute une véritable érosion de la biodiversité. Les équilibres sont modifiés : certaines populations, végétaux, insectes, oiseaux, régressent, d’autres sont invasives. La ressource en eau pose des problèmes et la vie, dans nos sols, s’appauvrit. Les effets en sont très sensibles, particulièrement sur les arbres, car chez eux les changements peuvent être irréversibles. Or les arbres ont pour nous un aspect patrimonial qui rend plus dramatiques encore leurs difficultés.
Floriane Guihaire : On se retrouve ainsi dans des situations préoccupantes. Nous venons de traverser six semaines sans une goutte de pluie : comment faire pour aider les arbres, les fleurs, les arbustes à faire face, tout en maîtrisant notre gestion de l’eau ? L’année dernière, ce fut une très grosse gelée en plein mois d’avril, au moment où les fleurs commencent à sortir. Et puis, en hiver comme en été, arrivent désormais de violentes tempêtes, il faut donc faire en sorte que le public puisse venir en sécurité dans nos jardins.
Doit-on redouter un avenir sombre pour les jardins ?
Isabelle Glais : L’époque est en pleine mutation. On ne sait pas bien où tout cela nous mène ! Ma formation d’ingénieur, personnellement, me porte à adopter une attitude créative : il faut avancer, rechercher des solutions. Nous sommes là pour honorer nos missions, dont l’objectif principal est de transmettre un patrimoine satisfaisant à ceux qui vont nous suivre.
Quels sont, du point de vue du dérèglement climatique, les caractères distinctifs des jardins dont vous avez chacune la responsabilité ?
Floriane Guihaire : Le jardin des Tuileries se situe au cœur de la ville. Au dernier recensement, on a compté 14 millions de visiteurs dans l’année, une fréquentation gigantesque ! Il est traversé de grandes allées, vastes zones de circulation qui peuvent engendrer de la poussière en période de sécheresse. Il se situe par ailleurs dans un véritable couloir de vent, car il est orienté dans le sens des vents dominants. Fréquentation, chaleur, sécheresse et vents se renforcent : en réduire les effets nous conduisent à mieux végétaliser le jardin. Dans cet esprit, il est remarquable que nous nous rapprochons de son état tel que l’avait créé Le Nôtre. Les deux siècles passés, en effet, l’ont lentement minéralisé.
Isabelle Glais : Quant au jardin des Plantes, sa vocation est d’être un jardin scientifique qui conserve et enrichit des collections. Au fond, nous sommes un musée dont les plantes sont les stars ! Et il est clair que ses cinq missions (conservation, diffusion, recherche, enseignement et expertise) nous conduisent à prendre à bras le corps, dans nos jardins différents et nos laboratoires, le sujet du dérèglement climatique. Le Museum joue aussi un rôle très important de sensibilisation du public. S’appuyant sur sa belle devise (Emerveiller pour instruire), il fait la promotion de l’observation : observer le vivant, susciter le désir de savoir et, au-delà, la volonté de s’engager.
Quelles nouvelles dispositions ont été ou vont être prises dans vos jardins respectifs ?
Floriane Guihaire : Le premier de nos grands projets de végétalisation du jardin des Tuileries a été inauguré en 2020, il s’agit du Bosquet des oiseaux, situé au nord du jardin. On y a aménagé des plates-bandes forestières, grandes plates-bandes d’arbustes et de plantes vivaces qui permettent de ramener de la terre et du végétal aux pieds des arbres. La fraîcheur revient, avec les plantes reviennent les insectes et, avec les insectes, les oiseaux. Grâce à la terre, les racines des arbres, qui se trouvaient compactées sous le stabilisé, reçoivent l’eau et évitent le piétinement. Au bout de deux ans, ce coin où la température est douce lorsqu’il fait chaud a conquis bon nombre d’habitués !
Ensuite, nous nous sommes occupés de réduire l’allée centrale qui, du temps de Le Nôtre, était deux fois moins large ! Nous avons donc planté deux alignements d’arbres qui remettent cette allée à l’échelle du jardin, et non plus à l’échelle de la ville (à la façon d’un grand boulevard). Elle réduit notre fameux couloir de vent. Ces 92 arbres ramènent du végétal et deux fois plus d’ombre qu’auparavant entre le Carrousel et la Concorde.
Vous travaillez aussi sur deux autres très beaux projets dans le jardin des Tuileries…
Floriane Guihaire : En effet. D’abord la restauration des bosquets des « Exèdres » (espaces de conversation de plan semi-circulaire), qui comprend la replantation de nouveaux arbres, l’aménagement de plates-bandes végétales, la réfection des bassins et le renouvellement des végétaux du bassin. Le choix de tous ces végétaux demande réflexion. A Paris, les températures sont plus chaudes que dans le reste de l’Ile de France. On est conduit à exclure les plantes qui ont besoin de traverser une période de gel, par exemple, car même s’il arrive qu’on ait du gel, il se produit plus souvent qu’on n’en ait très peu voire pas du tout. Pour les arbres, on raisonne pour des dizaines et même des trentaines d’années à venir. Il nous faut donc, pour les bosquets des Exèdres, des essences susceptibles de faire face à des températures qui pourraient encore augmenter. On a essayé, par exemple, au jardin du Carrousel, le micocoulier, un arbre du centre et du sud de la France qui semble se plaire chez nous. Le savonnier, lui aussi, s’adapte bien au jardin des Tuileries.
Quant au deuxième futur chantier, il s’agit de refaire complètement les rampes du fer à cheval, côté Concorde, proches du bassin de l’Octogone. Elles seront désormais accessibles aux personnes en situation de handicap. Et elles seront végétalisées grâce à de très grandes topiaires, de part et d’autres des rampes. Ces topiaires seront des ifs taillés en pyramides d’environ deux mètres de haut et en boules. Ils seront plantés en pleine terre et entourés de gazon. Là encore, nous retrouverons l’aspect d’origine du dessin de Le Nôtre. Ce qui nous a été confirmé en faisant des sondages qui nous ont permis de retrouver les fosses de plantation initiales !
Et du côté du jardin des Plantes ?
Isabelle Glais : Nous avons, comme le jardin des Tuileries, des chantiers de restauration douce, notamment dans l’allée Cuvier, qui est l’une des trois grandes allées du jardin, dans le sens de la perspective, le long de la ménagerie, plantée de marronniers. Le marronnier est un arbre magnifique qui se développe naturellement dans des stations forestières fraiches et humides. Le réchauffement lui vaut d’être attaqué par un papillon, la mineuse, qui pond ses œufs sur les feuilles, dont les larves, une fois les œufs éclos, se logent dans l’épiderme et y dévorent toute la chair, entraînant des défoliations précoces, et, à terme, l'affaiblissement de l’arbre.
Au fil de ces disparitions, par séquences, nous avons décidé de replanter une collection d’essences très variés, à la fois à fleurs et à fruits, pour attirer les oiseaux. L’ambition est de constituer un véritable arboretum linéaire, idéalement placé en lisière de la ménagerie et de sa végétation, elle-même variée et luxuriante. Trouver là une allée champêtre est très cohérent, puisque ensuite se succèdent trois jardins de formes libres, avec des milieux naturels (le jardin écologique, le jardin école botanique et le jardin alpin).
Le jardin écologique, notamment, se signale comme l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches de Paris, ce qu’un diagnostic de la Ville est venu confirmer récemment. Et je suis moi-même toujours étonnée de voir, sur plus d'un hectare, une faune et une flore incroyables, avec des écureuils et des oiseaux qu’on ne voit nulle part ailleurs. C’est un jardin enthousiasmant, ouvert au public par petits groupes, dessiné dans les années 30, à une époque où se développait la phytosociologie, c’est-à-dire l’étude de la manière dont les plantes s'associent sous un climat et sur un sol donnés. On y trouve une partie où sont reconstitués les massifs forestiers d’Ile de France : une « chênaie-charmaie », association du chêne et du charme, une « ormaie rudérale » (de rudus, ruderis, les décombres : les plantes rudérales poussent dans les espaces délaissés). Dans l’autre partie, on trouve des milieux ouverts : une vigne, une platière de Fontainebleau, différents milieux écologiques où l’étiquette « mauvaise herbe » n’existe pas.
De par ses missions scientifiques et conservatoires, le jardin des Plantes va plus loin encore…
Isabelle Glais : … En passant aussi par ses actions pédagogiques, ou, plus exactement, de « science participative » ! C’est par exemple un protocole nommé « Vigie nature », qui se décline en « Vigie nature école » pour les enfants, où la règle du jeu consiste à relever, sur un espace et dans un temps limités, la nature et le nombre des papillons ou des plantes… Ces données sont recueillies sur un site de science participative et consolidées pour être mises à la disposition des chercheurs.
Quant à la conservation des collections et face aux menaces du réchauffement, nous faisons aussi des récoltes de graines. Notre service de graineterie collecte des graines botaniques mais aussi sauvages, que l’on conserve dans des espaces réfrigérés. Nous disposons du centre horticole de l’arboretum de Versailles Chèvreloup, qui fait 200 hectares, où nous pouvons multiplier végétativement un certain nombre de végétaux menacés.
Nous avons aussi un laboratoire in vitro, où actuellement, par exemple, nous conservons un fragment de plante dans une éprouvette, très sensible, très fragile, un sophora toromiro, qu’on n’a pas encore pu repiquer dans de bonnes conditions. Le sophora toromiro a une histoire extraordinaire : on le croyait totalement disparu de l’Île de Pâques, son milieu d’origine, lorsqu’un chercheur, dans les années 60, en retrouva quelques graines sur le surgeon d’une vieille souche au fond d’un cratère de l’île. Elles furent envoyées à l’époque dans plusieurs laboratoires européens. Nous étions parvenus à le cultiver dans le jardin botanique tropical du Museum (le jardin Val Rahmeh), à Menton. Mais hélas, le réchauffement climatique l’a mis là-bas de nouveau en péril !
Y a-t-il des solutions efficaces pour lutter contre les nouveaux ravageurs ?
Floriane Guihaire : On les recherche et parfois on en trouve, c’est le cas pour la pyrale du buis, qui est apparue il y a une dizaine d’années en France, un véritable désastre pour les jardins historiques, où la plupart des parterres sont en buis ! Cette année, l’hiver ayant été plutôt doux, elle revient beaucoup plus tôt. Il faut surveiller les buis, déceler à temps la présence des œufs de cet autre papillon. Sa larve dévore intégralement les feuilles du buis et le tue sans rémission. Désormais, il est possible de maîtriser à peu près ce nuisible en pulvérisant sur les feuilles, très ponctuellement, une bactérie que la pyrale va ingérer avec la feuille et qui va l’empoisonner. C’est une bonne solution biologique qui a sauvé beaucoup de jardins historiques !
Isabelle Glais : Dans le jardin tropical de Menton, où se trouve une magnifique allée de palmiers, nous devons faire face au charançon, conséquence directe du dérèglement climatique qui affecte tous les palmiers de la côte d’Azur. Pour faire face à des dépérissements importants qui dégradent ce patrimoine précieux, on n’a pas d’autres solutions que d’appliquer des traitements biologiques très onéreux ! Nous travaillons d’arrache-pied avec l’INRAE (’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), en participant à des captures d’insectes et des comptages utiles à l'approfondissent des recherches.
Ces nombreux jardins écologiques et botaniques, ainsi que ces laboratoires, qui ne sont pas toujours bien visibles ni même connus du public, sont nos outils de surveillance, de compréhension et d’adaptation du jardin et de nos collections au dérèglement climatique.
Retrouvez la programmation du jardin des Tuileries, du Muséum national d'histoire naturelle ainsi que celle des lieux qui leur sont associés : jardin du musée Eugène-Delacroix, Arboretum de Versailles Chèvreloup, le jardin botanique Val-Rahmeh, à Menton, le Harmas Jacques-Henri Fabre, à Sérignan du Comtat (Vaucluse) et le jardin botanique alpin « La Jaÿsinia », à Camoëns (Haute-Savoie).
Le château d’Espeyran, entre archives du film et démarche environnementale exemplaire
A Saint-Gilles, dans le Gard, le château d’Espeyran abrite le Centre national du microfilm et de la numérisation, un service rattaché au Service interministériel des archives de France et soutenu par la direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie.
Le château d’Espeyran, c’est aussi un domaine remarquable engagé dans une démarche exemplaire en matière de développement durable, qui va donner lieu en 2022 à la signature d’une convention d’obligations réelles environnementales (ORE), la première dans le secteur public. Cet engagement permettra de sanctuariser la protection environnementale du domaine.
A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2022, le château d’Espeyran accueillera du 3 au 5 juin la deuxième édition de la rencontre des éco-acteurs de la Réserve de biosphère de Camargue, intitulée « Acte#2 : terre nourricière », qui sera marquée le 4 juin par la signature des chartes des nouveaux éco-acteurs.
Un événement à marquer d’une pierre blanche, qui sera accompagné de nombreuses propositions, notamment auprès du jeune public, dans le cadre de Rendez-vous aux jardins : parcours, ateliers, découvertes… A ne manquer sous aucun prétexte.
Partager la page