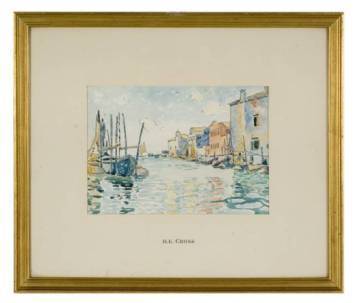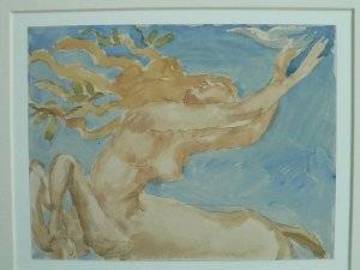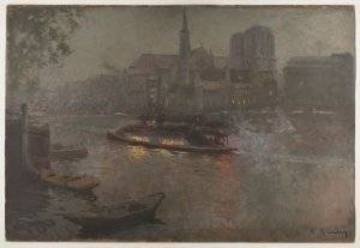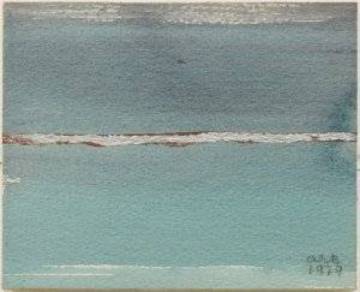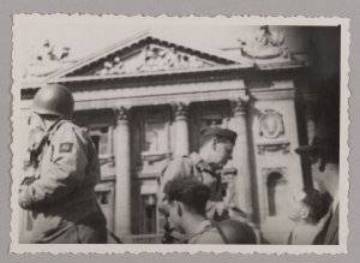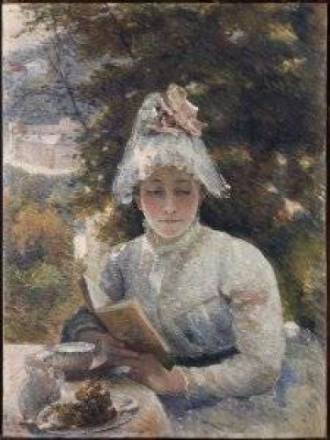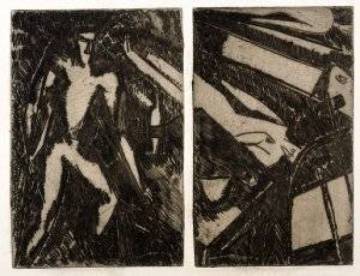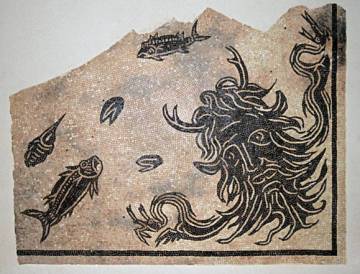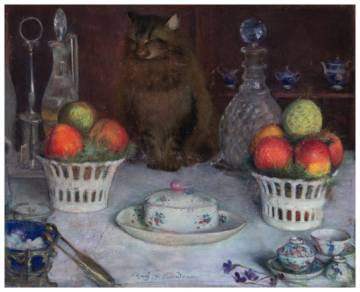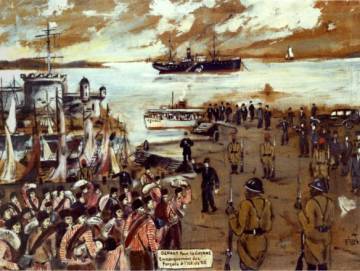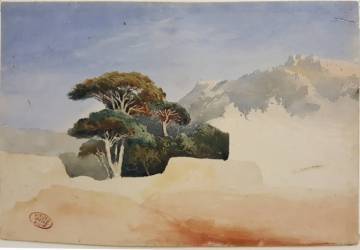Musées du mois
Bourges, musée Estève
Maurice Estève est né en 1904 à Culan, village situé au sud du Cher. Il vit et travaille à Paris durant la majorité de sa carrière, sans jamais perdre son attachement pour le Berry qu’il ne cesse d’évoquer dans ses lettres et ses entretiens. Finalement, en 1995, il s’installe définitivement dans son village natal, où il décède en 2004.
Le début de son parcours est dominé par une impérieuse envie de devenir artiste tout en se confrontant avec les avant-gardes de l’entre-deux-guerres. À partir des années 1950, Estève se tourne vers la non-figuration et il laisse éclater son goût pour la couleur. Son travail est soutenu par des galeries françaises, suisses, allemandes, suédoises, tandis qu’il intègre les plus grands musées du monde, de la Suisse à l’Australie, en passant par le Danemark.
En 1979, Estève expose dans les communs du château d’Ancy-le-Franc. Il apprécie que ses créations « "se battent" avec de solides murs de pierre ». C’est à partir de cette date que germe l’idée de les présenter dans un monument historique. Le projet aboutit en 1985 dans sa région natale avec la donation par l’artiste et son épouse à la Ville de Bourges, pour l’Hôtel des Échevins, d’un ensemble d’œuvres représentatives de son parcours.
Dans le cadre de sa stratégie de refonte muséale, la Ville de Bourges s’est lancée dans une phase de modernisation structurelle et pérenne. La réouverture du musée Estève en juin 2025 après plusieurs mois de travaux concrétise ce déploiement, via une scénographie repensée et l’installation de nouveaux dispositifs de médiation. Cette mutation s'accompagne d‘une migration technique du système de gestion des collections municipales. L’opération a permis une révision scientifique exhaustive des notices, désormais indexées sur l’état le plus récent de la recherche scientifique.
Épernay, musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale
Le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale situé à Epernay (Marne) est implanté dans le Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, construit au milieu du XIXe siècle. Classé au titre des Monuments Historiques, il occupe une place privilégiée sur l’avenue de Champagne, artère prestigieuse de la ville d’Epernay, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, site cœur des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ».
Le musée abrite des collections pluridisciplinaires (paléontologie, Beaux-arts, arts décoratifs, artisanat extra-européen...), comprenant notamment deux fonds principaux : un fonds d’archéologie régionale et un fonds d’ethnologie viti-vinicole.
Le parcours de visite est dédié à l’histoire de la Champagne, de la Préhistoire à nos jours. Il a été pensé en quatre sections qui ont pour fil conducteur le sol crayeux, substrat exploité par les premiers agriculteurs du Néolithique jusqu’aux viticulteurs champenois : collections géologiques régionales, archéologie avec l’une des plus riches collections protohistoriques de France, collections consacrées au vin de Champagne (histoire, élaboration, dimensions sociales) et enfin une séquence consacrée aux collectionneurs de la fin du XIXe siècle et de la Belle Epoque.
Rouvert en 2021 après 23 ans de fermeture, le musée a engagé une politique scientifique ambitieuse, de restauration et d’acquisition des collections, effectuant en parallèle une mise en ligne de ces dernières sur le catalogue collectif des musées de France.
Nérac, musée du château
À l'initiative du maire Armand Fallières (futur président de la République), le musée municipal de Nérac, alors premier musée de Lot-et-Garonne, est créé en 1872. Le musée est destinataire de dons cédés par des érudits néracais et de nombreux dépôts octroyés par les différents services de l'État : le ministère de l'Instruction Publique et les musées nationaux participent à l'enrichissement des collections, qui sont également abondées d’œuvres provenant du Fonds National d’Art Contemporain. En 1934, le musée est transféré dans l’ancien château des Albret, classé Monument Historique depuis 1862. Les collections qui y sont présentées sont très éclectiques (beaux-arts, fonds archéologiques, collections d’histoire naturelle, etc) et le musée, dont la vocation est d’offrir matière aux jeunes artistes tout autant que de donner un lieu de délectation aux néracais, est alors considéré comme un « musée encyclopédique ». Le Château-musée Henri IV porte aujourd’hui l’ambition de valoriser la période Renaissance de l’histoire néracaise à travers un parcours permanent dédié à la famille des Albret et à la figure henricéenne. Un projet de restructuration complet permettra bientôt de redéployer l’ensemble des anciennes collections historiques, qui ont considérablement gagné en visibilité grâce au récolement décennal. Ces dernières seront progressivement mises en ligne, au fur et à mesure de l’avancement de l’informatisation. Afin de valoriser les collaborations muséales, les œuvres conservées à titre de dépôts seront mises à l’honneur dans le cadre de ce premier versement.
Villefranche-sur-Mer, musée d'art et d'histoire
La Citadelle est une forteresse bâtie au XVIème siècle appartenant à la commune de Villefranche-sur-Mer. Elle devient centre d’art et de culture en 1981, après avoir été démilitarisée en 1967 puis classée Monuments Historiques en 1968. Elle possède des collections beaux-arts « Musée de France » allant du XVIème siècle au XXIème siècle : de Christine Boumeester à Henri Goetz, en passant par Jean Cocteau et Ilya Répine, les œuvres du Musée de La Citadelle raconte l’histoire des artistes et des collectionneurs ayant traversé Villefranche-sur-Mer.
Outre ses collections, La Citadelle se veut un centre d’art, offrant un terrain de jeu atypique de plus de 3 hectares aux artistes contemporains invités à investir ses espaces. La Citadelle programme des résidences d’artistes avec le soutien d’institutions publiques et privées.
Le parcours muséal est temporairement fermé depuis janvier 2022 pour rénovation du parcours muséographique et restauration des collections. La programmation d’expositions temporaires continue.
La Citadelle est membre de l’ICOM France, du réseau Plein Sud, et du réseau BOTOXS
A l’occasion du chantier des collections mené par l’équipe du musée depuis 2023, un versement de 33 œuvres sur la base Joconde marque un premier jalon, avec l’objectif de faire de mieux en mieux connaître les collections.
Musées intégrés en 2025
Le musée d’histoire et d’art de Bormes naît en 1926 grâce aux dons d’artistes venus sur le territoire à partir de la fin du XIXème siècle. La collection témoigne directement de la naissance du tourisme balnéaire à Bormes et de l’attractivité des paysages varois chez les peintres de cette période. Fondé par la ville avec l’aide de l’artiste et historien d’art Emmanuel-Charles Bénézit, le musée est dans un premier temps installé dans la mairie. En 1986, le rôle du musée s’affirme comme épicentre de la vie culturelle locale. Il s’installe dans sa bâtisse actuelle du XVIIe siècle qui se trouve aussi être l’ancienne école et maison commune du village. En 2002, la partie beaux-arts de la collection reçoit l’appellation « Musée de France », reconnaissant son intérêt artistique et historique. Réhabilité en 2022, le musée dispose désormais d’espaces d’exposition et d’une réserve garantissant la pérennité des collections. Son parcours permanent immersif présente les 2400 ans d’histoire du territoire, en faisant dialoguer les œuvres exposées avec la réalité augmentée.
Le versement de la collection sur Joconde s’inscrit dans une politique globale de documentation, restauration et valorisation de la collection. L’échantillon sélectionné pour ce premier versement est représentatif de la nature des collections du musée et permet de valoriser le fonds d’origine en le rendant accessible au plus grand nombre. Des versements réguliers viendront compléter progressivement cette sélection.
Informations fournies par le musée (Clara Soumah-Valdman)
Musée d'histoire et de société, riche d'importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée de Normandie présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du Haut Moyen Âge, des mutations de l'espace rural jusqu'aux premiers bouleversements de la société industrielle.
Le musée donne à voir et à comprendre, au fil du temps, les objets et pratiques du quotidien comme les chefs-d’œuvre des arts et traditions populaires, les témoignages des modes de vie ou des constructions de l’esprit.
Le musée a ouvert ses portes en 1963 dans l’enceinte du château de Caen dans une volonté affirmée de la Ville de faire du site médiéval dominant la ville un haut lieu du patrimoine et de l’histoire de la Normandie. Le projet scientifique et culturel du musée se déploie en conséquence du monument et site archéologique, à l’histoire et au patrimoine de la ville, dans l’espace régional et à l’échelle des territoires concernés par l’épopée des « Normands, peuple d’Europe ».
Les versements sur Joconde ciblent prioritairement les acquisitions de l’année en cours, notamment les œuvres ayant bénéficié du FRAM, les restaurations ayant bénéficié du FRAR, les collections présentées dans le parcours permanent ainsi que les biens identifiés comme manquants lors du récolement décennal.
Informations fournies par le musée
Située à quelques encablures du littoral cannois, l’île Sainte-Marguerite (170 ha) est la plus grande des îles de Lérins. Sa nature préservée contraste avec l’austère minéralité du Fort Royal, construit au 17e siècle sur le point culminant de l’île. Outre son importance stratégique, le Fort Royal servit également de prison d’État sous l’Ancien Régime, puis de prison militaire. Le musée du Masque de fer et du Fort Royal, ancien Musée de la Mer, a été créé le 15 novembre 1977 dans un des bâtiments du fort (classé Monument Historique), pour recevoir, étudier et exposer les produits de fouilles de l’archipel.
Il présente ainsi un riche ensemble archéologique provenant des fouilles de l’île Sainte-Marguerite et de ses abords sous-marins, des collections d’art contemporain et abrite également le Mémorial Huguenot. La cellule où l’Homme au masque de fer passa onze années de détention constitue un point fort de la visite du lieu.
Le musée du Masque de fer et du Fort Royal accueille chaque année des expositions de photographes, de grands voyageurs ou d’artistes plasticiens. Ces expositions temporaires font écho aux collections archéologiques déposées par le service régional d’archéologie et le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, aux collections ethnographiques et photographiques anciennes conservées au Musée des explorations du monde (Cannes) et valorisent le patrimoine naturel des îles de Lérins.
Ce premier versement sur Joconde met en valeur les œuvres contemporaines achetées avec le soutien du FRAM (Fonds régional d’acquisition pour les musées).
Informations fournies par le musée
La bibliothèque-musée Inguimbertine de Carpentras est un établissement culturel municipal fondé au milieu du XVIIIe siècle par la volonté d’un prélat éclairé, Malachie d’Inguimbert (1683–1757).
La collection, riche et diversifiée, est composée de livres, d’imprimés et de manuscrits, mais aussi de tableaux, d’objets d’art et de tous supports à même de contribuer à la transmission du savoir. C’est ainsi que l’institution est à la fois bibliothèque municipale classée et musée de France.
En 2009, la Ville de Carpentras engage le transfert de la bibliothèque-musée dans les vastes espaces de l’hôtel-Dieu, ancien hôpital classé monument historique, également fondé par l’évêque d’Inguimbert.
L’Inguimbertine offre désormais au public un parcours d’exposition permanente structuré en trois temps : une présentation de l’histoire du Comtat Venaissin, une immersion dans l’univers d’une bibliothèque-musée des XVIIIe et XIXe siècles, et une section consacrée aux collections de beaux-arts.
La visite se prolonge dans les espaces de lecture publique, où sont exposés des tableaux de peintres paysagistes provençaux des XIXe et XXe siècles, ainsi que plusieurs fonds spécifiques (fonds musical, fonds scientifique).
Le versement dans la base nationale POP des œuvres de l’Inguimbertine relevant de l’appellation « Musée de France » s’inscrit dans une démarche active de valorisation et de diffusion des collections, fidèle à l’idéal de partage des savoirs défendu dès les origines par son fondateur.
Informations fournies par le musée (Jean-Yves Baudouy)
Niché dans une maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, le musée Théodore Calbet dispose d’un ensemble de collections liées à la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Créé en 1938 par Théodore Calbet, ancien instituteur et poète occitan, le musée municipal de Grisolles a pour vocation de conserver et valoriser les objets de la culture régionale. Entre 1941 et 1980, le musée est fermé et le bâtiment se détériore. Il ne sera réouvert qu’en 1988 sous l’impulsion de l'association des Amis du Musée. Depuis 2002, le musée Théodore Calbet ouvre aussi ses espaces à la création contemporaine, invitant des artistes à revisiter les notions de patrimoine et de territoire.
Les collections bénéficient du label « Musée de France » depuis 2003. On y trouve notamment de nombreux artefacts préhistoriques, une tête féminine en marbre blanc du IIe siècle de style « grande Herculanaise », des jouets, des costumes et accessoires de la Belle Époque, des céramiques et ustensiles de la cuisine des XIXe et XXe siècles. Le musée dispose aussi de la reconstitution d'un atelier de fabrication de balais de sorgho dont Grisolles a été un centre important de fabrication à partir de 1856.
Le premier versement sur la base Joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif de sa collection. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires afin de valoriser sa collection et de la rendre accessible au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Le musée ornithologique, propriété de la ville du Blanc dans l’Indre, conserve une collection de plus de 800 oiseaux. Elle fut collectée entre 1824 et 1866 par Jean Mercier Génétoux, notaire à Argenton-sur-Creuse et passionné d'ornithologie. En 1901, ses héritiers procèdent à une donation de l'ensemble des oiseaux à la ville du Blanc qui en devient propriétaire. Le « musée ornithologique » voit le jour. Il est d'abord installé dans les salles de la mairie, puis prend définitivement place dans le château Naillac en 1989 lors de la création de l'écomusée de la Brenne. Au cours de ses premières années d'existence, c'est uniquement sur cette collection que va reposer l'écomusée. Au fur et à mesure des années, les collections s'enrichissent, permettant de mieux comprendre le patrimoine matériel et immatériel du parc naturel régional de la Brenne. La collection ornithologique reste tout de même la plus importante du musée avec 849 oiseaux qui représentent 280 espèces, dont 223 appartiennent à l'avifaune locale. Environ 300 oiseaux sont exposés, mais la majeure partie reste en réserve, c'est pourquoi nous entamons la mise en ligne progressive de cette collection. L'objectif est de rendre accessibles à tous les objets qui dorment dans nos réserves et de diffuser ces collections sans contrainte géographique pour favoriser leur visibilité auprès du grand public et des professionnels.
Informations fournies par le musée
Le musée Nicolas Poussin des Andelys, musée patrimonial d’art et d’histoire, a été créé dans les années 1970. L’écrin qui abrite les collections est une belle demeure datée du XVIIIe siècle, située au Grand-Andely. Cette bâtisse a été donnée à la Ville par le Docteur Giraud, propriétaire de la demeure, médecin-chef de l’hôpital Saint-Jacques des Andelys. Les collections du musée sont diverses et s’étalent chronologiquement de la Préhistoire jusqu’à nos jours. Elles sont centrées sur le patrimoine local : archéologie préhistorique et gallo-romaine ; objets religieux et objets d’art ; statuaire moyenâgeuse ; harmoniums provenant de l’entreprise Dumont et Lelièvre créée en 1877 ; mobilier du XVIIIe ayant appartenu au Duc de Penthièvre qui fut seigneur des Andelys, tableaux du XVIIe siècle dont le fleuron est l’œuvre de Nicolas Poussin (1594 Les Andelys -1665 Rome), « Coriolan supplié par sa famille », peint en 1652 par l’enfant du pays, grand maître du classicisme français ; des tableaux d’artistes régionaux appartenant à l’Ecole de Rouen ; des verreries labellisées « Verlys » issues de l’ancienne fabrique créée, en 1921, par J. Mygatt, homme d’affaire américain ayant racheté le brevet Holophane (du grec, « éclaire tout entier »). Les premiers versements et leur diffusion sur Joconde offrent l’opportunité de faire connaître les collections du musée Nicolas Poussin à un large public et contribuent à la volonté municipale d’offrir plus de visibilité à l’institution.
Informations fournies par Françoise Baron-Miseroux, responsable du musée Nicolas Poussin
Créé en 1885 par le sénateur-maire Lucien Guillemaut, le Musée municipal de Louhans se tenait autrefois « Rue du Musée », aujourd’hui « Rue Lucien Guillemaut ». Il est transformé en salle de classe durant la guerre de 1914-1918. C’est à la Société des Amis des Arts et à Joseph Maublanc que le musée doit sa réouverture en 1929. Mis à mal pendant la Seconde Guerre mondiale, il est de nouveau ouvert au public en 1945. En 1961, le musée qui a du mal à fonctionner est fermé. Le musée est réinstallé en 1990 sur deux niveaux, dans un bâtiment municipal réaménagé rue des Dôdanes, qu’il partage avec une des antennes de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne : l’imprimerie du Journal L’Indépendant.
Les collections bénéficient du label « Musée de France » depuis 2003 et, selon une convention signée avec la municipalité, leur gestion scientifique est gérée par l'Écomusée de la Bresse bourguignonne. La collection s’illustre à travers deux dynamiques : la présentation d’artiste locaux témoignant de l’activité artistique locale et un fond de beaux-arts destiné à diffuser l’histoire de l’art dans les territoires ruraux.
Le musée municipal a réuni au fil des acquisitions et des dons un fonds riche et pluridisciplinaire. Il compte, aujourd’hui, des œuvres de grands noms du monde de l’art. Par ce versement, le musée souhaite partager et faire connaître sa collection au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Créé en 1946 au sein de l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN), le musée de l’institution est d’abord destiné à l’instruction morale des élèves-officiers. Plus qu’une salle de tradition, l’espace de 150 m² abrite une collection qui s’enrichit au fil des années grâce aux dons des gendarmes ou de leurs familles. A partir des années 1980, et malgré la configuration confidentielle et restreinte de la caserne, des visites sont proposées aux groupes de gendarmes ou d’anciens gendarmes et parfois au grand public lors de journées portes ouvertes. Face à une collection grandissante et un besoin d'espace de plus en plus important, le musée de la Gendarmerie nationale prend place en 2015 dans un ancien bâtiment de caserne entièrement rénové dans une optique d’ouverture à tous les publics.
Seul musée de la gendarmerie en France, sa collection a été reconnue d’intérêt patrimonial avec l’obtention de l'appellation « Musée de France » en 2011. Le musée a vocation à mettre en valeur un patrimoine unique organisé autour de la plus grande vitrine suspendue d’Europe. L’exposition permanente met en lumière l’histoire de la gendarmerie à travers l’histoire de France, dans un parcours permanent de 1 200 m² où sont exposés environ 2 000 objets sur les 20 000 que comprend la collection. Le versement sur Joconde s’inscrit dans une démarche de diffusion des collections afin que la richesse et la diversité du patrimoine de la gendarmerie soient portées à la connaissance de tous les publics.
Informations fournies par le musée
Installé dans une élégante gentilhommière du XVIIIe siècle, au cœur du parc de la Corbillière, le musée est un lieu chargé d’histoire. Créé dans les années 1960 par des bénévoles passionnés, il est aujourd’hui géré par la commune de Mer et a obtenu l’appellation « musée de France » en 2003.
Sa collection, riche de quelque 2 600 objets, est liée à l’histoire locale du 19ème et du 20ème siècle : ethnologie, archéologie, beaux-arts ou arts décoratifs : chaque objet témoigne du patrimoine de Mer et de son territoire.
Trois artistes majeurs occupent une place centrale dans le parcours permanent :
• Pierre Loison (1816-1886) sculpteur mérois formé à Paris, auteur de commandes officielles pour le Louvre ou l’Opéra de Paris
• Alexandre Bigot (1862-1927) figure majeure du mouvement Art Nouveau et précurseur dans le domaine de la céramique architecturale
• John Storrs (1885-1956) sculpteur américain Art Déco qui partagea sa vie entre Chicago et Mer
Chaque année, le musée propose plusieurs expositions temporaires, mettant en valeur la création contemporaine.
La mise en ligne progressive de la collection sur la base nationale Joconde s’inscrit dans une démarche globale de documentation, de conservation et de valorisation du patrimoine. Le premier ensemble versé offre un aperçu représentatif des collections présentées au public. Il sera progressivement complété par des objets issus des réserves, permettant ainsi de mieux faire connaître la richesse et la diversité des fonds conservés.
Informations fournies par le musée
Le musée de l’histoire du Perche, logé au cœur du château des Comtes du Perche, présente un parcours retraçant 1000 ans d’histoire. Il est consacré à l’histoire du château, de la cité de Nogent-le-Rotrou et du Perche. Il convie à un voyage dans le temps, des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche, membres des familles royales d’Europe, des Bourbon-Condé, du duc de Sully, à la découverte des événements ayant forgé l’histoire du territoire et l’Histoire nationale et internationale. Monnaies, armes, sculptures, gravures, tableaux, entres autres, illustrent ces propos.
Est aussi évoqué, grâce aux collections beaux-arts, l’histoire du XIXe siècle à l’aube du XXe siècle. Sont convoqués les artistes de Nogent-le-Rotrou, et d’autres, ayant valorisé le Perche tant en France qu’à l’étranger. Citons Louis Moullin, Camille Gaté, Camille Silvy, Clara Filleul.
Ce premier versement fait écho aux origines du musée, dont les collections ont été constituées, en partie, dans un esprit de cabinet de curiosité, qui prévalait encore. Il reflète également les prochains versements et un petit aperçu des collections. Ainsi, Louis Moullin (1817-1876), peintre de la cour de Napoléon III, témoin de son temps, véritable reporter, y compris sur les champs de batailles, est à l’honneur.
Les versements à venir porteront sur la peintre, femme de lettres et voyageuse Clara Filleul (1822-1878) et sur le photographe Camille Silvy (1834-1910) dont Nadar disait qu’il était un pionnier et un génie de la photographie.
Informations fournies par le musée (Gwénaëlle Hamelin)
Le musée de Préhistoire de Terra Amata a ouvert ses portes le 16 septembre 1976 à Nice. C’est un « musée de site » consacré au gisement paléolithique de Terra Amata. Le musée conserve, à l’emplacement même du site, les vestiges d’habitats successifs laissés par des Homo heidelbergensis, il y a 400 000 et 380 000 ans. Il évoque ainsi le comportement et le mode de vie des premiers niçois. Ces êtres à la fois si proches et si éloignés de nous chassaient des éléphants antiques, des cerfs, des lapins… Ils avaient aménagé des foyers qui sont parmi les plus anciens découverts au monde. Cet établissement municipal bénéficie, depuis 2002, de l’appellation « musée de France ». Les collections du Musée de Préhistoire de Terra Amata sont composées du mobilier archéologique issu de la fouille du site en 1966 mais aussi de vestiges préhistoriques issus de différents sites de la région niçoise et méditerranéenne. Parmi le mobilier issu de la fouille du site de Terra Amata, on trouve une grande variété d’items : industrie lithique, faune, organismes marins, coprolithes, échantillon de foyer, ocres, etc. Ce premier versement de notices sur Joconde présente donc un échantillonnage des principaux domaines de cette collection. Les prochains versements mettront en lumière les industries lithiques du site, notamment ses bifaces qui seront versés intégralement.
Informations fournies par le musée (Marine Vincent)
Maison de Balzac
Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui.
C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs-d’œuvre. Le musée présente des souvenirs personnels de Balzac, des tableaux, gravures et objets relatifs à ses proches et à ses contemporains, ainsi qu’un grand nombre d’éditions originales, manuscrits et illustrations.
À travers la présentation de portraits de l'artiste ou de ses personnages, de peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie originale, le musée incite le visiteur à s'interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de La Comédie humaine. Le processus de création de l’auteur, ainsi que la résonance que son œuvre a pu avoir sur d’autres artistes est au cœur du projet du musée et guide sa politique d’acquisition.
Paris, Maison de Victor Hugo
La Ville de Paris conserve les deux maisons que Victor Hugo occupa le plus longtemps, l’hôtel de Rohan-Guéménée, à Paris, et Hauteville House à Guernesey.
L’hôtel de Rohan-Guéménée devient musée en 1902, grâce à la donation que fait Paul Meurice à la Ville de Paris. L’appartement habité par Victor Hugo de 1832 à 1848, restitue aujourd’hui sa vie au fil des trois périodes déterminantes : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. En 1927, deux ans après la mort de Georges Hugo (le petit-fils de Victor), sa sœur et ses enfants, Marguerite, François et Jean, font don à la Ville de Paris, de la maison que Hugo avait acquise et aménagée à Guernesey, Hauteville House. Ce lieu symbolique à la fois de l’exil et de l’écriture de tant de grandes œuvres est aussi l’expression, à travers ses saisissants décors de l’univers poétique et philosophique de Victor Hugo. De nos jours, les visiteurs qui se rendent à Guernesey, peuvent découvrir ce sanctuaire conservé dans son intégrité. A Paris, le musée se partage entre l’appartement de Victor Hugo au second étage et un espace dévolu, au premier étage, aux expositions temporaires. Le musée en organise deux expositions par ans, offrant à la fois la possibilité de découvrir les collections que leur nature ne permet pas d’exposer en permanence et les résonances que l’œuvre prodigieusement riche et moderne de Victor Hugo garde aujourd’hui.
Musée Bourdelle
Dans les jardins et les ateliers où Antoine Bourdelle (1861-1929) a vécu et travaillé, le musée Bourdelle abrite un ensemble de plâtres, de bronzes et de marbres de celui qui fut le praticien de Rodin, le maître de Giacometti, de Germaine Richier et de Vieira da Silva.
Ce musée possède également un fonds exceptionnel d’archives et de photographies relatifs à la vie et à l’œuvre de l’artiste. Depuis juin 2012, les visiteurs du musée profitent d’un nouveau parcours au sein des collections permanentes : pédagogique, chronologique et sensible qui met en lumière l’évolution artistique de Bourdelle.
Intimité de l’appartement de Bourdelle où le sculpteur vécut et travailla, majesté du Grand Hall des plâtres à la lumière diffuse, épure audacieuse de l'extension moderne - le visiteur découvre le parcours d'une vie et d'une œuvre, suit à son rythme les incessantes recherches stylistiques et plastiques du sculpteur visionnaire.
Musée Carnavalet - histoire de Paris
Les principales collections historiques sont celles du musée Carnavalet – Histoire de Paris. Musée de l’histoire de Paris, ville capitale, métropole et ville-monde. Il associe l’histoire, l’archéologie et l’identité sociale et urbaine.
Situé au cœur du secteur sauvegardé du Marais, dans des bâtiments classés, le musée Carnavalet célèbre en 2016 ses 150 ans d’histoire. Ses collections extraordinaires, encore trop méconnues, se déploient du néolithique à nos jours. De la pirogue découverte lors des fouilles archéologiques de Bercy aux mascarons du Pont-Neuf, de la maquette de l’île de la Cité au café militaire de Ledoux, des dessins révolutionnaires de Lesueur à la bijouterie Fouquet décorée par Mucha, on y croise les trajectoires singulières des hommes et des femmes qui ont aimé Paris et façonné son histoire, comme Sainte Geneviève, Etienne Marcel, Madame de Sévigné, le baron Haussmann ou encore Marcel Proust. Mais, à travers les décors, enseignes, pièces de mobilier, peintures, sculptures, médailles, maquettes, objets d’art et d’histoire, estampes, dessins, affiches et photographies, c’est aussi l’histoire de tous les Parisiens, d’hier et d’aujourd’hui, qui est racontée. Le musée Carnavalet-Histoire de Paris formé de deux hôtels particuliers et d’une Orangerie s’inscrit en synergie avec deux sites complémentaires : la Crypte archéologique de l’Ile de la Cité et les Catacombes de Paris. La ville de Paris a engagé en 2016 la rénovation de son musée d’histoire, répondant ainsi à une demande sociale d’histoire très forte ainsi qu’à de nouveaux usages et pratiques des publics. Les visiteurs découvrent dès 2020 un parcours des collections permanentes et une offre culturelle renouvelés ainsi que de nouveaux services.
Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris
En 1896, le financier Henri Cernuschi légua à la Ville de Paris son hôtel particulier à l’orée du parc Monceau et sa collection d’art d’Extrême-Orient acquise lors de son tour du monde.
Dans cet hôtel particulier de l'architecte William Bouwens der Boijen (1834-1907), une grande pièce centrale est aménagée pour offrir une place d'honneur à la pièce la plus impressionnante de la collection, le Bouddha Amida. Conservateur de 1905 à 1932, Henri d'Ardenne de Tizac (1877-1932) métamorphose une maison de voyageur en une institution patrimoniale moderne, en liaison avec le monde savant et soutenue, à partir de 1922, par une active société d'amis. Il spécialise le musée dans l'art et l'archéologie de la Chine ancienne, des origines au XIIIe siècle. Tout en conservant cette orientation, les directeurs successifs continuèrent à montrer de forts intérêts pour les autres cultures extrême-orientales (Japon, Viêt-Nam). Le musée complètement rénové en 2005, possède dorénavant un remarquable ensemble d’art asiatique, régulièrement enrichi par des acquisitions et des dons, et notamment l’une des plus grandes collections d’art chinois en Europe.
Musée Cognacq-Jay, musée du XVIIIe siècle de la ville de Paris
Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé monument historique (XVIe-XVIIIe siècles), le musée présente les collections d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des magasins de la Samaritaine, et sa femme Marie-Louise Jay, léguées à la Ville de Paris en 1928.
À l’exception notable d’un important tableau de jeunesse de Rembrandt, l’essentiel des œuvres présentées date du XVIIIe siècle : peintures de Canaletto, Tiepolo, Boucher, Fragonard, Greuze, Reynolds ; pastels de La Tour et Perronneau ; sculptures de Houdon, Lemoyne, Clodion ; porcelaines de Saxe ; objets d’orfèvrerie ; meubles estampillés, etc. Loin d’être « close », à l’image d’autres grandes institutions issues des collections d’un particulier, la collection Cognacq-Jay est enrichie annuellement par des acquisitions qui s’inscrivent dans les axes formés par le goût et le regard d’un collectionneur du début du XXe siècle, au moment même où les arts du XVIIIe siècle sont une référence incontournable de tout intérieur bourgeois. La nature de la collection, constituée d’objets de petites dimensions, mais également la sélection de sujets iconographiques touchant à l’intime, de la scène d’intérieur au portrait, en font un espace de rencontre privilégié avec l’esprit du XVIIIe siècle français tel qu’il était conçu à l’ère des Cognacq : un siècle où les sociabilités, les échanges et l’art de vivre figurent au cœur du développement individuel.
Musée d'art moderne de la ville de Paris
Situé dans le palais de Tokyo construit pour l’exposition internationale de 1937, le musée d’art moderne de la Ville de Paris a été inauguré en 1961.
Dès ses origines, les donateurs, collectionneurs ou artistes ont constitué une source essentielle à l’enrichissement du musée. Ainsi, c’est au legs exceptionnel du docteur Maurice Girardin en 1953 (plus de 500 œuvres) que l’on doit les points forts de l’actuelle collection avec un noyau de peintures fauves, un ensemble important d’œuvres cubistes et de nombreuses œuvres de l’École de Paris.
Avec près de 10 000 œuvres, les collections du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris représentent la richesse de la création artistique aux XXe et XXIe siècles et témoignent du dynamisme de la scène artistique contemporaine. Il offre un vaste panorama sur l’art moderne et contemporain, autour d’un noyau historique d’œuvres d’artistes majeurs du début du XXe siècle : Henri Matisse, Pablo Picasso, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck, Georges Rouault, Bernard Buffet, etc.
Les enrichissements successifs permettent d’illustrer tous les grands courants de l’art du XXe siècle – Fauvisme, Cubisme, École de Paris, Abstractions, Nouveau Réalisme, Figuration Narrative, art conceptuel – ainsi que la création contemporaine.
Palais Galliera, musée de la mode et de la ville de Paris
À deux pas des plus prestigieuses vitrines de la couture, un palais d’inspiration Renaissance abrite le musée Galliera.
Au fil d’expositions temporaires monographiques – grands noms de la couture, figures de la mode – ou thématiques – décennies, types de vêtement, jeux d’influence – le musée met en scène une partie de ses inestimables et fragiles collections qui témoignent du génie créatif de la mode du XVIIIe siècle à nos jours. Nées d’un fonds constitué dès le milieu du XIXe siècle par la Société d'histoire du costume, ses collections n’ont cessé de s’enrichir depuis lors, notamment grâce à la générosité de nombreux donateurs. Estimées aujourd'hui à 243.000 pièces, les collections du musée de la Mode de la Ville de Paris sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe à nos jours. Ces dernières années, 500 à 1.500 pièces par an sont venues enrichir ce fonds exceptionnel, essentiellement grâce au soutien de généreux donateurs. Compte-tenu de leur grande fragilité, les collections du Palais Galliera ne peuvent être exposées que sur une courte durée, à l'occasion des expositions exclusivement temporaires du musée ou de prêts exceptionnels à des institutions muséales partenaires.
Musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin
Un moment crucial de l’histoire du XXe siècle, celui de la deuxième guerre mondiale, est présenté et expliqué au public à travers les collections de ce musée, par le biais des trois compagnons de l’ordre de la Libération que sont Leclerc, Moulin et la Ville de Paris.
Les collections « Général Leclerc » sont issues d’une part de la donation du fonds historique à la Mairie de Paris par la Fondation du Maréchal Leclerc de Hauteclocque – fonds conservé au quartier Gramont à Saint-Germain-en-Laye jusqu’en 1994 – et d’autre part de dons effectués par les Anciens Français libres et de la 2e DB. Ces collections se composent principalement d’objets personnels et de la vie quotidienne ayant appartenu au Général ainsi qu’à ses soldats, couvrant les périodes Seconde guerre mondiale, l’Indochine et l’Afrique du Nord, jusqu’à la mort accidentelle de Leclerc en 1947. Les collections « Jean Moulin » furent constituées en grande partie par l’apport de deux legs importants, celui de Madame Antoinette Sasse en 1987 puis celui de Mesdames Andrée Dubois et Suzanne Escoffier, cousines de Jean Moulin, en 2012. Ces deux fonds rassemblent des archives privées émanant ou relatives à Jean Moulin (photographies, lettres, dessins, papiers personnels), ainsi que des journaux, coupures de presse et souvenirs lui rendant hommage. Enfin, le musée dispose de riches collections autour de la Libération de Paris : armes FFI, copies d’écoles des enfants de la Libération, en passant par des photographies, affiches, dessins et témoignages du pavoisement des Parisiens (partitions de chants populaires, cartes postales, brassards FFi, bouquets patriotiques et drapeaux). Ces collections sont issues notamment de nombreux dons de particuliers et comptent un grand nombre de photographies, d’images instantanées prises par des témoins directs et des acteurs.
Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris
Construit pour l’Exposition universelle de 1900, le bâtiment du Petit Palais, chef d’œuvre de l’architecte Charles Girault, est devenu en 1902 le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Il présente une très belle collection de peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art datant de l’Antiquité jusqu’en 1914. Parmi ses richesses se distinguent une collection exceptionnelle de vases grecs et un très important ensemble de tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle autour du célèbre Autoportrait au chien de Rembrandt. Sa magnifique collection de tableaux français des XVIIIe et XIXe siècles compte des œuvres majeures de : Fragonard, Greuze, David, Géricault, Delacroix, Courbet, Pissarro, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne et Vuillard. Dans le domaine de la sculpture, le musée s’enorgueillit de très beaux fonds Carpeaux, Carries et Dalou. La collection d’art décoratif est particulièrement riche pour la Renaissance et pour la période 1900, qu’il s’agisse de verreries de Gallé, de bijoux de Fouquet et Lalique, ou de la salle à manger conçue par Guimard pour son hôtel particulier. Le musée possède enfin un très beau cabinet d’arts graphiques avec, notamment, les séries complètes des gravures de Dürer, Rembrandt, Callot ... et un rare fond de dessins nordiques.
Musée de la vie romantique
Situé dans le quartier romantique de la « Nouvelle Athènes », le musée de la Vie romantique offre un écrin précieux à ses collections, un ensemble d’œuvres qui sont, pour leur plus grande part, en relation directe avec les arts en France sous la Monarchie de Juillet ; la présentation est centrée sur les peintures du peintre Ary Scheffer et de son entourage.
Ary Scheffer, occupant illustre de cette demeure, y a en effet reçu le Tout-Paris de l’époque : Delacroix, Rossini, Sand, Chopin, Gounod, Tourgueniev, Dickens, etc. Au départ musée de charme et mémoriel construit sur quelques grandes figures, le parcours des collections permanentes propose aujourd’hui un récit où se superposent la biographie des personnalités liées au lieu, l’évocation de la vie culturelle de la monarchie de Juillet, la création artistique de la période romantique et l’œuvre littéraire d’un penseur de la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans le parcours se trouvent également les souvenirs de George Sand appartenant à la ville de Paris, conservés et montrés rue Chaptal en raison d’une parfaite adéquation entre le lieu, le projet et la place de l’écrivain dans la vie artistique du XIXe siècle.
Musée Zadkine
Le musée Zadkine, lieu de mémoire et de charme, est installé dans les ateliers et la maison où vécut et travailla pendant près de quarante ans Ossip Zadkine (1890-1967), sculpteur d’origine russe et figure majeure de l’École de Paris.
À l’occasion de son trentième anniversaire et après une année de travaux, le rendant accessible à tous, le musée rouvre ses portes le 10 octobre 2012, avec une présentation de ses collections pensée autour de la question de la matière, pour faire dialoguer, sous la lumière des verrières, plâtres, terres, bois et pierres. Outre les sculptures, fleurons des collections, le musée conserve notamment des dessins et gouaches de la main de l’artiste, des photographies d’ateliers et un riche fonds d’archives, ainsi que le fonds d’œuvres de Valentine Prax, artiste et veuve de Zadkine.
C’est dans le cadre exceptionnel de l’ancienne piscine municipale de Roubaix construite entre 1927 et 1932 par l’architecte Albert Baert dans un pur style art déco réhabilitée en musée en 2001 puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon que le musée de Roubaix expose la richesse de ses collections.
Héritière des différents musées historiques de Roubaix, à l’image des musées anglo-saxons La Piscine abolit toute hiérarchie entre Arts appliqués et Beaux-Arts. Fort de son riche héritage, le musée de Roubaix poursuit depuis 2001 une politique d’acquisition très dynamique en cohérence avec les différentes sections existantes qui s’attache à favoriser toutes les formes de créations. Sont représentés des artistes reconnus ou méconnus, des œuvres à découvrir ou à re-découvrir dans des domaines très variés : dessins, estampes, photographies, peintures et sculptures, céramiques anciennes ou contemporaines, vêtements et accessoires de mode, livres d’échantillons et tissus, ou encore objets très divers témoignant de l’histoire de la ville de Roubaix…
Pour son premier versement sur POP, La Piscine souhaite faire découvrir la diversité de ses collections. D’autres versements viendront enrichir prochainement le catalogue, l’objectif étant de rendre disponible la totalité de la collection du musée sur la base Joconde. La participation au catalogue collectif des musées de France répond aux missions de diffusion et de valorisation des collections, visant à les rendre accessibles au public le plus large et à assurer l’égal accès de tous à la culture.
Informations fournies par le musée
Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Elle s’est développée à partir de l’ancien oppidum gaulois du plateau des Mersans, devenu, dès le Ier siècle de notre ère, le centre politique, économique et religieux de l’agglomération antique. D'une superficie de 2 400 m², le bâtiment est édifié sur un quartier de l’agglomération antique. L'accès se fait par le premier étage. A ce niveau, un belvédère offre une vue panoramique sur le site romain. Puis, le visiteur est invité à gagner le rez-de-chaussée, la circulation étant assurée par des rampes hélicoïdales continues, en pente douce, suspendues à la charpente d'acier du bâtiment. Ces rampes constituent des espaces d'exposition permanente et permettent l’accès (y compris pour handicapés moteurs) à la crypte, véritable cœur du musée. Les vestiges des périodes préhistoriques sont présentés de façon chronologique et ceux de la période gallo-romaine de manière thématique. Reconstitutions grandeur nature, animations audiovisuelles et maquettes rythment la visite. Les aménagements projetés se fondent sur la recherche archéologique menée sur site, avec sa part de certitudes, d'inconnues et de découvertes à venir. Les niveaux retenus sont ceux du IIe siècle de notre ère. Les collections, constituées depuis les années 1960, intègrent la base nationale Joconde dans l’objectif d’une valorisation active et en réponse au projet scientifique et culturel du musée.
Informations fournies par le musée
Créée dans les années 1960, la collection d’art et d’histoire de Saint-Ouen rassemble plus de 1500 œuvres : peintures, sculptures, tapisseries, gravures, dessins et objets ethnographiques. Elle témoigne de l’art moderne et contemporain ainsi que de l’histoire locale. En 1965, le château de Saint-Ouen, restauré et transformé en équipement culturel, accueille le musée d’art et d’histoire, où les collections sont présentées en permanence, avec des démontages ponctuels pour des expositions temporaires. En 2002, l’appellation « Musée de France » consacre l’importance nationale de ce fonds. Toutefois, en 2005, le musée ferme au public pour des raisons de sécurité. La collection comporte des œuvres de Pablo Picasso, Fernand Léger, Antoine Bourdelle, ainsi que des figures du Renouveau de la tapisserie comme Jean Lurçat, Picart le Doux et Marc Saint-Saëns. Elle comprend aussi des peintures d’Édouard Pignon et Boris Taslitsky, des gravures de Jean Delpech, Marcel Gromaire et Maximilien Luce, et des objets liés à l’histoire de Saint-Ouen. Aujourd’hui, les collections sont valorisées à travers des expositions, conférences et prêts. Grâce au récolement, l’inventaire a été enrichi de photographies. La mise en ligne de ces données sur Joconde facilitera l’accès aux œuvres et contribuera à leur diffusion, permettant de mieux faire connaître ce patrimoine audonien.
Informations fournies par le musée
À 30 km au Sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal offre sur plus de trois hectares les vestiges d’un quartier de la ville romaine de Vienna. Depuis son ouverture en 1996, le musée livre, au sein d’une architecture résolument contemporaine, un panorama complet de la vie quotidienne au cours des premiers siècles de notre ère.
Les collections du musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal se sont constituées à partir d’un remarquable ensemble de mosaïques et peintures murales issues des fouilles du site archéologique, parmi lesquelles la mosaïque au lion, la peinture des lutteurs ou l’emblématique mosaïque de Dieux Océan, auquel s’ajoute une importante collection de mosaïques en noir et blanc à trame géométrique, au style caractéristique d’une « école » viennoise originale.
Vaisselle en céramique, verre, tabletterie en os, objets de parure, conduites en plomb, ustensiles en métal témoignent de la vie matérielle et des activités des habitants.
Des œuvres majeures découvertes sur les deux rives de la cité antique, appartenant à la Ville de Vienne et au Service Régional de l’Archéologie Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que quelques dépôts cédés par les villes de Lyon, de Grenoble et Nîmes, complètent la collection.
Enfin, de nouvelles découvertes exceptionnelles sur le site du Bourg, à Sainte-Colombe, viennent enrichir la collection depuis 2023.
Le musée souhaite, avec le versement de notices sur Joconde en 2025, rendre ses collections accessibles et consultables au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Bénéficiant de l’appellation « Musée de France », ainsi que des labels « Maison des Illustres » et « Monuments Historiques », le musée Charles Milcendeau à Soullans, en Vendée, offre une plongée fascinante dans l’univers du peintre Charles Milcendeau (1872-1919). Situé à côté de sa maison, inscrite au titre des Monuments Historiques, ce musée met en lumière l’œuvre et la vie de cet artiste profondément inspiré par le Marais breton vendéen et ses voyages en Espagne.
Le musée présente plus de 80 œuvres de Charles Milcendeau : croquis, dessins, peintures, pastels et aquarelles, mais également des œuvres inédites issues de collections privées et publiques (musée d’Orsay, musée Gustave Moreau) ainsi que des objets personnels de l’artiste à l’occasion d’une exposition temporaire en 2025.
Les visiteurs peuvent explorer la maison ornée de peintures d’inspiration mozarabe, témoignant de l’influence espagnole, bénéficier d’un espace muséographique moderne ainsi que d’un patio andalou et d’un jardin propice à la détente. Le musée propose à ses visiteurs une expérience culturelle vivante (exposition temporaire annuelle, animations variées et application interactive disponible en français, anglais et espagnol).
Ce premier versement sur Joconde est l’occasion d’élargir la découverte de l’univers singulier d’un artiste profondément attaché à sa terre natale tout en étant marqué par ses voyages exotiques.
Informations fournies par le musée
Musées intégrés en 2024
Le musée de la chemiserie et de l’élégance masculine d’Argenton-sur-Creuse sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle textile qui a dominé l’économie locale pendant plus d’un siècle : la confection de chemises. Situé en plein cœur de la ville, dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par Charles Brillaud, industriel argentonnais, il met à la disposition des visiteurs les connaissances historiques, sociologiques et économiques nécessaires à la compréhension des mutations qui ont contribué à façonner ce patrimoine matériel et immatériel de l'industrie de la chemiserie-lingerie jusqu'à aujourd’hui. Il participe ainsi à sa transmission par-delà son berceau argentonnais.
Le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine tient une place à part au plan national quant à son autre objet d’étude et d’expositions : la mode masculine, avec une importante collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours.
Se positionnant en lieu d'histoire et de mémoire autant que d'observation et d'analyse du temps présent, il porte un intérêt à la création textile et entretient avec les artistes contemporains un lien fort, contribuant à son rayonnement.
Les collections, constituées depuis 1983, intègrent la base nationale Joconde dans l’objectif d’une valorisation active, en cohérence avec le projet scientifique et culturel du musée.
Informations fournies par le musée
Le 13 septembre 1997, Maurice Jardot donne à la Ville de Belfort 112 œuvres (peintures, sculptures, arts graphiques) de sa collection, et il choisit de l’implanter dans la villa bourgeoise de la famille du poète Léon Deubel proposée par la Ville de Belfort. La donation Maurice-Jardot ouvre ses portes au grand public en 1999 et depuis lors fait découvrir aux passionnés d'art moderne les plus belles œuvres des artistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, entre cubisme et surréalisme : Beaudin, Braque, Chagall, Gris, Kermadec, Laurens, Le Corbusier, Léger, Masson, Picasso. La présente collection est, comme toute collection privée, un portrait intime de Maurice Jardot, ancien collaborateur du marchand Daniel-Henry Kahnweiler, illustrant ses goûts, ses recherches et ses fidélités. Plus qu’un musée, dont Kahnweiler et Jardot se méfient en tant qu’obstacle entre l’artiste et le monde, la donation Maurice-Jardot respire l’atmosphère de la galerie Louise-Leiris. Depuis 1999, l’enrichissement de cette collection se fait dans le respect de la donation initiale avec notamment en 2019 un don exceptionnel de 45 estampes de la « Caisse à remords » de Picasso par la galerie Louise-Leiris. La mise en ligne progressive de la collection d’art moderne de Belfort sur Joconde permet la mise en valeur des œuvres encore trop méconnues et pourtant emblématiques du début du XXe siècle, en amont de l’ouverture du musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot.
Informations fournies par le musée
Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l'Hôtel Fayet est l'un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l'hôtel fut d'abord une élégante maison bourgeoise, dotée d'un grand atelier d'artiste, avant d'être transformée en musée en 1990 après l’acquisition de l'immeuble par la Ville en 1966. Devenu musée de France en 2003, le musée Fayet a reçu le label « Maison des illustres » en 2019. Il abrite les remarquables collections beaux-arts de la Ville issues d’une donation de la Société archéologique de Béziers en 1859. Un de ses points d’orgue est constitué du fonds d'atelier de Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), sculpteur néo-baroque et l'un des artistes les plus sollicités de son temps, en France et à l’étranger. Le fonds de sculpture compte également des œuvres de David d’Angers, Auguste Rodin et Jean Magrou. Les collections de peinture européenne contiennent des chefs-d’œuvre de Martin Schaffner, François Bunel le Jeune, du Dominiquin, Sébastien Bourdon, Nicolas-Guy Brenet, Alexandre Cabanel, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Richard Parkes Bonington, Raoul Dufy pour n’en citer que quelques-uns. Le musée possède aussi un cabinet d’arts graphiques riche de plus de 2300 pièces avec un fonds important de 160 dessins de Joseph-Marie Vien et 600 dessins de Jean Moulin donnés par sa sœur Laure en 1975.
Les premiers versements sur Joconde offrent l’opportunité de faire connaître les collections du musée des beaux-arts et contribuent à la volonté municipale de donner plus de visibilité à cette institution.
Informations fournies par le musée
Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu fondé au XVe siècle par Jean III de Coligny, le musée d’art et d’archéologie de Châtillon-Coligny est le témoin de la riche histoire de la ville et de ses environs. Fondé dans les années 1980 sous l’impulsion de monsieur Hubert Zurfluh ancien maire de Châtillon-Coligny et président du groupe archéologique, le musée est d’abord l’héritier des collections de cette association, dont les fouilles locales mettent au jour plusieurs sites et objets allant du paléolithique à la fin de la période romaine. Ses collections vont ensuite s’agrandir, afin d’englober plus largement l’histoire de Châtillon-Coligny et notamment celle des familles ayant fait la renommée de la Ville. Des tableaux et du mobilier venant du château de la commune permettent de mettre en avant l’histoire des Coligny et des Montmorency-Luxembourg, ainsi que celle de la présence protestante dans la région. La lignée des savants Becquerel est également à l’honneur, avec plusieurs documents et effets personnels remis de leur vivant ou par leur descendant à la Ville. Devenu musée contrôlé en 1981, puis musée de France en 2003, le musée d’art et d’archéologie présente une collection diversifiée (tableaux, estampes, objets archéologiques et scientifiques, etc.) qui illustre le riche passé de Châtillon-Coligny et de son territoire. Le versement sur Joconde représente l’opportunité pour le musée de gagner en visibilité, de rendre plus accessibles ses collections et ainsi accompagner les efforts de la mairie et du Département pour rendre cet établissement plus attractif.
Informations fournies par le musée
Fondé en 1882 par la Société archéologique et historique du Châtillonnais (SAHC), le musée est d'abord installé dans la "maison Philandrier" puis déménagé en 2009 dans les locaux de l’ancienne abbaye Notre-Dame, permettant un agrandissement et un embellissement des surfaces d’exposition. La richesse du Pays Châtillonnais, l’activité de la Société Archéologique et Historique du Châtillonnais, la participation active des Amis du Musées (AMPC) et un grand nombre de donateurs sont à l’origine d’une collection de pièces tant archéologiques qu’historiques dignes des plus grands établissements. La collection de bois gravés d’impression et les collections impériales du maréchal Marmont ravissent aussi bien les visiteurs curieux que les spécialistes. La découverte de la tombe de la Dame de Vix en 1953 consacre le renom international du musée. Désormais le « Trésor de Vix », avec son imposant cratère en bronze, en fonde la réputation. Par ailleurs, les très nombreux objets découverts tout au long du XXe siècle, sur les sites archéologiques de la région, ont constitué progressivement une des collections des époques celtique et gallo-romaine les plus représentatives de France. La politique du musée s’inscrit alors dans une démarche de partage des connaissances à un public plus vaste, avec une attention particulière pour les publics plus jeunes et les familles. La diffusion des collections sur Joconde entre parfaitement dans l’objectif de faire connaître ses collections au plus grand nombre, continuant ainsi la volonté exprimée dans le Projet scientifique et culturel du musée.
Informations fournies par le musée
Crécy-la-Chapelle, une petite commune de Seine-et-Marne, née de la fusion de Crécy-en-Brie avec La-Chapelle-sur-Crécy en 1972, est poétiquement appelée « La Venise Briarde ». Riche en histoire, elle rayonne depuis la fin du 19e siècle grâce aux peintres venus en quête d’inspiration, enchantés par ses canaux, ses moulins et ses champs. En 1923, un de ces peintres, Alexandre Altmann, immigré ukrainien, y pose ses valises. En 1927, il lègue à Crécy une collection de 27 tableaux, destinés à la création d’un musée. Ce musée ouvre ses portes à des visiteurs au début des années 1930. La collection, agrandie grâce aux dons de peintres, de ses proches et des habitants, compte 137 tableaux. Mais lors de la deuxième guerre mondiale, l’établissement doit être fermé. La collection est alors éparpillée dans les greniers de bâtiments appartenant à la mairie. Grace au travail acharné, effectué 40 ans plus tard par la maire adjoint à la culture, elle sera réunie dans un local d’une annexe de la mairie, désigné à cet effet. En attendant une réouverture du musée, une sélection des œuvres est exposée dans la mairie depuis les années 2000. La modeste collection du musée comporte les tableaux d’époques et de styles divers. Son inscription sur la base Joconde permettra d’augmenter sa visibilité et de faciliter les prêts pour des expositions temporaires, répondant à la volonté du peintre et de la commune : permettre à un plus grand nombre des personnes d’admirer les œuvres oubliées.
Informations fournies par le musée
Le musée du château est un lieu incontournable de la ville de Flers, alliant charme historique et cadre naturel. Situé en plein cœur de ville, il bénéficie d'un emplacement privilégié au milieu d’un parc arboré de 26 hectares. Le château, bordé par des douves sur trois côtés, présente deux facettes distinctes : la partie la plus ancienne, datant du 16e siècle, se distingue par ses tourelles couronnées de clochetons, tandis que l’aile du 18e siècle avec son grand perron accueille les visiteurs par une majestueuse cour d'honneur.
À l'intérieur, un parcours muséographique retrace l’histoire du domaine et de ses différents propriétaires, depuis les comtes de Flers en passant par la famille Schnetz, jusqu’à l’acquisition du château par la ville en 1901. Le textile, autrefois fleuron de l’industrie sur le territoire, est également évoqué. Labellisé Musée de France, il abrite aujourd’hui près de 4 000 objets, dont 300 peintures. Musée de beaux-arts, d’art décoratif et d’histoire locale, il abrite une collection offrant un large panorama artistique. Les visiteurs peuvent y admirer des œuvres de grands maîtres tels que Boudin, Caillebotte, Corot, Courbet, Diaz de La-Pena ou encore Van Dyck, ainsi que des céramiques signées Cocteau.
L’accrochage évolue chaque année en fonction des expositions temporaires, c’est l’occasion non seulement d'effectuer une rotation des collections, mais aussi de présenter des œuvres provenant d’autres musées de Normandie par le biais d’emprunts.
Le musée du château s’engage dans un travail de versement régulier de notices sur la plateforme POP permettant ainsi de rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre tout en mettant en avant le chantier des collections.
Informations fournies par le musée
Le musée Baron Martin est installé dans le château royal de Gray classé Monument historique où les lambris clairs décorés de bouquets et d’enfants joueurs s’harmonisent avec les collections et avec un parc romantique d’environ un hectare caché à l’abri d’un rempart et d’une tour. Né dans les années 1850, le musée refondé en 1901, offre 14 salons dédiés aux collections beaux-arts, une galerie d’archéologie ainsi qu’un niveau d’expositions temporaires. L’accueil et la boutique ont pris place dans une aile jadis dévolue aux cuisines, bains et fours. Le château meublé a conservé presque intacte l’atmosphère toute particulière d’une demeure privée. Nombreuses sont les œuvres majeures du musée – La Dame à l’ombrelle de Tissot, Le Galant colporteur de Boucher, La Femme au gant blanc d’Aman-Jean, les dessins de Prud’hon … qui semblent s’amuser du potentiel des lieux en chantant le bonheur d’aimer, tout en captant des êtres célébrant les valeurs de l’individu et du libre arbitre. Un nom y appelle un autre nom, comme autant de « selfies » qui interrogent notre manière de vivre et de penser. Les premiers versements de notices dans Joconde visent à partager le plus largement une des plus belles collections de l’Est de la France, dans ses chefs-d’œuvre comme dans sa diversité, en reflétant les passions de grands collectionneurs qui l’ont animée et l’esprit d’ouverture de ses refondateurs de la Belle Epoque axé sur la part des femmes, le goût de la nature et des fêtes, la sensibilité à la misère sociale...
Informations fournies par Brigitte Olivier, directrice du musée
Le musée Médard de Lunel (Hérault), ouvert depuis décembre 2013 et doté de l’appellation musée de France depuis 2017, est consacré à l’histoire des collections du bibliophile Louis Médard, aux livres anciens ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.
L'exceptionnel cabinet de Louis Médard (1768-1841), placé au centre du musée, permet de découvrir une authentique bibliothèque du XIXe siècle, conservée dans son intégralité. Les différentes collections du musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l'art de la reliure, de la gravure, de la calligraphie et de l'enluminure.
Le musée conserve notamment 5000 volumes datés du XIIe au XIXe siècle (manuscrits et imprimés), des estampes et des albums d'images, des reliures précieuses réalisées par les grands artisans parisiens et montpelliérains du XIXe siècle, des outils illustrant les techniques du livre et de l'impression tels que des maquettes de presse, des fers et roulettes à dorer, ainsi que des livres d’artistes contemporains qui viennent enrichir les collections anciennes.
Depuis 2019, le musée opère une grande campagne d’informatisation de ses collections afin de les valoriser auprès du grand public, en les rendant accessible via son portail des collections. Les versements des collections sur Joconde répondent à cet objectif en les faisant rayonner au niveau national.
Le tout premier versement dans Joconde permettra de valoriser les œuvres les plus représentatives des collections patrimoniales du musée et de présenter leur diversité et leur richesse. Par la suite, l’ensemble des collections sera progressivement versée.
Informations fournies par le musée
En 1967, en réponse au choc causé par la catastrophe de Feyzin (1966), le commandant des sapeurs-pompiers de Lyon André Pierret confie au commandant Henri Mongarny la création d’une équipe de bénévoles chargée de retrouver et conserver le matériel témoin de l’évolution du métier. Après plusieurs années de collectes, le musée est inauguré le 25 novembre 1971. En 2005, le ministère de la Culture accorde au musée l’appellation « Musée de France » afin de valoriser la collection et de la protéger d’une éventuelle revente. En 2009, l’association des amis du musée est absorbée par le comité d’animation sociale et culturelle (CASC) du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) qui devient propriétaire des collections. Cette nouvelle gouvernance permet la diversification de ses activités notamment par l’arrivée d’un personnel professionnel de la culture travaillant au côté d’une équipe de 40 bénévoles toujours très actifs. Les collections sont constituées d’éléments d’une grande variété : véhicules, pompes à bras, petit matériel, casques, uniformes, drapeaux … collectés dans toute la France, que la participation au catalogue Joconde va permettre de diffuser au plus grand nombre. Un premier versement illustrera la richesse et la diversité de la collection de casques français et étrangers, tandis que les prochains versements mettront en valeur les autres typologies d’objets en débutant par les véhicules qui ne sont pas tous visibles par le public à ce jour.
Informations fournies par le musée
Après avoir été pendant plusieurs siècles la résidence des évêques de Meaux, le palais épiscopal de Meaux devient musée et bibliothèque pendant la Révolution. Les collections historiques transférées ensuite à l’hôtel de ville sont enrichies au XIXe siècle, grâce à des dons, des legs, des fouilles archéologiques et des dépôts de l’Etat, notamment celui du mobilier des évêques de Meaux. En 1926, le musée intègre à nouveau le palais épiscopal. Au XXe siècle, la générosité d’éminents scientifiques accroît considérablement les collections de peinture. Reçu en 1914, le legs du fils d’Henri Moissan comporte notamment des œuvres d’Eugène Delacroix, Jean-François Millet, Alexandre-Gabriel Decamps, Paul-Désiré Trouillebert, Jean-Léon Gérôme, et Paul Saïn dont il était l’ami. Depuis 1983, grâce à Jean-Pierre et Annie Changeux, les collections du musée sont régulièrement enrichies de peintures des XVIIe et XVIIIe siècles par Jacques Blanchard, Sébastien Bourdon, Mathieu le Nain, François Verdier, Carle Van Loo, Jean Restout, Claude Vignon…
La collection du musée Bossuet est aujourd’hui composée de plus de 5 500 objets, de natures très variées, attachés à l’histoire du territoire, et conserve une riche iconographie de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.
L’ensemble de la Cité épiscopale fait l’objet d’un projet de renouveau ambitieux. Le musée mène une politique active d’acquisition et de prêts, en lien avec son chantier des collections. Le versement sur Joconde de notices et images vise à rendre plus accessibles ces collections, dans le cadre de ce grand projet.
Informations fournies par le musée
Moret-Loing-et-Orvanne, musée municipal
Sous l’égide et avec l’appui du maire Florentin Renondeau (1861-1944), le Musée municipal, créé le 7 juin 1924, fût d’abord installé dans une salle de l’ancienne mairie puis dans la salle actuelle du Conseil Municipal. Les conservateurs nommés ont été successivement Karl Cartier (1855-1925), artiste peintre, de novembre 1924 à février 1925, Paul Favé, artiste peintre (1877-1942) du 28 février 1925 jusqu’au début de l’année 1930, et Paul Grivet (1866-1957), receveur de l’Enregistrement et des Domaines, du 15 février 1930 jusqu’en 1956. Ce dernier était le beau-fils de l’artiste Louis-Robert-Mary Carrier-Belleuse. Le musée reçut de multiples dons entre 1924 et 1935. En août 1986, le premier étage de l’ancienne école située place Samois est restauré et l’autorisation est donnée d’y regrouper des activités artistiques. Le 25 mars 1990, le nouveau musée est inauguré. En 1997, l’exposition de la collection de Denis De Champeaux, organisée par l’association « Aux portes de l’art », montra 150 dessins du XVIe au XXe siècle. L’année 1999, centenaire de la mort du peintre Alfred Sisley, fut l’occasion d’une grande rétrospective et quelques œuvres de l’artiste furent présentées au musée. Elle bénéficia d’une couverture médiatique internationale. Le 22 mars 2024, le Musée municipal de Moret-Loing-et-Orvanne reprend des couleurs avec l’ouverture d’une nouvelle exposition permanente pour fêter son centenaire. Le versement sur Joconde s’inscrit dans la volonté de rendre accessibles les collections et de montrer toute leur richesse.
Informations fournies par le musée
Le musée Casa Pairal, axé sur les arts et traditions populaires catalans, a vu le jour en 1963. L'influence de G.-H. Rivière est très présente dans la muséographie jusqu’en 2010, date à laquelle elle est rénovée afin de l’adapter aux conditions de présentation actuelle, tout en conservant une évocation du musée d’origine avec sa « reconstitution de la cuisine du Mas del Gleix » remontant à 1631.
Les collections regroupent plus de 26000 pièces couvrant les thématiques allant du costume traditionnel à l’outillage des travaux agricoles, en passant par le transport, ainsi que la vie domestique et religieuse. Elles couvrent principalement le XIXᵉ siècle, jusqu’aux années 1950, avec quelques incursions dans une période allant du XIVᵉ siècle au XVIIIᵉ siècle. Cette diversité se conjugue à celles des objets et des matériaux qui les constituent : cuirs et textiles divers, œuvres graphiques sur toile, papier ou parchemin, métaux et alliages, bois, lapidaire, céramiques variées. A titre d’exemple, le musée compte plusieurs fonds d’artisans et d’ateliers divers dont un fonds issu des anciennes usines de poupées Bella, un fonds de véhicules hippomobiles ou encore un spécifique fonds maritime avec ses précieuses barques catalanes.
Le musée est installé dans le Castillet (1368). Ancienne porte de la ville, il est classé Monument Historique depuis 1889. C’est l’un des symboles de Perpignan et de la culture nord-catalane. Ce « petit château » est aujourd’hui le lieu de rassemblement pour tous les grands événements de la cité.
Le musée initie la mise en ligne de ses collections sur la base Joconde afin de les valoriser tout en mettant en lumière leur richesse et leur diversité auprès des chercheurs et des professionnels mais aussi du grand public.
Informations fournies par le musée
Le musée des monnaies et médailles Joseph Puig est installé au cœur de la villa "les Tilleuls" à Perpignan. La fondation du musée est liée au legs consenti par Joseph Puig (1859-1929) à la ville de Perpignan. Durant toute sa vie, ce riche négociant ayant fait fortune dans la mercerie, s’était constitué une collection exceptionnelle. Il avait une préférence particulière pour les monnaies catalanes, mais, dans un souci d’universalité, il rassembla aussi des monnaies antiques, féodales, modernes et contemporaines de tous les pays. Il a ainsi bâti une collection qui couvre près de 25 siècles d'histoire de la monnaie.
De 1954 à 1984, un cabinet numismatique est ouvert aux chercheurs et aux amateurs. Puis, en 1984, le musée est officiellement créé avec deux salles d’exposition présentant au public, selon les vœux du donateur, les monnaies ayant circulé en Catalogne en exposition permanente et les autres séries à l’occasion d’expositions temporaires. Une troisième pièce ouverte au public reconstitue le cabinet de travail de Joseph Puig.
Ayant obtenu l’appellation Musée de France, désirant faire découvrir les richesses de ses collections numismatiques aux publics et soucieux de garantir la reconnaissance de ses pairs et de se faire connaitre des chercheurs, le musée des monnaies et médailles Joseph Puig s’engage dans une démarche pérenne de versements réguliers sur la base Joconde du ministère de la Culture.
Informations fournies par le musée
Héritier de la bibliothèque-musée de la « Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de l’arrondissement d’Orange », le musée d’art et d’histoire d’Orange est fondé en 1933 à l’initiative de Jules Formigé. Le musée obtient dès 2002 l’appellation « Musée de France ».
Tout d’abord musée lapidaire, le musée reçoit en parallèle d’importants dons. Ces derniers permettent au musée de retracer l'histoire d'Orange de l'Antiquité au XIXe siècle. Le rez-de-chaussée évoque l’antique cité d’Orange, nommée Arausio, illustrée par son cadastre romain ou encore par son important mobilier funéraire. L’étage présente la Principauté d’Orange, la manufacture d’indiennes Wetter, mais aussi les collections liées à l'histoire de la ville aux XVIIIe et XIXe siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de beaux-arts de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Le service Conservation mène une démarche globale depuis plusieurs années autour de ses collections, notamment avec l’informatisation des différents fonds. De plus, le musée a une politique de restauration pour le bien-être des œuvres et leur valorisation auprès du public. Enfin, l’enrichissement des collections est toujours en vigueur, notamment grâce au soutien de la municipalité, de la DRAC-PACA et des Amis du Musée et des Archives d’Orange.
Les versements sur la base Joconde permettent de mettre en lumière quelques-unes des plus belles pièces du musée d’Orange mais surtout la grande diversité qui s’y trouve.
Informations fournies par le musée
Le musée de Sologne, propriété de la Ville de Romorantin-Lanthenay, a pour mission la conservation, l’étude et la présentation au public du patrimoine matériel et immatériel de ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. Il propose aux visiteurs des clefs de compréhension pour mieux découvrir cette région aux multiples facettes. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffe tout au long de l’année d’expositions temporaires. En 1995, le musée de Sologne s’implante au cœur des quartiers anciens de Romorantin, dans trois anciens moulins, témoins de l’activité économique et industrielle de la Ville. Le service présente également la particularité de réunir, les archives municipales et le centre de documentation sur la Sologne. Les collections comptent environ 5000 pièces ethnologiques, historiques ou artistiques. Elles ont été constituées, à partir de 1882, par des dons et legs d’érudits et de notables locaux (Scribe, Delaune, Martin, Pestel…) et par un dépôt, en 1954, du musée national des arts et traditions populaires. En 2010, sont intégrées, 7000 pièces de céramique architecturale achetées au collectionneur Michel Pasquier et exposées au sein de la Fabrique Normant. Le musée entame la mise en ligne progressive de ses collections sur la base Joconde afin de leur permettre une meilleure visibilité du grand public et des professionnels.
Informations fournies par le musée
Le musée de l’Abbaye Sainte-Croix (MASC), musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne a été créé en 1963. Ses collections se développent autour de deux figures tutélaires, Gaston Chaissac et Victor Brauner. Gaston Chaissac (1910-1964) a su métamorphoser les thèmes et les matériaux les plus banals en « fétiches dernier cri », dandys, masques, totems et autres « trouvailles » qui ont contribué à renouveler le langage artistique d’après-guerre. D’origine roumaine, Victor Brauner (1903-1966) s’installe à Paris dans les années 1930. À partir de références qu’il partage avec les surréalistes, l’attrait pour les arts primitifs, les sciences occultes et la psychanalyse, l’artiste a élaboré un langage plastique propre, évoluant vers l’épure et la stylisation des figures.
Centrée sur la peinture, la collection interroge le rapport au réel et le statut ambigu de la figuration, depuis les avant-gardes cubistes du début du siècle jusqu'aux nouveaux peintres du réel, en passant par les protagonistes de la Figuration narrative ou de la Figuration libre. En contrepoint, quelques œuvres abstraites déconstruisent et analysent la matérialité de l’œuvre ou se réclament d'un art géométrique tantôt ludique, tantôt plus conceptuel. Cette remise en cause de la validité de la peinture chahutée par la modernité et l'ère nouvelle de la reproductibilité, va de pair avec une expérimentation sans cesse renouvelée de cette pratique, qui se fait inclusive et dialogue avec d’autres techniques.
La diffusion sur Joconde, en articulation avec la mise en ligne des collections du musée sur son propre site, est une façon renouvelée de faire connaître ces oeuvres au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Le château de Saché devient un musée consacré à Honoré de Balzac en 1951, à l’initiative de son propriétaire Paul-Bernard Métadier (1918-2021), et avec le soutien d’Horace Hennion (1872-1952), ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Tours. Donné au Département d’Indre-et-Loire dès 1958, le musée Balzac a enrichi ses collections grâce à cinq autres donations de Paul-Bernard Métadier, conservateur et mécène du musée, ainsi qu’à travers de grandes acquisitions du Département : collection Galantaris en 1988 (estampes, sculptures, bois gravés), fonds Samueli en 2002 (imprimés et manuscrits), épreuves corrigées du Lys dans la vallée en 2006 (manuscrits). Les collections du musée comptent près de 2300 pièces. Principalement constituées d’estampes, d’éditions anciennes et de manuscrits, elles comprennent également des peintures, des sculptures, du mobilier et du matériel d’imprimerie. Devenu musée de France en 2002, le musée Balzac a entrepris depuis plusieurs années de mener des restaurations de ses œuvres au fil des campagnes de récolements, dans la perspective d’améliorer son parcours des collections permanentes. Le premier versement dans Joconde permet de valoriser les sculptures du musée Balzac, présentées en partie dans le cadre d’aménagements récents du musée : un espace sur les personnages de La Comédie humaine sculptés par Pierre Ripert (2019) et une salle consacrée aux monuments en hommage à Balzac (2021).
Informations fournies par le musée
Le musée de la Tour Abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux est installé depuis 1950 dans l'ancienne tour Saint-Étienne, vestige de l’abbaye bénédictine fondée au VIe siècle par le moine Amand, conseiller du roi mérovingien Dagobert II. L’abbaye a été en grande partie détruite lors de la Révolution. N’en subsistent aujourd’hui que deux monuments notables : la tour Musée (classée Monument Historique en 1843) et l’Échevinage (classé Monument Historique en 1883), tous deux situés sur la Grand-Place de la ville. Le cadre architectural du musée, profondément liée à l’histoire des collections, est un élément majeur du parcours des collections.
Le musée a pour vocation initiale de conserver et d’exposer les témoignages historiques de l’histoire de l’Amandinois autour de deux pôles principaux : l’histoire de l’abbaye et le savoir-faire faïencier de la ville. Les collections du musée se sont d’abord constituées autour du don Lebacqz constitué de céramiques du XVIIIe siècle issues des faïenceries Desmoutiers et Fauquez et se sont progressivement étoffées entre 1979 et 1992 à travers une vigoureuse politique d’acquisition à la fois dans les domaines traditionnels du musée mais aussi dans des domaines adjacents comme les beaux-arts des XVIIe et XVIIIe siècles et la céramique contemporaine.
Informations fournies par le musée
Le musée Frank A. Perret – Mémorial de la catastrophe de 1902 témoigne de l’histoire de Saint-Pierre (Martinique) et de sa destruction le 8 mai 1902 lors de l’éruption de la montagne Pelée. Plus ancien musée de l’île, il est fondé en 1933 par Frank Alvord Perret, volcanologue américain d’origine suisse, qui se rend à la Martinique en 1929 alors que la montagne Pelée montre un regain d’activité. Après avoir étudié, à l’aide d’outils d’analyse précis, l’activité du volcan et rassuré la population martiniquaise sur l’absence de risques, il décide de créer un musée volcanologique et historique. Ce projet nait d’un double constat : l’effacement de l’histoire et la dispersion du patrimoine matériel de Saint-Pierre après la catastrophe. Déformés et transformés par le feu, ces objets suscitent l’intérêt et la fascination des nombreux visiteurs des ruines. La mise en circulation de ces « objets perturbés », selon la formule d’André Breton, apporte le témoignage matériel de la catastrophe à travers le monde.
Le versement sur la base Joconde des notices-objets du musée s’inscrit dans la volonté de rendre accessible une collection insulaire et de favoriser les échanges avec les autres institutions muséales. Le musée Frank A. Perret – Mémorial de 1902 inventorie les objets issus de Saint-Pierre conservés dans d’autres collections publiques et privées. Ce programme intitulé « Patrimoine retrouvé de Saint-Pierre » doit permettre de nouer des partenariats pour développer la connaissance et la circulation des objets.
Informations fournies par le musée
Le musée municipal et le site archéologique départemental des Mazelles à Thésée, en Loir-et-Cher, présentent un patrimoine singulier. Implantés en plein cœur de la vallée du Cher, ils témoignent du riche passé romain de ce territoire : située à la croisée des chemins et des peuples, l'antique ville de Tasciaca se développait sur les bords de la rivière, et constituait un carrefour commercial incontournable au début de notre ère. Le musée municipal de Thésée, situé à l'étage de la mairie, présente de riches collections gallo-romaines constituées à l'issue des fouilles réalisées sur l'emprise de Tasciaca, entre les années 1960 et 1980. Il retrace la vie quotidienne ainsi que les activités artisanales, commerciales et cultuelles ayant eu cours dans la ville romaine entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère. Ce musée fait actuellement l'objet d'une réflexion portée par le département, la communauté de communes, le pays, la commune et l'État pour proposer des contenus renouvelés, plus attractifs et immersifs au travers d’un nouveau centre culturel et muséal à imaginer à proximité immédiate du site archéologique départemental des Mazelles, à la sortie du bourg. La mise en ligne des collections du musée sur la plateforme POP s’inscrit dans ce projet de mise en visibilité de ce patrimoine méconnu en région Centre-Val de Loire. Le récolement décennal est en cours, et permettra à terme de verser la majorité des notices d’objets appartenant aux collections municipales.
Informations fournies par le musée
Créé en 1863, le musée de Thonon-les-Bains est aujourd’hui installé dans les caves voûtées du château de Sonnaz, une demeure historique du XVIIe siècle suspendue au-dessus du port de Rives et du lac Léman, face au Jura suisse. Les collections, plus de 10 000 objets de nature très variée, sont en lien avec le Chablais, ancienne province du duché de Savoie au sud du lac Léman. L’exposition permanente, renouvelée en 2021, est déclinée en un parcours à travers l’histoire du territoire, du Néolithique à l’Annexion française en 1860 ainsi qu’une salle consacrée aux paysages lémaniques. Depuis 2020, les équipes travaillent au redéploiement des collections vers le château de Rives. Le projet scientifique et culturel de ce nouveau musée a été validé en 2022 avec les axes majeurs suivants : Archéologie en Chablais, Paysages lémaniques et chablaisiens : peintures et estampes de la fin du XVIIIe au XXIe siècle, Artistes en Chablais dont le fonds consacré à la sculptrice Marguerite Peltzer (1897-1991), le fonds du peintre Enrico Vegetti (1853-1951) ou encore le fonds Maurice Denis (1870-1943) qui a réalisé deux grands décors religieux à Thonon, Histoire et vie locale dont les portraits de personnalités et le fonds Premier Empire autour des généraux Dessaix, Chastel et Dupas, Ethnographie locale : l’exploitation du territoire, la mode et les usages vestimentaires traditionnels, la production céramique, la batellerie, les eaux et le thermalisme, le tourisme lacustre.
L’un des objectifs du PSC est la diffusion, la valorisation et le rayonnement des collections notamment sur internet, en particulier en contribuant à Joconde.
Informations fournies par le musée
Musées intégrés en 2023
Le musée d’art et d’histoire de Belfort est créé en 1872 par la Société Belfortaine d’Emulation autour d’un fonds archéologique issu des fouilles locales. Des dépôts de l’Etat, des dons particuliers et des donations d’artistes viennent enrichir les collections beaux-arts. En 1968, la donation Pierre Boigeol, composée de plus de 800 objets militaires, marque la naissance du musée d’Histoire installé dans l’ancienne caserne, construite en 1826 par le Général Haxo sur l’emplacement du château médiéval. En 2008, les collections du musée sont scindées en deux. Le musée d’Histoire reste dans les espaces de la Citadelle tandis que les collections beaux-arts sont placées dans la Tour 41 appartenant aux anciennes fortifications Vauban du XVIIe siècle. Bien que ces collections soient réparties sur deux sites, le musée d’art et d’histoire reste une seule entité administrative. Actuellement en sommeil dans les réserves, les collections beaux-arts sont destinées à rejoindre le futur musée d’art de Belfort – donation Maurice-Jardot qui constituera ainsi un riche pôle muséal. La mise en ligne progressive des collections beaux-arts et historiques permet la mise en valeur de l’histoire locale avec des personnages emblématiques tels que Denfert-Rochereau ou Camille Lefèvre et des artistes incontournables tels que Dürer, Bartholdi, Courbet, Rodin...
Informations fournies par le musée
Le musée Edmond Rostand est installé depuis 1961 à la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains. Ce vaste domaine est considéré comme l’œuvre de pierre et de verdure de l’auteur de Cyrano de Bergerac. Au cœur des douze hectares, la vaste maison présente les allures d’une ferme à colombages tout en offrant un intérieur luxueux traité comme un somptueux décor de théâtre. Pour cela, Edmond Rostand et Rosemonde Gérard font appel à des artistes de renom. Tout autour, le poète a imaginé un ensemble de jardins, alpins, à la française, une prairie fleurie, un bois paysager.
Les collections du musée Edmond Rostand se sont constituées au fil des années. Les deux fils, Maurice et Jean Rostand, ont fait don de nombreux objets de la vie culturelle du couple Rostand, manuscrits, maquettes de costumes, marionnettes, ainsi que de correspondances avec de nombreuses personnalités. Depuis, les écrits autographes et les correspondances de l’ensemble de la famille font l’objet de campagne d’acquisition par la commune.
Le musée développe depuis 2010 de nouvelles acquisitions. Les costumes et maquettes des mises en scène contemporaines rejoignent ainsi les collections. Le musée recherche également les produits dérivés qui permettent de saisir l’impact de ces écrits sur la société.
Cette mise en ligne d’un millier de notices s’étalera sur une année. Elle cherche à présenter la variété des collections et à mieux faire connaitre cette famille d’écrivains.
Arnaga est classé Monument historique, labellisé Jardin Remarquable, Maison des Illustres.
Informations fournies par le musée
En 1877, le baron hollandais Tinco Lycklama à Nijeholt fait don de sa collection à la ville de Cannes et initie le premier musée d’antiquités et d’ethnographie regroupé sous le vocable « Musée Lycklama ». Y sont présentés des objets collectés entre 1865 et 1870 au cours de ses voyages à travers l’Europe orientale et le Moyen-Orient. La collection prend sa dimension définitive lorsque Lycklama ajoute au fonds d’origine une série d’objets ethnographiques remarquables, rapportés par Edmond de Ginoux de La Coche de ses séjours en Océanie et aux Amériques entre 1843 et 1850. La collection, structurée autour de la donation Lycklama, s’est enrichie au moyen d’acquisitions raisonnées au XXe siècle. Le Musée des explorations du monde est aujourd’hui l’un des rares musées consacrés aux arts non-occidentaux dans le sud-est de la France. Il propose au visiteur un parcours qui évoque l’ouverture sur le monde, le voyage et l’orientalisme : Asie, Amérique (du Nord et précolombienne), Océanie, Afrique, Antiquités méditerranéennes, Moyen-Orient, peinture orientaliste, collection qajare, Beaux-Arts, photographie ancienne et contemporaine, peinture provençale, instruments de musique du monde… Chaque année, des expositions temporaires permettent de faire sortir les chefs-d’œuvre des réserves et de multiplier les regards sur le monde et ses cultures. Les premiers versements réalisés sur Joconde – POP montrent la diversité de la collection cannoise.
Informations fournies par le musée
Doyen des musées de Guyane, le musée Alexandre-Franconie est situé dans le centre historique de la ville de Cayenne, près de la place des Palmistes. Créé par arrêté du gouverneur du 18 septembre 1901, il est inauguré le 15 octobre suivant, lors de la fête communale, au rez-de-chaussée d’une ancienne maison de commerce et d’habitation achetée par la colonie en 1885 à la famille Franconie pour les besoins de l’administration.
L’établissement a dès sa création une vocation généraliste de conservation et d’exposition de la bio- et géodiversité, des cultures matérielles, des productions artistiques et de l’histoire de Guyane. Grâce à plusieursextensions, les expositions permanentes et temporaires se développent aujourd’hui sur deux niveaux et près de 600 m², l’un consacré à l’histoire naturelle, le deuxième à la diversité culturelle. La majorité des objets et spécimens des collections patrimoniales - plus de dix mille - concerne l’histoire naturelle. Les domaines culturels phares sont l’histoire, l’archéologie, l’ethnographie et les beaux-arts.
Les collections du musée sont également valorisées dans deux autres lieux patrimoniaux à Cayenne, dont le musée est gestionnaire : la maison familiale de Félix Eboué, aménagée en centre d’interprétation du parcours du grand homme ; le pavillon d’entrée de l’ancien hôpital Jean-Martial, dénommé « Espace Joseph-Ho-Ten-You », accueillant une exposition préfiguratrice de la Maison du Carnaval. Enfin, depuis 2020, la Maison des Cultures et Mémoires de Guyane, centre de conservation et d’étude mutualisé des collections patrimoniales de la Collectivité Territoriale de Guyane, accueille les ateliers de conservation et de taxidermie et les réserves du musée.
Le premier versement de notices d’œuvres sur Joconde illustre les domaines de conservation principaux. Les collections naturalistes seront prochainement valorisées grâce au réseau national des collections naturalistes (Recolnat), dont la Collectivité Territoriale de Guyane est membre depuis 2022. Les versements à venir révéleront davantage la richesse culturelle et patrimoniale de Guyane.
Le musée Émile Chénon est installé dans un logis construit à la fin du XIVème et début du XVème siècles, protégé au titre des monuments historiques. Ce joyau architectural ainsi que son jardin de type médiéval constituent un écrin privilégié pour les collections du musée. Inauguré officiellement en 1963, le musée expose les objets découverts sur le site archéologique de Mediolanum oppidum gaulois puis agglomération gallo-romaine. Ces collections se sont constituées au fur et à mesure des fouilles archéologiques menées à Châteaumeillant. Suite à la mise au jour, en 2012, d’un trésor exceptionnel en bronze d’époque gallo-romaine, le musée est rénové et rouvre ses portes en 2015 avec une muséographie moderne et pédagogique. Ce nouveau parcours s’articule autour des trois grandes caractéristiques de la ville antique : les caves à amphores, l’oppidum et ses remparts successifs et enfin les trésors découverts au fond des puits antiques. Il suit un cheminement chronologique de l’âge du Fer à l’époque gallo-romaine retraçant ainsi 500 ans de l’histoire de Châteaumeillant. Le versement des notices sur la base Joconde fait suite au récolement et à une nouvelle campagne de numérisation des collections. Cette mise en ligne apportera une meilleure visibilité des collections du musée auprès du public et des chercheurs et contribuera également à la diffusion des savoirs et des connaissances relatives à l’archéologie et l’antiquité.
Informations fournies par le musée
La ville de Denain est entrée dans l’Histoire suite à la victoire des troupes du Maréchal Villars en 1712 sur celle de l’alliance autro-hollandaise lors de la guerre de succession d’Espagne. Située au cœur du bassin industriel du Nord, la ville devient au XIXè siècle un centre majeur avec la découverte du charbon et l’installation des forges et aciéries. Le musée d’Archéologie et d’Histoire Locale témoigne ainsi de cette riche histoire.
Dans l'ombre de Valenciennes, l’Athènes du Nord, et sa pléiade de Prix de Rome, Denain n'en est pas pour autant dénuée de vie artistique. La Mutuelle Artistique œuvre dès 1936 et organise des manifestations culturelles. Son action amène à la création du musée qui ouvre en 1947 avec des collections d’histoire locale centrées sur le poète et mineur de fond Jules Mousseron et son cercle artistique, et avec des œuvres issues de la mission ethnographique des peintres Boris Taslitzky et Jean Amblard mandatés par George-Henri Rivière pour dessiner la vie ouvrière au sortir de la guerre. À partir de 1960 et jusqu’en 1980, les découvertes archéologiques locales ont enrichi ces collections.
Ce premier versement sur Joconde, effectué avec le soutien de l’association Musenor, met en valeur une partie du cœur de la collection, à savoir le riche fonds Beaux-arts lié aux représentations de la Révolution Industrielle, de l’ouvrier au travail et des paysages du bassin minier et sidérurgique. D’autres versements suivront visant à valoriser ces thématiques qui sont au centre de ses préoccupations.
Informations fournies par le musée (Germain Hirselj)
Au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges et aujourd’hui installé dans une ancienne demeure canoniale à l’entrée de Guebwiller, le musée Théodore Deck et des pays du Florival a été fondé en 1933 par Charles Wetterwald (1872 - 1972), un passionné d’histoire locale. Regroupant à ses débuts les objets et œuvres d’art liés au patrimoine religieux, textile, viticole et sportif de la vallée du Florival, la collection s’est progressivement enrichie à partir des années 1980 d’un ensemble de faïences d’art de Théodore Deck, grâce à l’engagement du conservateur bénévole Julien Schweizer, dont la volonté était de mettre en avant les créations du céramiste né à Guebwiller en 1823 et au talent reconnu à l’international. 585 pièces exécutées par Théodore Deck ou issues de sa collaboration avec des peintres et sculpteurs sont actuellement conservées au musée et le parcours permanent offre au visiteur une immersion dans les différents courants des arts décoratifs de la seconde moitié du XIXe siècle. Le bicentenaire de la naissance de Théodore Deck ayant lieu en 2023, la mise en ligne des collections fait écho à l’exposition temporaire qui débutera en octobre et qui retracera le chemin de l’artiste depuis sa jeunesse en Alsace jusqu’à sa nomination à la direction de la Manufacture nationale de Sèvres, en passant par le succès parisien de sa fabrique, qu’il gérait avec ses frères et sœurs. La participation du musée guebwillerois au catalogue collectif des collections des Musées de France a également pour objectif d’accroître la connaissance de l’œuvre de Théodore Deck auprès du grand public, des passionnés, des institutions muséales, des étudiants et des chercheurs.
Informations fournies par le musée
Le musée Christian Dior est l’un des rares « Musée de France » consacré à un couturier. Il prend place dans la villa Les Rhumbs, maison d’enfance de Christian Dior à Granville, et présente chaque année une exposition thématique autour des créations de Christian Dior et de ses successeurs.
C’est le succès de l’exposition "Christian Dior, l’autre lui-même", conçue en 1987 par le conservateur Jean-Luc Dufresne (1949-2010) et présentée au musée d’Art moderne Richard Anacréon à Granville, qui décidera la Ville de Granville et les partenaires privés, en premier lieu le groupe LVMH, à transformer la maison d’enfance du couturier en musée.
La création de l’association Présence de Christian Dior en 1991 entraine la création d’un fonds, constitué d’abord de dons de proches du couturier, en particulier ses deux sœurs, Catherine et Jacqueline, et de collaborateurs, puis d’achats de la Ville et de dons suscités par l’association jusqu’en 1995. C’est cette dernière qui conduit ensuite les achats avec les aides de Dior Couture et de Parfums Christian Dior - ainsi que du groupe LVMH, de la Ville de Granville, et du Fonds régional d’acquisition pour les musées (FRAM).
Le musée d’art et d’histoire est riche de plus de 15 000 objets : cartes postales, instruments de navigation, coiffes brodées du XIXe siècle mais aussi jouets ou cabines de plages. Ses collections racontent l’histoire de la ville, la pêche à Terre-Neuve, la guerre de course et la naissance du tourisme balnéaire. Le musée conserve également d’importantes collections de beaux-arts du XIXe siècle (Courbet, Lapito, Roullet, Maurice Orange…).
Le musée d’art et d’histoire de Granville a été créé par la Ville en 1885. Il bénéficie de dépôts de l’Etat et de dons importants dès l’origine. En 1936, les collections sont redéployées au sein du Logis du Roi, monument emblématique surplombant la Ville à l’entrée des remparts. En 1949, sous la direction de l’historien local Charles Julliot de La Morandière, le musée devient musée du Vieux Granville et présente un parcours d’ethnographie régionale. Il s’agrandit progressivement, en restant axé sur les arts et traditions populaires. En 2014, il prend le nom de musée d’art et d’histoire de Granville.
Depuis 2015, le Logis du Roi est fermé au public pour des raisons de sécurité. Etudes et travaux se poursuivent dans la perspective d’une réouverture avec un parcours de visite renouvelé (pas de date à ce jour). La valorisation des collections se traduit par une active politique de prêts et l’enrichissement des bases de données, au fur et à mesure du chantier des collections. La participation à Joconde en est un signe supplémentaire.
Informations fournies par le musée
Guise, Familistère de Guise
Le Familistère de Guise est situé dans le département de l’Aisne, dans le faubourg de la ville de Guise où Jean-Baptiste André Godin transféra ses ateliers de fabrication d’appareils de chauffage et de cuisson en fonte de fer en 1846, et où il créa à partir de 1859 le Familistère, un lieu d’habitation collective inspiré du phalanstère imaginé par le philosophe Charles Fourier (1772-1837). Classé monument historique depuis 1991, le Familistère fait l’objet d’une revalorisation dans le cadre du programme Utopia depuis 2000. Le musée est créé à cette occasion. Il reçoit l’appellation "Musée de France" en 2003. Il est géré par le Syndicat mixte du Familistère Godin, qui réunit le Département de l’Aisne et la Ville de Guise.
Se déployant dans différents bâtiments du Familistère (Palais social, économats, buanderie-piscine, théâtre) le musée du Familistère est un musée de site, un musée habité, où sont conservées, étudiées et présentées au public des collections liées à l’histoire sociale et industrielle des lieux : appareils et accessoires produits par la Société du Familistère ou par des firmes concurrentes, catalogues et affiches, objets ayant appartenu et servi aux Familistériens, témoignages de ces derniers, collections personnelles de Jean-Baptiste André Godin et de sa collaboratrice et compagne Marie Moret, photographies témoignant de l’histoire du Familistère. Ce musée est également un lieu de référence sur les utopies concrètes.
Le premier versement effectué sur Joconde est constitué d’une sélection représentative des collections du Familistère de Guise, dont les notices détaillées sont accessibles sur le site Internet du musée.
Informations fournies par le musée
Ouvert au public depuis 1984, le Centre Historique Minier a pour mission de conserver et valoriser la culture minière. Installé sur une ancienne fosse d’exploitation du charbon, il est le plus grand musée de la mine en France. Site remarquable du Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, il est également Monument historique. Tous les bâtiments de la fosse sont ouverts au public et abritent de grandes expositions thématiques (géologie, histoire, ethnologie…), complétées par un parcours dans 450 mètres de galeries et de chantiers d’exploitation du charbon reconstitués à l’identique.
Les collections sont constituées d’éléments d’une grande variété : machines, outils, maquettes, objets de la vie quotidienne, œuvres d’art, fossiles houillers, etc. Cependant tous possèdent comme dénominateur commun d’être liés au monde de la mine.
Le premier versement sur la base Joconde concerne un échantillon représentatif de cette diversité et met en avant des pièces majeures de la collection provenant des Houillères ainsi que des acquisitions récentes. De futurs versements seront programmés régulièrement afin d’offrir au plus grand nombre un accès privilégié à ce riche patrimoine industriel.
Informations fournies par le musée
Installé depuis 1996 dans le bâtiment de l’ancien Hôtel-Dieu aux pieds de la Collégiale gothique, le musée de Mantes-la-Jolie a été intégralement refait à neuf en 2019. Bien que le musée existe depuis peu dans sa forme et à son emplacement actuels, l’histoire des collections qu’il conserve remonte au XIXe siècle. Simultanément aux travaux de restauration menés sur la Collégiale, l’architecte mantais Alphonse Durand constitue à partir de 1851 un dépôt lapidaire en partie exposé au musée aujourd’hui. En 1909, la ville reçoit deux importants dons : la collection d’Auguste Mesnil, instituteur passionné d’Histoire naturelle et d’archéologie nationale, et celle du voyageur Victor Duhamel, qui fait bâtir à Mantes-la-Jolie un pavillon reprenant le style Louis XVI pour présenter sa collection à vocation universelle.
Aujourd’hui, la moitié du parcours permanent est consacrée au peintre Maximilien Luce (1858-1941) grâce à l’important don de son fils Frédéric Luce en 1971, complété depuis par de nombreuses acquisitions. Avec près de 380 peintures, dessins, estampes, coffrets ou céramiques, le musée de l’hôtel-Dieu conserve la plus importante collection consacrée à cet artiste.
Ce premier versement permettra de mettre à l’honneur l’œuvre de Maximilien Luce, peintre néo-impressionniste et anarchiste proche des grands artistes de son temps comme Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro, Henri-Edmond Cross mais aussi du critique d’art Félix Fénéon.
Informations fournies par le musée
L’histoire du musée Ziem est intimement liée à la personne de Félix Ziem (Beaune, 1821- Paris, 1911). Celui que l’on nommera le « peintre de Venise », découvre Martigues en 1839 et y installe un atelier en 1860. Il y séjournera régulièrement jusque dans les années 1890.
En 1908 il offre à la ville, « à titre d’hommage à la Cité dans laquelle il avait vécu de nombreuses années de sa vie d’artiste », l’une des esquisses de l’œuvre commandée par l’État Toulon, visite du Président Loubet aux escadres française et italienne en avril 1901. Dès lors, la municipalité décide d’édifier un « temple de l’Art » destiné à « perpétuer la mémoire de Ziem ». Cette volonté s’accompagne du désir de compléter cette création par la présentation des peintres provençaux. À cette fin, le maire met en place un appel aux dons auquel répondent cinquante-sept artistes. Le musée ouvre ses portes en 1910.
Depuis il s’est déplacé trois fois et s’est enrichi de nombreux autres types de collections : archéologie, ethnographie et art contemporain y ont trouvé leur place. À raison de trois expositions annuelles, dont deux basées sur le fonds permanent depuis plus de quinze ans, l’établissement valorise l’ensemble de ses départements tout en continuant à conserver une place privilégiée aux œuvres de Félix Ziem.
Les versements sur Joconde s’inscrivent dans cette volonté forte de rendre accessibles les collections mais aussi de montrer toute leur richesse.
Informations fournies par le musée
Le Palais de Carnolès s’inscrit tôt dans le paysage urbain et agricole de la ville de Menton. Honoré II de Monaco (1597-1662) fait planter des orangers et construire un modeste casin sur un terrain appartenant à la famille Grimaldi depuis le XIVème siècle. En 1717, son arrière-petit-fils, Antoine Ier, décide d’y faire bâtir une résidence d’été dans l’esprit classique du Trianon de Versailles. Il se tourne vers les architectes de la cour, Robert de Cotte et Jacques V Gabriel. La construction de la résidence principale et de ses dépendances débute dès 1725.
En 1896, le nouvel acquéreur, le Dr E. P. Allis confie la restructuration des appartements du prince à l'architecte danois H.G. Tersling qui a travaillé au Casino de Monaco avec Charles Garnier. En 1977, la Ville de Menton propriétaire du domaine inaugure le musée des beaux-arts en présence de la Princesse Grace de Monaco, pérennisant ainsi le lien historique unissant les deux communes. Entouré d’un jardin d’agrumes remarquables, le site présente une réelle harmonie entre nature, architecture et richesse des collections. Une première sélection d’œuvres est versée sur Joconde afin de refléter les collections de Menton issues de grandes donations et acquisitions qui permettent de couvrir l’histoire des arts du XIVème au XXème siècle européen, mais laisse également une part importante aux arts d’extrême orient. La présence sur la base Joconde des collections de ce musée en cours de restauration, fermé depuis plusieurs années, revêt une importance particulière. Elle permet leur valorisation et une large ouverture auprès du public et des professionnels.
Informations fournies par le musée
Alors que Jean Cocteau termine la décoration de la salle des mariages, en septembre 1957, le Maire Francis Palmero lui propose un musée dans le Bastion, fortin du XVIIème siècle, situé sur la digue. À partir de janvier 1959, l’artiste considère ce musée comme représentatif de ses expérimentations artisanales. Outre le fait qu’il pose un décor de mosaïques de galets in situ, il sélectionne des dessins, des pastels, des peintures et des poteries. Il travaille à ce projet jusqu’à sa mort le 11 octobre 1963. Son légataire Edouard Dermit participe à la fin de l’aménagement du musée selon les directives et les dessins qu’il a laissés. Le musée est inauguré le 30 avril 1966. En décembre 2003, Séverin Wunderman, riche collectionneur américain d’œuvres de Jean Cocteau, décide de faire une donation à la ville d’une partie de sa collection à la condition de la création d’un nouveau musée. L’acte de donation est signé le 27 juin 2005. En 2006, les deux collections comptent 1190 œuvres de Jean Cocteau. Le fonds du donateur est également constitué de 270 œuvres de ses amis artistes parmi lesquels Christian Bérard, Jean Hugo et Bernard Buffet. Il comprend aussi 178 photographies originales relatives au poète et 360 œuvres liées à Sarah Bernhardt. En novembre 2011, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman ouvre ses portes. Depuis sa fermeture en 2018, les expositions temporaires se poursuivent au musée du Bastion. La mise en ligne de la collection est évidente car le musée est la seule source représentative de l’œuvre de Jean Cocteau.
Informations fournies par le musée
Le musée Girodet propose de pénétrer au cœur de l’œuvre et de la vie d’Anne-Louis Girodet (Montargis, 1767-Paris, 1824). La collection rend compte de son parcours, de ses premiers essais néoclassiques dans l’atelier de David aux œuvres de la maturité, pour certaines annonciatrices du romantisme. Elle témoigne des grands moments de sa carrière, de ses talents de dessinateur et de son goût pour la poésie. Les portraits peints des membres de la famille du Dr Trioson, tuteur puis père adoptif de l’artiste, constituent un ensemble fort, autour de la Leçon de géographie.
La présentation du fonds d’atelier d’Henry de Triqueti, sculpteur romantique (Conflans-sur-Loing,1803 – Paris, 1874), complète la visite : modèles préparatoires pour les portes de l’église de la Madeleine, à Paris, plâtre original du gisant de Ferdinand d’Orléans, objets d’art décoratif... Le musée conserve également un ensemble exceptionnel de plâtres préparatoires pour la décoration de la chapelle du prince Albert de Saxe-Cobourg, au château de Windsor, à la demande de la reine Victoria.
Une belle collection de peintures anciennes (Zurbarán, Solimena) et de sculptures enrichit le parcours.
Ce premier versement de notices d’œuvres sur Joconde est un témoignage de la capacité de rebond du musée, 6 ans après l’inondation qui a touché 85% de ses collections, et la preuve du travail de fond de l’équipe pour étudier, valoriser et rendre accessible à tous des œuvres sauvées des eaux par les conservateurs-restaurateurs.
Informations fournies par l'équipe de conservation du musée
Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français dédié à un mouvement artistique : l’Art nouveau dont la capitale lorraine était un foyer très dynamique avec des acteurs tels qu’Émile Gallé, Victor Prouvé, Louis Majorelle, Antonin Daum, Jacques Gruber….
Situé dans l’ancienne propriété du plus important mécène et collectionneur de l’École de Nancy - Eugène Corbin - il ouvre ses portes au public en juin 1964. Ce dernier a fait don en 1935 d’un ensemble emblématique de l’Ecole de Nancy. Le musée, par la mise en situation d’œuvres, restitue l’atmosphère de l’époque 1900, sans en être une reconstitution stricte. Les meubles, les objets d’art, le verre, la céramique… témoignent de la diversité des techniques déclinées par les artistes de l’École de Nancy. Des pièces uniques et de prestige sont visibles, réalisations d’une grande virtuosité technique, mais également des objets édités et diffusés à un grand nombre d’exemplaires. Le jardin propose de nombreuses variétés végétales conçues par les horticulteurs nancéiens contemporains de l’École de Nancy. Il est inscrit depuis 1999 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Ce premier versement permet de mettre en valeur des pièces acquises grâce au soutien du Fonds régional d’acquisition des musées (État et Région). Il sera suivi de celui d’œuvres ayant bénéficié du « programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels » (PNV) du ministère de la Culture et des 60 œuvres publiées dans notre dernier catalogue des collections afin de les rendre accessibles à tous.
Informations fournies par l'équipe de conservation du musée
Le musée des arts asiatiques est géré par le Département des Alpes-Maritimes. En 1987, le Département a commandé à Kenzô Tange, lauréat du prix Pritzker, la conception d’un musée dévolu aux arts et aux cultures asiatiques, inauguré en octobre 1998. Implanté sur un site d’exception, érigé sur un lac artificiel à l’intérieur d’un parc floral de sept hectares, le long de la célèbre Promenade des Anglais, ce chef-d’œuvre de marbre blanc crée un véritable pont entre les cultures et les sensibilités des continents européen et asiatique. Il s’adresse à un large public et le confronte à des pièces de haute qualité, caractéristiques de l’esthétique des cultures évoquées. La grande originalité du lieu, plus proche d’un concept extrême-oriental qu’occidental, réside dans une volonté de s’appuyer sur des collections anciennes, servant de références historiques et esthétiques, pour exprimer la pérennité des traditions jusque dans les créations les plus modernes. Stylisme et design, meubles et objets usuels appartenant, sans critères de dates, aux arts du quotidien, ainsi que pièces ethniques remarquables, témoignent de la diversité des cultures asiatiques et de la qualité d’un savoir-faire sauvegardé, le plus souvent, par une pratique ininterrompue.
La participation du musée des arts asiatiques au catalogue collectif des collections des musées de France s’inscrit dans l’ambition, portée par le Département des Alpes-Maritimes, de faire connaître ses collections au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée (Adrien Bossard, conservateur du patrimoine, directeur du musée départemental des arts asiatiques à Nice)
Créé en 1921 à l’initiative de la Commission Municipale d’Archéologie et d’Histoire locale, le musée du Vieux Nîmes, est situé dès son origine dans l’ancien palais épiscopal de la ville. Il est constitué à sa création de fonds abondants et variés : textiles et documents concernant l'activité industrielle et économique de la ville, du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, iconographie de la ville et du département (peintures, dessins, gravures, plans, photographies…), mobilier, céramique régionale, objets du quotidien.
A partir des années 1950, le musée s'enrichit de deux salles consacrées aux collections taurines, permettant d'évoquer les traditions liées au taureau, qu'il s'agisse de l'élevage et des jeux taurins en Camargue comme de l'organisation de corridas dans les arènes de Nîmes. Ces collections ont depuis 2002 été installées dans un nouveau musée, le Musée des Cultures Taurines - Henriette et Claude Viallat. Le musée regroupe aujourd’hui environ 30 000 œuvres mettant en valeur l’histoire de la ville de Nîmes et son territoire, notamment liée à l’industrie textile.
La participation du musée à Joconde s’inscrit dans le cadre du projet de rénovation actuellement en réflexion et l’ambition, portée par la ville de Nîmes, de faire connaître ses collections au plus grand nombre.
Ce premier versement illustre la richesse et la diversité de la collection au travers d’une sélection de pièces phares du parcours permanent et de l’exposition temporaire consacrée au 150 ans du musée réalisée en 2021-2022. Les prochains versements mettront en valeur différentes typologies d’œuvres, à commencer par le textile, avec la collection de gilets d’hommes, caractéristique de la mode masculine des trois derniers siècles.
Informations fournies par le musée
Le musée Charles Friry est un des rares « Musées de France » conservant un atelier d’artiste qui est aussi une maison de collectionneur et d’artistes. Il est labellisé depuis novembre 2021 « Maison des illustres ». Il prend place dans deux maisons du chapitre des nobles dames de l’abbaye de Remiremont construites vers 1750 et où le collectionneur s’est installé en 1821. Le lieu présente, dans des décors préservés, les collections du magistrat, avocat, conseiller municipal, maître de forge, érudit, peintre et graveur Charles Friry (1802-1881). Friry a rassemblé dans cette maison à partir de 1828 des peintures, sculptures, gravures, mobilier, objets d’art du Moyen Age au début du XIXe siècle. Le musée conserve des gravures de Rembrandt, Goya, Callot, le portrait de la fameuse Mauresse de Moret, fille métisse présumée de Louis XIV. Le musée expose aussi l’atelier du petit-fils de Friry, le peintre paysagiste, graveur, relieur, enlumineur, photographe, marqueteur, Pierre Waidmann (1860-1937) - né dans cette maison qui présente son travail entre 1880 et 1932. Le musée donne à voir depuis 2020 la pharmacie, classée au titre des Monuments Historiques, de l’Hôpital Sainte-Béatrix de Remiremont avec la plus importante réunion de pots en faïence de Lunéville aux armes de Stanislas, duc de Lorraine. La valorisation sur POP permettra de mieux faire connaître les collections du musée et ses importants enrichissements avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées (État et Région Grand Est).
Informations fournies par le musée
Le musée archéologique de l’Oise est ouvert depuis 2011. Il a reçu l’appellation « musée de France » dès sa création. Il est situé à proximité immédiate d’un site archéologique dont provient la majorité de ses collections, le théâtre antique de Vendeuil-Caply, classé au titre des monuments historiques, et qui appartient au département de l’Oise. Cet édifice est aujourd'hui le seul témoin visible d'une occupation antique d'une grande densité d'habitats et de monuments publics.
Géré par la communauté de communes de l'Oise picarde (CCOP), le musée conserve et valorise les découvertes réalisées sur le site et sur l'ensemble du territoire, de la Préhistoire au Moyen-âge. On peut ainsi retrouver dans les collections l’ensemble du spectre des matériaux que l’on trouve dans une agglomération antique : céramique, lapidaire, verrerie, métaux et matériaux organiques. Le musée conserve également des vestiges issus de deux nécropoles proto-médiévales fouillées à Vendeuil-Caply. Enfin, des artefacts paléolithique et néolithique provenant principalement de prospections pédestres dans la région complètent les collections.
Réalisé en collaboration avec l’association Musenor, ce premier versement sur Joconde met en lumière plusieurs objets emblématiques du musée. De futurs versements suivront, rendant visibles les collections du musée et participant ainsi à l’enrichissement et la diffusion des connaissances non seulement sur le site et sur le territoire mais également de manière plus générale sur l’histoire antique.
Informations fournies par le musée
Musées intégrés en 2022
C’est en 1838, à la suite de l’acquisition du fonds Fauris de Saint Vincens par la Ville d’Aix en 1821, que le musée d’Aix-en-Provence est inauguré dans l’ancien prieuré de l’Ordre de Malte. Il faudra attendre 1949 pour qu’il prenne le nom de l’un de ses plus généreux bienfaiteurs, François Marius Granet, un siècle après le legs de son fonds d’atelier et de ses collections à sa ville natale. Musée de collectionneurs, le musée Granet s’est enrichi grâce aux achats, dons et legs d’ensembles constitués à l’origine par les parlementaires de Provence. Intégralement restructuré entre 2003 et 2006, ce sont près de 750 œuvres qui y sont exposées, allant des peintures des écoles italienne, flamande, hollandaise, provençale et de l’école française du XVIIe au XIXe siècle, à des sculptures de figures mythologiques et hauts dignitaires aixois et des pièces celto-ligures provenant du site archéologique d’Entremont. Également ouvert à l’art moderne grâce aux dépôts de la collection Philippe Meyer et de l’État qui ont permis l’entrée de l’œuvre de Paul Cézanne, le musée affirme son ouverture à l’art des XXe et XXIe siècles avec le dépôt de la fondation Jean et Suzanne Planque présenté dans la chapelle des Pénitents blancs depuis 2013.
Avec ce premier versement le musée Granet souhaite mettre en lumière sa précieuse collection d’antiquités égyptiennes ainsi que des œuvres présentées dans son nouvel accrochage qui interroge les genres en peinture. Progressivement, de nouvelles notices concernant le fonds ancien et les récentes acquisitions seront versées pour alimenter la plateforme ouverte du patrimoine et ainsi rendre ses collections accessibles à tous.
Informations fournies par Naïs Alziary, chargée des collections au musée Granet
Le musée Alésia – Centre d'interprétation, propriété du Conseil départemental de la Côte-d'Or, est chargé de la conservation et de la valorisation du site d'Alésia et de ses collections archéologiques et ethnologiques. La collection « Musée de France » tire son origine du fonds constitué par la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois. Le mobilier découvert est rassemblé dans un musée ouvert au cœur du village d'Alise-Sainte-Reine entre 1910 et 2006. Dans ce fonds exceptionnel s'imbrique le dépôt du Musée municipal d'Alise-Sainte-Reine, constitué des collectes de Napoléon III et des fouilles du Commandant Espérandieu. L'ensemble a été officiellement déposé au Département de la Côte-d'Or en 2011.
En 2017, l'appellation « Musée de France » attribuée au Musée Alésia en 2003, a été étendue au centre d'interprétation actuellement animé par la Société publique locale MuséoParc Alésia. Après la fermeture de l'ancien musée de la Société des Sciences en 2006, la collection a bénéficié d'un premier chantier des collections et une partie des objets a été restaurée. Les pièces majeures sont à nouveau présentées au public depuis juillet 2021, dans le parcours permanent du centre d'interprétation.
Les objets présentés sur Joconde ont été choisis pour illustrer la diversité de la collection et témoigner de l'occupation du site sur le temps long. Ils viennent ainsi enrichir le paysage aux mille visages des Musées de France.
Informations fournies par le musée
Annexé à la bibliothèque publique, le musée d’Apt est créé en 1865, afin de mettre fin à la dispersion des vestiges archéologiques découverts en pays d’Apt. Après cinquante ans de fermeture, il rouvre en 1952. Sa collection archéologique augmente alors rapidement grâce aux dons et dépôts, enrichis par des découvertes locales. Installé dans de nouveaux locaux en 1972, la collection est alors complétée par plusieurs dons et dépôts relatifs à l’histoire locale : ex-voto peints, donatifs et apothicairerie de l’hôpital, faïences contemporaines.
Au milieu des années 1980, le musée oriente sa politique d’acquisition vers le patrimoine industriel local, en voie de disparition progressive. En 30 ans, plus de 8 000 objets, témoins des industries de l’ocre, de la faïence et du fruit confit, entrent alors dans les collections. En 2003, cette collection donne naissance au musée de l’Aventure industrielle.
Composée de 26 000 objets, la collection couvre une période allant de la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine et retrace l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt.
Le premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif de cette collection. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le musée d’Apt s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser la collection aptésienne et de la rendre accessible au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Au sein d’un écrin exceptionnel unissant le classicisme du XVIIe siècle à l’extrême modernité d’une architecture de verre et d’acier, le musée de l’Ardenne fait découvrir l’histoire d’un territoire singulier aux marges de la France et déjà ouvert sur la Belgique. Ses collections retracent une histoire où, dès la nuit des temps, on exploite le bois, l’ardoise et le fer.
Elles comptent, parmi elles, les premières œuvres d’art de la préhistoire sur du schiste gravé, les traces de villages gaulois, les armes de la manufacture de Charleville (1680-1836) qui contribuèrent à l’indépendance des Etats-Unis.
Une large section est aussi consacrée à la fondation et au développement de la cité idéale, ville nouvelle, voulue et conçue par Charles de Gonzague, duc de Nevers au XVIIe siècle. De nombreux artistes comme Eugène Damas (1844-1899) ont aussi su sublimer la beauté des paysages et de la vie rurale au temps suspendu.
Le choix du premier versement dans la base Joconde s’est porté sur les beaux-arts afin de contribuer à la valorisation et à la découverte des « petits maitres » avec dans un premier temps Eugène Damas qui sera suivi par Jean-Baptiste Couvelet (1772-1830). Les collections de marionnettes, conservées dans la capitale mondiale des arts de la marionnette qu’est Charleville-Mézières, les suivront.
Le musée de l’Ardenne s’engage à verser ses collections sur la base Joconde afin de faire rayonner ses collections et de dynamiser sa politique de prêts auprès des autres musées de France.
Informations fournies par le musée
Le Carroi, musée d’arts et d’histoire à Chinon est un établissement de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Musée de France, il conjugue désormais son destin avec celui de l’écomusée du Véron à Savigny-en-Véron. Les collections sont présentées dans un hôtel particulier du 15ème siècle, bâtiment historique où se sont tenus les États Généraux en 1429. En 2023, une partie des collections intègrera le nouveau parcours d’exposition de l’écomusée du Véron. Ce musée expose des collections en lien avec l’histoire de Chinon ainsi que des œuvres peintes, mobilières et sculptées illustrant les courants artistiques régionaux, nationaux et extra-européen. Il a été créé en 1905 par la Société d’Histoire de Chinon Vienne et Loire. L’association n’a cessé d’enrichir la collection jusqu’en 2009, date à laquelle elle délègue la gestion scientifique et administrative à la commune de Chinon puis à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. L’association a fait don de sa collection à la collectivité en 2021. Le musée conserve des trésors nationaux comme la Chape de Saint-Mexme, samit de soie et d’or de la fin du XIe siècle, ou Le portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix, ainsi qu’un dépôt du Musée de Cluny, musée national du Moyen Âge. Ce premier versement sur Joconde, via POP, la plateforme ouverte du patrimoine, permet de mettre en valeur les artistes qui se sont imprégnés du territoire. Il sera suivi de versements thématiques permettant de valoriser la collection du musée à destination d’un public professionnel et du grand public.
Informations fournies par le musée
Installé dans les anciens bains-douches municipaux de style Art déco, le musée de la céramique et de l’ivoire de Commercy présente l’une des plus remarquables collections françaises d’ivoires du 17e au 19e siècles ainsi qu’un ensemble de faïences et de porcelaines des 18e et 19e siècles.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
La forge d’Etueffont est un musée de site ouvert au public depuis 1981, lors de son acquisition par la commune. Ses bâtiments datent du XVIIIème siècle et ont été modifiés et agrandis aux XIXème et XXème siècles. En 1992, la forge et l’atelier de charronnage dotés de leur outillage d’origine, la maison avec ses pièces d’habitation (chambres, cuisines, salle à manger, cellier, grenier) ainsi que les espaces agricoles (fenil, hangar, étable) sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le musée retrace la vie et le travail d’une lignée de quatre forgerons maréchaux-ferrants, les Petitjean, qui ont occupé les lieux de 1843 à 1977.
Les collections de la Forge-musée sont constituées du matériel de travail et d’une partie du mobilier ainsi que de très nombreux objets et accessoires donnés au musée au fil des ans par les bénévoles de l’association, des particuliers, des voisins, des passionnés de forge, de maréchalerie et d’histoire locale.
La mise en ligne des objets majeurs du musée fait suite au récolement décennal des 1274 objets, réalisé en 2021, en partenariat avec le Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté. Cela constitue pour le musée une nouvelle étape visant à promouvoir et diffuser ses collections au-delà de son territoire.
Informations fournies par le musée
Situé dans le cœur historique de Lille, le musée de l’Hospice Comtesse est installé dans l’ancien hôpital Notre-Dame fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, transformé en hospice après la Révolution Française. Ce lieu emblématique de la ville de Lille, classé monument historique en 1923, est l’un des derniers témoignages lillois de l’action des comtes de Flandre ayant pour vocation spiritualité et hospitalité.
La cour d’honneur du musée offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections sont réparties dans le bâtiment de la communauté, ancien lieu de vie des Augustines. Au rez-de-chaussée, des salles d’ambiance rappellent tout autant la vocation hospitalière que l’intimité d’une maison flamande des siècles passés. A l’étage, les collections présentées dans l’ancien dortoir retracent les grandes lignes de l’histoire de Lille du XVIe siècle à la Révolution française. On y découvre notamment une série de portraits des comtes de Flandres et des Ducs de Bourgogne, les tableaux de Louis et François Watteau : les Watteau de Lille ainsi que les précieux globes du cartographe vénitien Vincenzo Coronelli.
Les acquisitions du musée ont été réalisées en fonction de ses projets depuis sa création en 1962 : d’abord comme musée d’ethnographie et de folklore de la région Nord-Pas-de-Calais puis comme musée consacré à l’art et à l’histoire de Lille.
Avec ce premier versement, le Musée de l’Hospice Comtesse souhaite faire découvrir la diversité de ses collections et permettre leur plus grande diffusion. Il a été effectué avec le concours de l’Association des Conservateurs du Nord en lien avec une diffusion sur leur site « Musenor ».
Des versements réguliers seront effectués en fonction de l’avancée des récolements.
Informations fournies par le musée
Situé au cœur de la cité royale de Loches, le Musée Lansyer est l’ancienne demeure d’Emmanuel Lansyer, peintre paysagiste de la seconde moitié du 19e siècle. A sa mort en 1893, cet artiste inclassable, à la fois classique et moderne, a légué à la Ville de Loches l’ensemble de son œuvre (tableaux, dessins, études…) mais aussi une collection asiatique particulièrement riche et de nombreux objets personnels. Le Musée Lansyer ouvre en 1902 ; plus d’un siècle plus tard, en 2021, des travaux d’aménagement sont menés, faisant du site un lieu de découvertes, de pédagogie et de poésie.
Au rez-de-chaussée, dans l’ambiance reconstituée d’une maison du 19e siècle, les œuvres sont présentées par thèmes : les rochers, les arbres, le Lochois, la mer, les habitants… autant de sujets chers à Lansyer, qui les a peints avec une évidente passion. Des installations sensorielles permettent d’aborder ces thématiques sous un autre angle : toucher l’écorce d’un arbre, sentir l’odeur du foin, réfléchir sur la notion de cadrage…
À l’étage, dans la grande salle, on en apprend davantage sur son parcours, sur sa détermination à devenir peintre, mais aussi sur sa vie d’artiste et de collectionneur. Enfin, installée en fin de parcours, la salle de découvertes, dédiée à tous les publics souhaitant une approche ludique et sensorielle du musée, propose de nombreux supports pédagogiques pour mieux comprendre la technique et l’univers de Lansyer.
Depuis 2018, le Musée Lansyer s’attache à être plus visible via le numérique, en particulier grâce à son espace sur le site des Musées de la région Centre-Val de Loire, mais aussi grâce à ses versements de fiches d’objets dans la base Joconde.
Informations fournies par le musée
Le musée de site archéologique de Mariana est un bâtiment contemporain de l’architecte Pierre-Louis Faloci, fait de béton et de verre, qui sert d’écrin à une magnifique collection retraçant l’histoire de Mariana, colonie romaine fondée par le général Caius Marius vers 100 avant notre ère et devenant à l’aube du Ve siècle le premier évêché établi en Corse. Placé au cœur du territoire historique de Mariana, le musée est intimement lié à son parc archéologique où trône l’église romane de la Canonica édifiée au début du XIIe siècle sous la gouverne de l’archevêque de Pise. La promenade se poursuit jusqu’à l’église cimétériale de San Parteo de même facture. Les collections présentées de manière permanente au public témoignent de la vie quotidienne d’une ville romaine en Corse et de la cathédrale paléochrétienne au décor architectural remarquable. Le discours muséographique met en lumière l’histoire de Mariana inscrite dans son espace méditerranéen.
Associé à un centre de recherches, le musée reçoit régulièrement des collections au fil des fouilles préventives et programmées menées sur son territoire. Dans ce mobilier d’étude, des objets sont sélectionnés, du fait de leur intérêt muséographique, pour intégrer la collection musée de France ainsi régulièrement enrichie.
Les versements sur la base Joconde ont vocation à valoriser et diffuser nos plus belles ou singulières pièces mais également à donner à voir des objets découverts récemment et qui pourraient inciter d’autres institutions patrimoniales à solliciter des prêts.
Informations fournies par le musée
Situé à Lyon, à la confluence du Rhône et de la Saône, le musée des Confluences met en dialogue les sciences pour comprendre l’histoire du vivant et de l’humanité. Il aborde de grandes questions universelles : l’origine et le devenir de l’humanité, la diversité des cultures et des sociétés mais aussi la place de l’humain au sein du vivant. Soit un parcours permanent de quatre expositions dont la démarche inédite est de proposer au visiteur une approche interdisciplinaire pour parcourir notamment l’infinie richesse du monde vivant, des cultures et des civilisations. Le musée des Confluences est l’héritier d’une collection, constituée sur cinq siècles d’histoire et composée de divers fonds liés à des musées aujourd’hui disparus : le Muséum d’histoire naturelle de Lyon, le musée Guimet lyonnais, mais aussi le musée colonial de la ville de Lyon créé par Édouard Herriot en 1927. Des dépôts enrichissent également les collections tel celui de l’Œuvre de Propagation de la Foi de Lyon.
Les versements effectués sur Joconde concernent uniquement les collections ethnographiques du musée des Confluences. Pour débuter, la priorité est donnée à la collection africaine, riche de 8000 œuvres et plus particulièrement aux objets d’Afrique de l’Est, relativement rares dans les collections publiques françaises.
Informations fournies par le musée
Le Musée Henri Boëz de Maubeuge a été créé en 1878 suite au succès d’une exposition du produit de fouilles archéologiques locales. Bénéficiant de nombreux dons, donations et legs des amateurs locaux, le musée constitue une collection riche, reflet de la vie artistique locale et nationale. Les collections sont presque entièrement détruites en 1914, alors que le bâtiment abritant le musée, la salle Sthrau, est victime d’un incendie. Elles sont reconstituées par Henri Boëz, qui reste le conservateur du musée pendant près de 40 ans. Beaux-arts, archéologie, ethnographie sont autant de domaines présents dans les collections qui laissent la part belle à la peinture de la Renaissance flamande, à l’art des Salons de la fin du 19e siècle, aux artistes régionaux des 19e et 20e siècles et au produit des fouilles locales.
Le musée Henri Boëz est fermé à ce jour mais s’engage dans un projet de réouverture. Dans l’attente, l’informatisation et la numérisation des collections sont des composantes essentielles de la vie du musée. Les versements sur Joconde permettent ainsi d’œuvrer à la connaissance et à l’accessibilité des collections, au service d’œuvres qui ne sont que rarement vues.
Ce versement a pu être réalisé grâce à l’appui de l’Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, qui publie sur son site Musenor les collections et actualités des « musées de France » de la région, ainsi que de nombreuses ressources complémentaires.
Informations fournies par le musée
Montmédy, musée Jules Bastien-Lepage - musée de la fortification
Installé dans l’ancienne école de la citadelle haute de Montmédy, le musée présente, dans une première section, les différentes facettes de l’œuvre de l’un des plus importants artistes meusiens du XIXe siècle et dans une seconde section, les sites et les édifices fortifiés meusiens de la Préhistoire au XVIIIe siècle.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Ce musée monographique est consacré à l’œuvre de Jules Desbois (1851-1935), l’un des sculpteurs de renom de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Jules Desbois se forme auprès du statuaire Bouriché, à Angers, puis dans l’atelier de Jules Cavelier aux Beaux-Arts de Paris, mais son art est transformé par sa rencontre avec Rodin et les quarante ans d’amitié qui s’ensuivent. Jules Desbois connaît la célébrité dès les années 1890 avec des sculptures majeures, telles La Mort et le Bûcheron, La Misère ou Léda, tout en investissant aussi avec succès les arts décoratifs, notamment par son travail de l’étain. Il produit une œuvre diversifiée, marquée par des thèmes récurrents : la mythologie, la nature et surtout le corps – notamment féminin.
Réputé pour la qualité de sa sculpture, au modelé sensuel, comme par la finesse de ses reliefs, il s’attache à un réalisme humaniste, souvent allégorique, qu’il fait aussi évoluer vers l’expressionnisme. Dans sa fin de vie, ne pouvant plus sculpter, il se tourne vers le pastel.
Ouvert dès 1985 dans le village natal de l’artiste à l’initiative de l’association des Amis de Jules Desbois, le musée de Parçay-les-Pins devient municipal en 2001 et prend alors place dans un bâtiment du bourg, reconverti (architecte-muséographe : Maxime Ketoff).
C’est le seul musée où l’on peut avoir une vision complète du travail de Jules Desbois, dont on peut aussi admirer des œuvres dans les collections permanentes de divers musées, à Paris (Petit-Palais, Orsay, Rodin) ou ailleurs en France (Angers, Nancy, Aix-les-Bains, etc.). Cette mise en ligne sur Joconde participera du travail que le musée effectue pour promouvoir l’œuvre de ce grand sculpteur.
Informations fournies par le musée (Florian Stalder, conservateur départemental des musées)
Créé en 1971 par une association de passionnés et bénévoles, Les Amis de Gustave Courbet, puis devenu propriété du Département du Doubs en 1976, le musée Courbet est situé à Ornans, berceau du maître du Réalisme, et établi au sein de l’Hôtel Hébert, considéré longtemps comme la maison natale du peintre. Rénové et agrandi entre 2008 et 2011, ce site phare du projet « Pays de Courbet, Pays d’artiste » – regroupant d’autres sites liés à la vie de l’artiste, tels la Ferme familiale de Flagey ou l’Atelier du peintre à Ornans – est entièrement consacré à l’œuvre de Courbet.
Homme des éclats et des scandales, Gustave Courbet s’impose au milieu du XIXe siècle comme le peintre de la rupture réaliste. Connu, reconnu et collectionné en France, mais aussi à l’étranger, il est aujourd’hui représenté dans les plus grands musées du monde.
La collection du musée, seule institution entièrement dédiée à l’artiste, présente un autre Courbet que celui des grands manifestes, un Courbet intime, attaché à ses racines comtoises.Au travers de plus de 100 œuvres de Courbet (peintures, dessins, sculptures et gravures), mais aussi de contemporains, les collections du musée témoignent d’un artiste novateur et engagé, s’émancipant des conventions de représentations, devenant ainsi une référence des artistes de la modernité.
Le versement sur Joconde, via POP, la plateforme ouverte du patrimoine, a pour vocation de renforcer la visibilité du musée auprès des institutions culturelles et ainsi augmenter ses prêts d’œuvres.
Informations fournies par le musée (Benjamin Foudral, conservateur et directeur du musée Gustave Courbet)
Installé dans l’ancienne abbaye Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale.
Récemment, une première section du parcours permanent a été rénovée : elle met en lumière la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et l’importance de l’abbaye dans l’histoire nationale au cours des siècles. Reconstitutions d’espaces, animations numériques, jeux de lumières mettent en valeur les 1 500 ans d’histoire du bâtiment, tour à tour abbaye, hôpital puis musée.
Depuis 2020, les musées de Reims disposent d’un musée numérique. Plus de 14 550 œuvres sont ainsi accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone, parmi lesquelles près de 2 000 œuvres conservées au musée Saint-Remi. Plus de 15 000 images en haute définition sont téléchargeables, librement utilisables pour tous usages. À terme, ce sera toute la collection rémoise riche de plus de 100 000 œuvres qui sera petit à petit dévoilée.
En parallèle, les notices seront versées sur Joconde pour offrir aux usagers un environnement de recherche plus vaste. Les liens vers le portail des musées de Reims sont accessibles depuis les notices Joconde.
Informations fournies par le musée
Installé dans un hôtel particulier du 18e siècle qui a conservé son atmosphère, le musée expose des collections variées de peintures (hollandaises et italiennes du 17e, françaises du 19e) et d’arts décoratifs des 18e-19e s. (faïences, verreries, Ecole de Nancy). Il présente aussi des artistes lorrains dont Louis Français, le fameux peintre de l’Ecole de Barbizon. Le musée est ouvert au public en 1913 suite au legs de l’avocat et collectionneur Charles de Bruyères. Charles de Bruyères a été le premier collectionneur à acheter des œuvres de Jules Adler dès 1890. Le musée conserve douze œuvres dont des grands formats. Le musée expose également des œuvres relatant l’histoire de l’abbaye et du chapitre de Remiremont depuis sa fondation en 620 (collections archéologiques) juqu’à sa disaparition en 1793, des portraits de ses puissantes abbesses et des chanoinesses, ainsi que des ducs de Lorraine. On y trouve aussi du mobilier des Hautes-Vosges vers 1800.
Ce premier versement permet de mettre en valeur quelques-unes des acquisitions de ces douze dernières années financées avec l’aide du Fonds régional d’acquisition des musées (Etat et Région). De nombreuses acquisitions ont été réalisées et vont être mises en ligne. D’autres versements concernant cette fois le fonds ancien viendront enrichir prochainement ce catalogue collectif. Le versement sur Joconde, via POP, la plateforme ouverte du patrimoine, a pour vocation de diffuser nos œuvres vers les professionnels et le grand public.
Informations fournies par Aurélien Vacheret, directeur du musée
Établissement culturel du Département des Yvelines, le musée Maurice Denis a ouvert ses portes au public en octobre 1980.
Installé dans « Le Prieuré », la dernière maison de l’artiste à Saint-Germain-en-Laye, il a reçu l’appellation « Musée de France » en 2003 et le label « Maison des illustres ». L’ensemble du site – le bâtiment principal de la fin du XVIIe siècle, l’atelier de Maurice Denis (1870-1943) et le vaste jardin – est doublement classé, au titre des monuments historiques et des sites naturels.
Les collections comptent plus de 5 000 œuvres, toutes techniques confondues.
Le fonds initial a été constitué par une donation exceptionnelle consentie en 1976 par la famille de Maurice Denis, d’environ 1 500 œuvres. Depuis, il a été enrichi par de nombreuses donations et acquisitions, d’œuvres d’artistes symbolistes et nabis, mais aussi de contemporains et d’élèves de Maurice Denis.
L’informatisation des collections dans un nouvel environnement et la réalisation de prises de vue HD, notamment dans le cadre de campagnes France collections menées par la RMN-GP, ont permis la création d’un portail des collections.
Ce premier versement dans la base nationale Joconde, d’une centaine d’items, correspond essentiellement aux œuvres phares des collections. D’autres versements interviendront au fur et à mesure de l’alimentation du portail des collections du musée.
Informations fournies par le musée
Le musée d’Art sacré prend place dans l’aile sud de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Mihiel. L’art religieux meusien est mis à l’honneur à travers un ensemble de pièces d’orfèvrerie et de sculptures.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Le musée Estrine, musée associatif labellisé « Musée de France » en 2007, est installé dans un hôtel particulier construit en 1749. Témoignage de l’architecture provençale du XVIIIe siècle, il fut le siège des Princes de Monaco, seigneurs de Saint-Rémy à partir de Louis XIII. La collection est dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles, dans la filiation des deux artistes qui ont marqué Saint-Rémy-de-Provence : Vincent van Gogh et Albert Gleizes. Le projet scientifique et culturel du musée couvre un champ assez vaste, de la figuration à l’abstraction, en insistant sur la singularité des écritures plastiques. Une attention particulière est portée aux artistes qui ont travaillé ou travaillent sur le territoire provençal, ainsi qu’à la notion de paysage. Le musée organise chaque année plusieurs expositions temporaires en écho à ses collections. Enfin, il abrite le Centre d’interprétation Vincent van Gogh qui revient sur la vie et l’œuvre du maître hollandais (réseau Van Gogh Europe).
Ce premier versement se veut être un échantillon représentatif, mettant en avant les artistes emblématiques de la collection. D’autres versements viendront enrichir prochainement le catalogue, l’objectif étant de rendre disponible la totalité de la collection du musée sur la base Joconde. La participation au catalogue collectif des musées de France répond aux missions de diffusion et de valorisation des collections, visant à les rendre accessibles au public le plus large et à assurer l’égal accès de tous à la culture.
Informations fournies par le musée
Situé au rez-de-chaussée de l’ancienne résidence d’été du président Raymond Poincaré (1860-1934) à Sampigny, le musée départemental Raymond Poincaré retrace le parcours de cet illustre meusien, avocat, académicien, homme d’Etat et président de la République pendant la Grande Guerre.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
En plein cœur d’un espace naturel et à proximité de la confluence de la Loire et de la Vienne, l’écomusée du Véron abrite une collection qui témoigne de l’histoire sociale et culturelle. Musée pluridisciplinaire, il se déploie comme une constellation d’objets, d’œuvres, de mémoires et de modes de vie ici et dans le monde.
Tout commence avec L’APEV, association pour l’écomusée du Véron, qui collecte les témoins matériels du patrimoine du Véron. L’association est l’instigatrice de l’écomusée du Véron, reconnu "Musée de France" depuis 2002 grâce au don de trois mille objets liés à la vie rurale du Véron. Il ouvre officiellement ses portes en juin 2003.
En 2014, de nouveaux travaux permettent de donner un nouveau visage au musée qui devient un musée d’anthropologie culturelle et patrimoniale. L’écomusée étend son domaine d’expositions et d’études. Sélectionné en tant que « musée pilote » pour l’opération « Culture près de chez vous » en 2018, l’écomusée développe un partenariat avec le Centre Georges Pompidou. En 2021, l’écomusée du Véron et le Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon, mutualisent leurs actions et services pour créer les musées de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
Poursuivant l’objectif de s’inscrire dans le panorama culturel et artistique national, l’écomusée du Véron souhaite verser les notices des œuvres qu’il conserve dans le catalogue collectif des musées de France. Le chantier des collections de l’écomusée programmé en 2023 sera l’occasion de régulariser cette action par des campagnes de versement.
Informations fournies par le musée
Depuis 1986, le musée de la bière est situé dans un monument historique protégé. Au cours de ses cinq siècles, ce bâtiment a connu de nombreuses reconversions : il a été transformé en malterie dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce qui en fait un lieu tout indiqué pour accueillir les collections du musée qui retrace l’histoire des techniques, des traditions et des arts brassicoles, des origines mésopotamiennes à nos jours.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Dès 1864, le ministère de l’Inspection publique auquel se rattachent les beaux-arts, confie une toile d’Auguste Mathieu (1810-1864), Intérieur d’une chapelle, à la municipalité vannetaise, en signe d’encouragement à la création d’un musée. Deux décennies plus tard, un conservateur est nommé afin d’installer des salles d’exposition au cœur du nouvel hôtel de ville, pour y présenter les premières collections dont dispose la collectivité. Cette dernière se motive pour sauver Le Christ sur la croix, peinture du célèbre Eugène Delacroix, mise en dépôt par l’Etat dans un édifice religieux de la ville depuis 1835. Fort mal conservée, l’œuvre, après quelques péripéties et restaurations, devient dès lors une pièce emblématique de la collection.
Au cours du 20e siècle, le musée connait plusieurs déménagements successifs avant d’être installé au début des années 1980 au sein du bâtiment de la Cohue, qui correspond originellement à une halle médiévale de la ville close.
Dons, legs, et achats aux côtés des envois de l’Etat complètent le fonds qui se développe essentiellement autour de la gravure et du dessin.
Depuis 2013, une salle est consacrée à la présentation permanente de l’œuvre de l’artiste Geneviève Asse (1923-2021). Son attachement au golfe du Morbihan, sa région natale, l’a conduite à une donation significative de sa production que le musée continue d’enrichir.
Aujourd’hui 70 % des biens relèvent des arts graphiques alors que le musée compte environ 6800 items en collection « Musée de France ».
Le versement des premières notices sur Joconde, en ce début d’année 2022, concourt à la volonté de diffusion et de valorisation du patrimoine muséal de la ville.
Informations fournies par le musée
À proximité du Mémorial américain des combats de l’Argonne, le musée d’Argonne évoque les arts et traditions populaires en Argonne et les grands événements qui ont marqué l’histoire de cette région : l’arrestation de Louis XVI et la Première Guerre mondiale.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Le musée Jeanne d’Arc de Vaucouleurs est consacré aux représentations de ce personnage au destin tragique qui depuis le Moyen-Âge a inspiré écrivains, artistes et historiens.
En savoir plus sur ce musée intégré en juillet 2022
Réseau des musées de la Meuse
Le réseau des musées de la Meuse regroupe les neuf musées de France du département.
En 1956, la Conservation départementale des Musées de la Meuse a été créée à l’initiative du Département de la Meuse pour assurer l’assistance scientifique et technique des musées meusiens. Le service, devenu Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées de la Meuse en 2017, administre aujourd’hui le musée Raymond Poincaré à Sampigny et le musée de la Bière à Stenay dont les collections sont la propriété du Département de la Meuse. Par ailleurs, ce service gère scientifiquement par convention les collections municipales des musées de Commercy, de Saint-Mihiel, de Vaucouleurs, de Varennes-en-Argonne et des musées de Montmédy.
Le musée de la Princerie de Verdun et le Musée barrois de Bar-le-Duc sont indépendants et régis respectivement par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun et par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Ce premier versement sur la base joconde a pour objectif de proposer un échantillon représentatif des collections des deux musées départementaux et des six musées municipaux. Les prochains versements s’effectueront au gré des campagnes photographiques et des recherches documentaires.
Le Service Conservation et Valorisation du patrimoine et des musées de Meuse s’engage dans le versement de notices sur la base Joconde afin de valoriser les collections et de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Musées intégrés en 2021
Le musée Daubigny, situé au cœur de la ville d’Auvers-sur-Oise et à proximité directe de la Maison-Atelier de Daubigny, propose depuis 2015, une exposition permanente sur Charles François Daubigny et son fils Karl et deux expositions temporaires par an.
Charles François Daubigny est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement impressionniste. Il a séjourné 18 ans à Auvers-sur-Oise réunissant autour de lui de nombreux confrères parmi lesquels Corot, Daumier, Oudinot, le sculpteur Geoffroy-Dechaume, Dupré, Damoye, Berthe Morisot et sa sœur Edma …
L'inventaire du musée Daubigny réalisé entre 2008 et 2014 compte 1 741 numéros répartis en 4 collections : Section 1 : Autour de l’impressionnisme, Section 2 : Art contemporain, Section 3 : Art félin, Section 4 : Art naïf
La section 1 témoigne majoritairement du passage d'artistes à Auvers-sur-Oise ou aux alentours ; elle comprend des œuvres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle des peintres de la vallée de l’Oise « autour de l'impressionnisme ». Cette section compte des œuvres de Charles François et Karl Daubigny, Edmond Marie Petitjean (1844-1925), Honoré Daumier (1808-1879), Léonide Bourges (1838-1909), Jules Dupré (1811-1889), Fernand Quignon (1854-1941)...
L’objectif prioritaire du musée étant de montrer la place d’Auvers-sur-Oise dans l’Histoire de l’impressionnisme, il a été décidé de commencer le versement sur la base Joconde par cette collection. En 2021, le musée a commencé le récolement de ses collections. Les premières œuvres récolées et numérisées concernent l’œuvre gravé de Daubigny. Le musée entame donc le versement par cette partie de ses collections et en particulier par la série de gravures du Voyage en Bateau de Charles François Daubigny accompagnées de ses plaques de cuivre.
Informations fournies par le musée
En 1996, le musée de la carte postale constitue son fonds de départ par l’achat d’une collection de 12 200 cartes postales anciennes, sur la Bretagne datant pour la majorité des années 1900-1920.
Aujourd’hui, les collections se composent de plus de 100 000 cartes postales principalement axées sur la Bretagne historique mais elles traitent aussi et surtout de la matière bretonne comme la vie quotidienne dans les campagnes, les foires et marchés, les noces et pardons, les petits métiers, les moyens de transports, les danses, la musique, les mouvements militants... Le musée possède aussi d’autres collections qui présentent des thématiques très diverses couvrant l’ensemble du territoire français ainsi que l’étranger, comme celle sur le patrimoine et la vie maritime de Nelson Cazeil, celle sur l’agriculture et la vie rurale de Germain Dalin ou celle sur le patrimoine industriel baptisée « Fonds Lumière ».
Dès sa création, le musée a souhaité communiquer ses collections au plus grand nombre. Rapidement, une base de données nommée Cartolis a été mise en ligne où aujourd’hui, plus de 90 000 cartes postales de nos collections sont visibles. Après l’obtention de l’appellation « Musée de France » en 2017 et un partenariat avec Google Arts et Culture en 2018, le musée de la carte postale continue sur sa lancée et souhaite aujourd’hui diffuser ses collections sur la base Joconde et ainsi faire découvrir la richesse de ce petit carton voyageur.
Informations fournies par Pauline Bisiaux, chargée de la gestion et de la valorisation des collections
Inauguré en 1990, le musée gallo-romain de Biesheim est consacré aux découvertes archéologiques d’«Oedenburg», site majeur de la plaine du Rhin supérieur, localisé au nord du territoire rauraque (peuple celte originellement établi dans la Ruhr) sur la rive gauche du fleuve.
Mentionné aux 18e et 19e siècles au gré des découvertes fortuites, l’origine et l’organisation de l’agglomération antique ont été révélées à la faveur de plusieurs programmes de recherches internationaux. Le contexte stratégique de l’époque justifie l’édification d’un important complexe religieux et l’implantation de deux camps militaires successifs au 1er siècle. Parallèlement, un habitat civil se déploie durablement au carrefour des voies principales, avec la construction au 4e siècle d’un relais routier et d’un palais impérial fortifié. Faisant écho aux résultats des fouilles archéologiques récentes, l’exposition permanente offre un panorama complet de la civilisation gallo-romaine locale, présentée par espaces thématiques : armée, commerce, religion, rite funéraire, artisanat et vie quotidienne. L’introduction précoce des cultes orientaux indissociables de la présence militaire, ainsi qu’une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode terrassant un roi barbare, singularisent le site.
La mise en ligne progressive et thématique des œuvres, privilégiant les objets représentatifs du fonds, est appréhendée comme un aboutissement du post-récolement. Cela constitue pour le musée une nouvelle étape visant à valoriser ses missions, à le promouvoir et diffuser ses collections.
Informations transmises par le musée
Le Conservatoire de l’agriculture-Le Compa s’est construit autour d’une importante collection qui retrace l’histoire de l’agriculture et de sa mécanisation, de 1820 à 1970. Réunies dans les années 80 et présentées au public dès 1990, ces très belles machines, sont souvent uniques et volumineuses : la première moissonneuse McCormick (1831), des tracteurs tels le Sawyer-Massey (1910) et le Moline…
A l’origine exclusivement orientées sur les machines et les outils agricoles, les collections s’élargissent. Métiers et débouchés liés à l'agriculture prennent place au musée. Bourrellerie, maréchalerie, charronnage, alimentation… Autant de domaines qui participent à la mémoire de la ruralité.
Un fonds iconographique de plus de 300 photographies originales et 400 œuvres graphiques (estampes, affiches, dessins…) illustrent les mutations sociales, techniques et scientifiques du monde rural. Le Conservatoire possède également une collection de jouets agricoles, la plus importante en France. Enfin, les œuvres d’art contemporain offrent une approche sensible de l’agriculture : sculptures, photographies, installations, etc.
En 2012, les collections du Musée des Ruralies, près de Niort, et d'Agropolis-Museum, à Montpellier, sont venues enrichir le Conservatoire, lui permettant de devenir ainsi l’un des principaux musées agricoles d’Europe, avec près de 8 000 numéros à l’inventaire.
Grâce au portail national Joconde, découvrez en ligne un échantillon de ces pièces exceptionnelles ! D’autres versements viendront dans les prochains mois abonder ce musée virtuel qui témoigne de la richesse et de la diversité des collections du Compa.
Informations fournies par le musée
Inauguré en 1903, le musée Bargoin associe un parcours permanent dédié à l’archéologie et des expositions temporaires consacrées aux textiles extra européens. Au cœur du propos, un thème fort et fédérateur : l’humain, abordé par le prisme des objets du quotidien. En offrant ce double regard sur l’Homme, le musée souhaite alimenter la réflexion sur notre société et les défis actuels de l’humanité.
Le département archéologie présente l’histoire des sociétés humaines dans le Puy-de- Dôme, du paléolithique à la période gallo-romaine. Il conserve notamment les découvertes archéologiques de sites très connus tels que Gergovie, le sanctuaire antique de la Source des Roches qui a livré plus de 3000 ex-voto en bois ou encore la nécropole des Martres-de-Veyre dont le mobilier funéraire est exceptionnellement conservé (notamment une tunique complète).
Parmi les collections originales du musée figurent les dessins et archives de l’égyptologue auvergnate Marcelle Baud (1890 - 1987), première femme attachée à l’Institut français d’archéologie orientale du Caire en tant que dessinatrice. Ce fonds qui fait aujourd’hui l’objet d’un premier versement sur la base Joconde a été acquis en plusieurs phases : d’abord en 1990, suite au décès de l’égyptologue et selon son souhait (environ 500 items), puis en 2020 et 2021 suite à la découverte de deux fonds privés (environ 3 750 items). Ces aquarelles, dessins, relevés, photographies, préparations de publications relatent à la fois une page de l’histoire de la recherche égyptologique française et le parcours d’une des pionnières de l’égyptologie, spécialiste de l’art du dessin égyptien.
Le fonds Marcelle Baud sera par ailleurs valorisé du 7 juillet 2021 au 9 janvier 2022, grâce à l’exposition Traits d’Égypte, Marcelle BAUD , labellisée d’intérêt national par le Ministère de la Culture.
Informations fournies par le musée
Le musée portuaire de Dunkerque, créé en 1992, est abrité dans un ancien hangar à tabac construit au milieu du XIXème siècle et situé sur le quai de la Citadelle, en bordure du Bassin du Commerce. L’exposition permanente retrace l’histoire et l’évolution d’un port devenu troisième port de commerce français et dont les terrains s’étendent sur dix-sept kilomètres de littoral sablonneux.
Le musée propose également les visites du phare du Risban et de trois navires : la Duchesse Anne, un trois-mâts destiné à la formation des cadets et protégé au titre des monuments historiques depuis 1981 ; la Guilde, une péniche au gabarit Freycinet qui naviguait sur les canaux de la région ; le Sandettié, un bateau-feu affecté à la signalisation lumineuse des bancs de sable en Mer du Nord.
Dès son origine, la collection du musée a pour ambition de témoigner de l’histoire du troisième port de commerce français. Les collectes et dons massifs sont complétés par des achats orientés vers trois axes de travail : les métiers portuaires, la construction navale dunkerquoise, la formation et la vie des marins de commerce.
La politique de diffusion des collections inaugurée ici privilégie une mise à disposition des notices d’œuvres et d’objets en partant des acquisitions les plus récentes qui témoignent des liens étroits développés avec les collectionneurs ou propriétaires d’objets, très attachés à la présence et à l’activité du Musée portuaire. Progressivement, au fil des versements, les notices mises en ligne témoigneront et rendront perceptibles l’histoire des collections, les campagnes de récolement et d’inventaires rétrospectifs.
Informations fournies par le musée
Le poète Pétrarque (1304 – 1374) découvrit le site de Fontaine-de-Vaucluse à 9 ans et s’installa ensuite dans une maison, au pied de la falaise. Fontaine-de-Vaucluse fut rapidement un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui aiment la poésie de Pétrarque : Madeleine de Scudéry, Casanova, Mirabeau, Lamartine, George Sand, Stendhal… L’idée germe au XIXe siècle d’un Musée Pétrarque à Vaucluse. Pour les 600 ans de la rencontre entre le poète et Laure, sa muse, en 1927, une maison est choisie à Fontaine-de-Vaucluse et devient la Maison de Pétrarque. Les collections proviennent de l’Université d’Aix-en-Provence et sont essentiellement composées d’incunables, d’éditions anciennes et de dessins. L’inauguration a lieu en 1928. En 1968, le Conseil général de Vaucluse rachète le Musée Pétrarque, qui renaît dans les années 1980.
Le Musée-Bibliothèque est membre de la Fédération des Maisons d’écrivains, des Patrimoines littéraires et appartient au réseau des Maisons des Illustres. Les collections comportent des dessins et des estampes sur Pétrarque, Laure et la Fontaine-de-Vaucluse ainsi qu’un fonds d’éditions anciennes des œuvres du poète et de pétrarquistes. Une collection d’art moderne perpétue l’attache d’artistes avec ce territoire, autour de René Char : Georges Braque, Alberto Giacometti, Vieira Da Silva, Joan Miró, Zao Wou-Ki, Pablo Picasso…
Le versement sur Joconde commence par le fonds ancien, gravures et incunables ; suivront les éditions anciennes et les collections d’art contemporain autour de René Char.
Informations fournies par le musée
Raymond Granier, collectionneur passionné, a rassemblé sa vie durant tout ce qui avait un rapport avec la pénurie, les restrictions ou le rationnement durant les guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. En 1981, le Conseil général acquiert ce fonds de plus de 10 000 pièces. Fontaine-de-Vaucluse est choisie pour l’installation d’un musée. En 1985, un conservateur du patrimoine est nommé et le Musée d’Histoire 1939-1945 L’Appel de la Liberté est officiellement ouvert au public en juillet 1990. Après le décès de Jean Garcin, président du Conseil général et ancien résistant, en 2006, le musée décide de lui rendre hommage en se dénommant : Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté. Il a obtenu l’appellation « Musée de France » en 2010.
Il s’agit de témoigner de façon pérenne d’une histoire récente tout en dépassant l’anecdotique de l’événement et tendre vers l’expression et le rayonnement d’un idéal universel. C’est ainsi que la muséographie, constituée de décors de Willy Holt, ayant pour but de toucher la sensibilité pour susciter la réflexion, fut choisie pour le rez-de-chaussée, consacré à la vie quotidienne. L’étage supérieur du musée retrace l’histoire de la Résistance en Vaucluse avec des enregistrements vidéo d’anciens Résistants. Enfin, la dernière partie du musée s’intéresse à la Résistance dans les Arts et les Lettres.
La quantité de pièces numérisées est désormais suffisamment représentative pour permettre un versement sur Joconde de notices avec visuels.
Informations fournies par le musée
Le musée de Forcalquier a été créé en 1912 par Martial Sicard, avoué, maire et député du groupe des républicains progressistes, sur la suggestion du maître d’école Eugène Derbez. Dès son origine, il se veut le récit de la ville, témoignant auprès des habitants et des visiteurs de son histoire : archéologie, mobilier, costumes, faïences, objets de la vie quotidienne et religieuse, beaux-arts, racontent le développement et la vie d’une petite ville active en Haute-Provence. Martial Sicard lui-même offre en 1916 une série de photographies montrant l’évolution de Forcalquier. Le fonds est régulièrement enrichi de donations privées, ainsi que de dépôts de l’Etat.
En 1991, la collection s’agrandit et se diversifie tout d’un coup par l’arrivée d’un important don de l’association des amis de Boris Bojnev : Lucien Henry, galeriste, lui avait cédé à sa mort toute sa collection d’art contemporain. Il s’agit de 475 œuvres (peintures, sculpture, collages, dessins…) qu’il a collectionnées au cours de sa vie. Elles reflètent son activité de galeriste et ses goûts personnels (art pauvre proche de l’art brut) mais donnent aussi à voir la communauté d’artistes installés à proximité, connus ou moins connus : Bernard Buffet, Boris Bojnev, Thierry Agullo, Robert Morel et son épouse Odette Ducarre…
A l’heure actuelle, un nouveau projet du musée est en gestation. La publication de notices sur la plateforme POP permet à ces collections de rester visibles et disponibles.
Informations fournies par le musée
Le musée Fragonard est un des plus anciens musées de France. Il a été créé en 1766, en même temps que l'École royale vétérinaire de Paris.
La collection a traversé les siècles, résistant aux révolutions et aux guerres, pour vous présenter un patrimoine exceptionnel dédié aux animaux mais aussi aux humains, conservé dans un lieu fascinant. Déplacé trois fois au cours de ses quelques 250 années d'existence, il propose l'image d'un lieu hors du temps où des milliers d'objets s'offrent au regard de visiteurs transportés dans l'atmosphère de la fin du XIXe siècle.
Le musée resta fermé au public jusqu'en 1991, date à laquelle il rouvrit ses portes et connut très vite un grand succès. Il a été rénové en 2008 et accueille désormais les visiteurs dans le cadre qui était le sien en 1902.
Depuis 2008, le musée Fragonard se rend chaque année plus visible, renforce son attractivité auprès d’un large public et structure son organisation en matière de collections. Ses 11 000 pièces répertoriées en 2021, 4 200 exposées, constituent une base dense. Valoriser ses pièces maitresses dans la base Joconde, notamment les Écorchés d’Honoré Fragonard, inscrivent l’établissement dans une ambition scientifique et culturelle forte, dans un esprit d’ouverture et de partage.
Informations fournies par le musée
Le musée Charles VII de Mehun-sur-Yèvre a été créé en 1906 dans le donjon de la résidence de Jean de Berry, restauré en 1886, puis agrandi du Pôle de la porcelaine en 1996. Les collections sont le parfait reflet de l’histoire de la ville : sa forte identité médiévale et le renouveau industriel du 19 siècle centré sur les activités porcelainières.
Le fonds médiéval se compose des acquisitions anciennes et des découvertes archéologiques provenant du site même du château. Sont ainsi évoqués plus de dix siècles d’histoire retraçant une douzaine de constructions militaires ou de villégiatures. La collection phare fait référence à la venue, à l’extrême fin du 14e siècle, en Berry et à Mehun en particulier, de céramistes mudejars pour la création des sols. Carreaux bleus et blancs stannifères qui portent les “armes et devises” du duc de Berry, frère de Charles V. Ours, cygnes et lys font pendant aux fragments de sculptures qui ornaient les façades et les salles du château.
Dans un écrin de verre posé au bord de la rivière, le musée met en valeur ses porcelaines et conserve également des faïences remarquables. Des ensembles centrés sur la veille industrielle et les créations d’un atelier dit de la “Spéciale” au sein de la manufacture Pillivuyt de Mehun. Des œuvres primées lors des Expositions universelles du 19e siècle, antiquisantes, japonistes ou d’Art nouveau. Des créations réalisées par l’habileté des membres de la famille Lamarre, dont Alphonse, qui a su s’entourer de collaborateurs d’envergure comme J.-A. Habert-Dys, A. Monganaste ou P. Louchet.
Des collections uniques qu’il convient de porter à la connaissance de tous.
Informations fournies par Philippe Bon, attaché de conservation
Le musée de l'histoire vivante ouvre ses portes au public le 26 mars 1939 à l'occasion du 150e anniversaire de la Révolution française. À son origine, une association d’éducation populaire, la Société pour l'histoire, créée en 1937. Les principaux fondateurs souhaitaient s'inscrire dans la politique culturelle promue par le Front populaire. Le musée présente alors au public une histoire de la France des révolutions, celles de 1789 et de 1793, des journées révolutionnaires de 1830, de 1848 et de 1871, héritage à même d'éduquer les « masses » et de leur enseigner une histoire dont ils sont considérés comme les principaux acteurs. Cette approche historiographique et scientifique peine à dissimuler sa nature partisane. De 1939 à la fin des années 1980, le musée, devenu celui de l’histoire vivante, sera un musée démonstratif aux collections protéiformes.
Une rénovation de la maison qui abrite le musée est entreprise entre 1985 et 1988. La direction du musée s'emploie alors à faire reconnaître le musée par l’État. Début 2000, le musée est le seul musée d'histoire ouvrière et sociale en France.
En mai 2015, l’association pour l’Histoire vivante a modifié ses statuts pour se donner des objectifs majeurs dont la projection de l’ouverture d’un musée d’histoire sociale et ouvrière à dimension nationale.
Centre d’expositions temporaires et de documentation, le musée s’inscrit au sein de réseaux ou collectifs, français (le Codhos – la FEMS – les Neufs de Transilie) et international (Worklab).
Le musée de l’histoire vivante de Montreuil souhaite mieux faire connaître la spécificité et la diversité de ses collections afin de les partager via la base Joconde.
Informations fournies par le musée
Carré d’Art - musée possède une des plus importantes collections publiques françaises consacrée à l’art contemporain des années 1960 à aujourd’hui. Commencée en 1986, avec une aide importante de la Direction des Musées de France, la collection du musée d’art contemporain réunit près de 600 numéros en différents ensembles : autour du Nouveau Réalisme, Supports/Surfaces, l’Arte Povera. On y trouve également des œuvres importantes d’artistes américains comme Richard Artschwager, Allan Kaprow, Joseph Kosuth ou Christopher Wool. Une partie de la collection est consacrée à la peinture allemande avec des œuvres de Gerhard Richter, Sigmar Polke et Albert Oehlen complétées d’installations de Thomas Schütte.
Plus récemment ont été acquises, parmi d’autres des œuvres de Sam Contis, Julien Creuzet, Mounira Al Solh, Tarik Kiswanson, Walid Raad, Paul Mpagi Sepuya ou Martine Syms.
Chaque année les accrochages de la collection renouvelés permettent une approche approfondie de grands mouvements artistiques, et le musée participe à l’offre exceptionnelle d’expositions d’art contemporain dans le Sud de la France avec Arles, Avignon et Montpellier.
L’intégralité de la collection de Carré d’Art – Musée est consultable en ligne sur le réseau Videomuseum regroupant les collections publiques du 20 et 21ème siècle. La base Joconde lui permettra de s’adresser à un public plus large.
Informations fournies par le musée
Les collections du musée de la Romanité sont issues de découvertes et collectes effectuées depuis plusieurs siècles, ou d’opérations d’archéologie préventive récentes. Les collections du savant nîmois Jean-François Séguier (XVIIIe siècle) sont à l’origine du fonds du musée. Un premier musée municipal, créé dans la cella de la Maison Carrée en 1823, abritait des objets antiques et des œuvres d’artistes locaux contemporains. Mais le temple romain ne disposait pas de l’espace suffisant pour mettre en valeur le patrimoine nîmois qui ne cessait de s’enrichir.
Tandis qu’une sélection d’œuvres représentatives de la richesse du passé antique nîmois était maintenue dans la Maison Carrée, l’abondante collection d’épigraphie latine fut disposée sous les galeries du cloître de l'ancien collège des Jésuites. Ce lieu demeura le siège du musée Archéologique jusqu’à la construction du musée de la Romanité, œuvre de l’architecte Elizabeth de Portzamparc, inauguré le 2 juin 2018.
Le versement initial concerne la totalité des objets présentés dans l’exposition temporaire de la haute saison 2021 « L’empereur romain, un mortel parmi les dieux » soit 94 objets. Ensuite, ce sont des versements mensuels des œuvres présentées dans l’exposition permanente, sélectionnées selon les thèmes suivants : gladiature, vie quotidienne, spectacles, artisanat, commerce, agriculture, construction, décor domestique, mythologie, divinités, pratiques funéraires qui seront effectués.
Informations fournies par le musée
Le musée des Beaux-arts de Nîmes s’inscrit historiquement très tôt dans le paysage culturel et patrimonial de la ville. Même si l’installation dans le bâtiment construit pour cet usage en 1907 est plus que centenaire, l’origine des collections municipales dans un bâtiment ouvert au public approche du bicentenaire. En effet, des statues antiques rassemblées dès le XVIe siècles dans les murailles de la cité, puis des inscriptions, sculptures, monnaies réunies par les savants antiquaires au fil des siècles, ce sont les fouilles de la Fontaine de Nîmes - contemporaines de la découverte de Pompéi - qui génèrent le premier lieu de conservation dans le Temple de Diane en 1762. Ces riches collections réunies aux premiers tableaux sans cesse en augmentation, puis très vite complétés de sculptures et d’objets d’art dans la Maison Carrée, ont constitué dès 1823 le musée de Nîmes. Depuis les registres tenus par les Consuls, aux catalogues édités tout au long du XIXe et du XXe siècle, la notion d’inventaire a prévalu.
Parmi l’un des premiers en France dès 1986, le musée des Beaux-arts de Nîmes a procédé à l’informatisation de cet inventaire, grâce à un premier logiciel de recherche documentaire, et à l’apparition du tout nouveau micro-ordinateur, permettant une recherche multicritères. Cette base de données était alors couplée à un vidéodisque contenant une véritable banque d’images de la collection entière.
L’univers des réseaux numériques conduit à présent à la démarche d’un versement de ces ressources sur Joconde, grâce à la Plateforme ouverte du patrimoine, afin d’assurer la connaissance et la diffusion de ces collections.
Informations fournies par le musée
Ouvert au public en 1893, le Museum de Nîmes est issu des collections de la Société d’Etude des Sciences naturelles de Nîmes et du Gard et de donateurs gardois. Installé dans un bâtiment classé, un ancien couvent de Jésuites du XVII ème siècle, qui comprend notamment un cloître et une chapelle.
Le Museum, est répertorié 6e de France au regard de la qualité et de la quantité des spécimens qui s’y trouvent. Les collections les plus remarquables sont celles des coléoptères de Thérond qui ont fait l’objet d’une dation, les collections du XVIII ème siècle de Jean-François Séguier, issues de son séjour à Vérone, la collection de minéraux et de fossiles d’Emilien Dumas, qui sont à l’origine de la carte géologique du Gard mais aussi les centaines de milliers d’échantillons de la collection de préhistoire et les objets ethnographiques issus d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.
Ses collections couvrent donc les sciences naturelles dans leur ensemble, zoologie, botanique et géologie et des sciences humaines, préhistoire et ethnologie.
Cette riche variété de disciplines conservées est une mine pour la médiation scientifique en terme de contenu pour les ateliers pédagogiques, les événementiels culturels et les expositions temporaires.
Dans un premier temps ce sont précisément les objets ethnographiques issus des salles d’ethnologie et des réserves qui seront versés sur la base Joconde pour assurer la visibilité de ces pièces remarquables au public et aux chercheurs.
Informations fournies par Adeline Rouilly, Directrice du Museum de Nîmes
L’histoire des collections de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord est liée aux recherches archéologiques menées à la fin du 16e siècle et à l’activité des sociétés savantes du 19e siècle : la région suscite tôt l’intérêt d’archéologues et d’érudits. En 1964, un musée municipal ouvre dans l’ancien tribunal cantonal et la Maison de l’Archéologie y prend place en 1989. L’institution, à vocation d’études et de recherches, est en prise avec l’actualité et l’équipe participe à des opérations archéologiques.
Le parcours actuel présente des objets issus de chantiers de fouilles, d’achats ou de dons liés au territoire. Les salles préhistoriques mettent l’accent sur les abris gravés et l’outillage lithique. La section gallo-romaine expose des découvertes locales témoignant de l’habitat, de l’univers thermal ou des cultes à Mercure. Le mobilier archéologique de plusieurs châteaux, tels le Hohenfels ou le Schoeneck, est aussi présenté. A travers une vaste typologie d’œuvres, des thématiques comme l’armement, l’éclairage ou le chauffage évoquent la vie castrale en Alsace. Le parcours s’achève sur la présentation de poêles produits par la manufacture locale De Dietrich, illustrant l’ère industrielle.
Depuis 2015, le musée procède au récolement de ses collections sur une nouvelle base de gestion informatisée et le second récolement décennal s’achève à la fin de l’année 2021. Avec une visibilité renouvelée sur son fonds, le musée souhaite aujourd’hui diffuser ses collections pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
Informations transmises par le musée
En 1884, sous l’impulsion du maire de Noirmoutier, un premier musée est constitué au sein de l’Hôtel de Ville. L’exposition repose sur ses propres collections (bibliothèque, malacologie et ornithologie) et sur la collection minéralogique de François Piet de l’Académie ambulante du bois de la Chaise.
Après le rachat du château par la municipalité en 1901, ce premier musée, petite encyclopédie locale orientée vers les sciences naturelles, prend essor au sein du donjon. Les collections s’enrichissent avec les vestiges du passé de l’île grâce à la volonté de notables et érudits locaux.
En 1934, l’association Les Amis de Noirmoutier est créée pour collecter ces vestiges et gérer le musée au château. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château étant occupé par les troupes allemandes, l’activité du musée est suspendue pour reprendre dès 1946. L’association se tourne vers le domaine des beaux-arts avec l’entrée d’artistes inspirés par l’île de Noirmoutier (Florimond Palvadeau, Jean Vincent-Darasse, Ambroise Baudry, Octave de Rochebrune, Jules Robuchon, Emile Dezaunay…). A partir de 1970, le musée est géré par la commune. Les collections de l’association y sont en dépôt et toujours visibles au musée.
Parmi les dépôts importants figure celui du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) composé de plus de 600 biens provenant de l’épave du Maidstone. Le versement sur Joconde commence par les quatre biens manquants constatés lors du récolement en 2020.
Informations transmises par le musée
A l’occasion des commémorations de la Commune de Paris, la bibliothèque de l’Assemblée nationale a souhaité rendre accessible à tous sa collection de plus 400 affiches relatives à cette période historique.
Cette riche collection comprend notamment 251 affiches couvrant spécifiquement les 72 jours de la Commune.
Une première sélection d’une soixantaine d’affiches, parmi les plus marquantes et significatives, est d’ores et déjà consultable pour la date anniversaire du 18 mars 2021, mise en ligne en lien avec l’exposition virtuelle de l’Assemblée nationale consacrée aux députés communards. Le reste des 340 affiches sera progressivement mis à disposition dans Joconde tout au long de l’année 2021.
Situation militaire, organisation des subsistances et du prélèvement des impôts, promotion des œuvres de la Commune, déclarations politiques, convocations électorales : c’est toute la vie des Communards qui se déroule au fil des documents.
La possibilité de parcourir cette collection dans le programme Joconde-POP a été rendue possible par une collaboration exceptionnelle entre l’Assemblée nationale et le ministère de la Culture.
La participation de la bibliothèque de l’Assemblée nationale ne s’arrêtera pas là ! Entre ses murs, elle conserve, en effet, pas moins de 3 780 affiches politiques, plus de 4 600 documents iconographiques, une quarantaine d’esquisses de Delacroix, 1 200 monnaies et médailles et plus de 200 objets en lien avec l’histoire politique et parlementaire française. D’ici le mois de juin, une sélection d’une cinquantaine des objets les plus remarquables de ce patrimoine sera versée dans Joconde-POP.
Héritier du cabinet d’instruments du Conservatoire de Paris constitué sous la Révolution française, le Musée de la musique poursuit une mission : conserver, enrichir et faire vivre l’une des plus prestigieuses collections d’instruments et d’œuvres liées à la musique.
Redéployée en 1997 au cœur de la nouvelle Cité de la musique, l’institution est rebaptisée « Musée de la musique ». Cette conversion engage un programme muséologique ambitieux et inscrit le patrimoine instrumental dans une histoire culturelle élargie, ouverte notamment aux autres arts.
En 2015, l’intégration du Musée de la musique à la Philharmonie de Paris suscite une nouvelle orientation : décloisonnement des publics, transition numérique, ouverture à la création artistique contemporaine, accessibilité aux publics en situation de handicap et intégration soutenue de la musique dans une histoire globale des arts.
Soucieux de rendre accessible ses collections au plus grand nombre, le Musée, associé au Pôle Ressources de la Philharmonie de Paris, a développé et valorisé une base de données consultable sur le web. L’institution est devenue tête de réseau pour la base nationale des instruments et un acteur majeur pour le développement de la base de données internationale en ligne MIMO (Musical Instrument Museums Online). L’accès à ses collections dans la base Joconde permet au Musée de renforcer son inscription dans la vie artistique internationale et le réseau des musées de France.
Informations transmises par le musée
Le musée Saint-Vic est un musée municipal implanté au cœur de la ville de Saint-Amand-Montrond (Cher). La grande variété de ses collections donne à découvrir le riche passé du Saint-Amandois.
Après avoir occupé deux salles de la mairie, le musée Saint-Vic a officiellement intégré l’hôtel Saint-Vic, qui lui a donné son nom, en 1940. Cet édifice du XVIe siècle fut tour à tour résidence des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes puis prison.
Le musée trouve ses origines dans la collection de monsieur Xavier Auclair (1829-1915), conducteur des Ponts et chaussées, collectionneur et peintre amateur, léguée à la ville de Saint-Amand-Montrond en 1916. À ce cabinet d’un amateur éclairé s’ajoute le fruit des fouilles archéologiques menées dans le Saint-Amandois : site gallo-romain de Drevant, forteresse de Montrond, site du Camp de César à la Groutte, pour ne citer que quelques exemples.
En matière de peinture, ce sont principalement des peintres locaux, ou qui ont séjourné à Saint-Amand, qui sont représentés. Le musée conserve ainsi la plus importante collection publique d’œuvres du peintre Léon Delachaux, ainsi qu’une dizaine de paysages de Jacques-Alfred Brielman.
Informations fournies par le musée
Fondé dès 1936, c’est en 1942 qu’est inauguré, dans l’ancienne mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer, le Musée camarguais (Museon Camarguen). Il accueille alors des collections en relation avec le patrimoine de la Camargue et le village, réunies par des défenseurs de la tradition, sous l’œil bienveillant du marquis Folco de Baroncelli. Dirigeant le journal félibréen « L’Aïoli » à Avignon, où sa famille possédait le palais du Roure, le marquis de Baroncelli fut un ardent défenseur des coutumes et du patrimoine traditionnel et culturel de la Camargue. Félibres et Saintois font des dons au musée et vont constituer une collection éclectique d’oiseaux de Camargue naturalisés, d’objets, de gravures, tableaux et meubles divers.
En 1945, le Musée camarguais devient le Musée Baroncelli en hommage au marquis mort deux ans plus tôt. Sa collection s’enrichit constamment d’objets et de documents en lien avec sa personnalité, ainsi que d’objets d’ethnographie locale.
Le Musée des Saintes-Maries-de-la-Mer va hériter des anciennes collections du Musée Baroncelli, aujourd’hui fermé, et conservera également tout un parcours sur l’archéologie maritime du littoral camarguais. Suite à la grande motivation de la municipalité à vouloir remettre en valeur ses collections, dont la figure du marquis de Baroncelli et son passé plus ancien, une nouvelle structure a été construite.
La présence sur la base Joconde des collections de ce nouveau musée, après 15 ans de fermeture, représente le moyen le plus efficace de les valoriser et de les transmettre auprès d’un large public.
Informations transmises par le musée
Ouvert en 1996 par le Département des Alpes-Maritimes, le musée des Merveilles se destine à la valorisation du plus vaste Monument Historique français classé : le site de gravures rupestres de la région du mont Bego (vallées des Merveilles et de Fontanalbe). Lieu de conservation, de recherche et d'exposition, le musée est un lieu de culture vivant qui appuie ses actions en direction des publics sur un patrimoine archéologique et ethno-logique d'exception. Dédié de façon prioritaire au patrimoine archéologique et rupestre alpin, il est aussi le réceptacle de la culture matérielle traditionnelle de la vallée de la Roya, l’une des vallées de l’arrière-pays niçois à la frontière avec l’Italie, et possède ainsi l’une des plus intéressantes collections d’objets ethnographiques des Alpes du Sud.
Tout dernièrement, le musée a fait l’acquisition d’un important fonds appartenant à un collectionneur local. Il s’agit d’une sélection de mille objets ethnographiques concernant la vie quotidienne, les activités commerciales, agropastorales et artisanales, l’enseignement, la médecine, les cultes… des populations locales entre le XIXème et le XXème siècles.
Grace au catalogue collectif national Joconde, il est possible maintenant de découvrir en ligne un échantillon de ces pièces remarquables ! D’autres versements viendront dans les prochains mois abonder ce répertoire virtuel qui témoigne de la richesse et de la diversité de ce patrimoine ethnographique alpin transfrontalier.
Informations fournies par le musée
Ce musée, ouvert en 1991, abrite la mémoire du cartonnage et de l’imprimerie qui ont fait la prospérité de Valréas. Il témoigne des modes de fabrication et d’impression de la boîte en carton, de ses origines à nos jours. Une collection de patrimoine industriel d’environ 30 000 pièces rassemble matériels, archives d’entreprises et documents iconographiques. Elle révèle la naissance et le développement d’une histoire industrielle dans la capitale française du cartonnage, Valréas, devenue le plus grand centre de cartonnage français atteignant une renommée mondiale. Reflets des évolutions techniques, économiques et sociales, les collections confirment la richesse des productions dans les domaines de la pharmacie, bijouterie, confiserie, parfumerie…
Au rez-de-chaussée, le parcours présente les différentes phases de fabrication des coffrets et étuis pliants en carton imprimé et retrace la chaîne opératoire des deux industries, l’historique du cartonnage et ses débuts avec la sériciculture (élevage des vers à soie), l’organisation du travail en atelier et à domicile, la lithographie, typographie, offset… Les objets d’archéologie industrielle, de savoir-faire et de traces de la mémoire ouvrière témoignent des mutations technologiques, économiques et sociales. Au dernier étage, un film sur la fabrication des boîtes en carton de nos jours complète la visite par une vision de l’entreprise moderne.
L’exposition de cette année, Jolies Frimousses, est l’occasion de débuter l’export sur Joconde des collections présentées.
Informations fournies par le musée
La Société polymathique du Morbihan est fondée à Vannes en 1826. Cette société savante a pour objet l'étude des sciences, des arts et de la philologie, et de réunir dans un musée divers spécimens naturels et autres curiosités. En 1853, elle crée un musée dédié à l’archéologie, qui recueille des milliers d’objets au cours des décennies suivantes. Depuis 1912, il est installé dans un manoir urbain du 15e siècle, Château Gaillard.
Aujourd’hui, le musée d’histoire et d’archéologie regroupe plus de 45.000 artefacts ou spécimens naturels d’une grande diversité. L’archéologie régionale comprend environ 8.000 objets issus de fouilles ou de découvertes isolées. Près de 2.000 proviennent de monuments funéraires néolithiques exceptionnels (grands tumulus carnacéens, dolmens, cairns, allées couvertes). À cela s’ajoutent plus de 800 objets de l’âge de Fer (tombes princières des Vénètes, haches à douille armoricaines, poignard de Quiberon, …) et 400 éléments pour l’âge du Bronze, essentiellement issus de dépôts métalliques. Pour l’époque gallo-romaine, il s’agit de 1.300 objets (agglomération et nécropole antiques de Vannes, grandes villas littorales, …). Des milliers d’objets extra-européens, d’antiquités méditerranéennes et d’histoire complètent l’ensemble, sans oublier les nombreux éléments naturels (15.000 plantes, 10.000 coquillages, 8.000 de géologie et 1000 de zoologie). En 2019, par une donation, l’intégralité de la collection devient municipale.
En 2020-2021, la création d’un nouvel outil de gestion pour les musées de Vannes permet une mise en ligne des collections et le versement de notices sur Joconde. Le musée concrétise ainsi son souhait de participer à ce catalogue collectif, afin de diffuser et valoriser la richesse et la diversité de notre patrimoine mobilier.
Informations fournies par le musée
Musées intégrés en 2020
Le musée Pincé, l’un des six musées de la Ville d’Angers, est consacré aux civilisations antiques et extra-européennes. Il est abrité dans l’hôtel de Pincé, édifice majeur de la Renaissance, construit par l’architecte Jean Delespine entre 1528 et la fin des années 1530. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques en 1875. Après une fermeture de quinze ans, il rouvre ses portes au public en février 2020, avec une nouvelle muséographie et des espaces rénovés.
Le musée trouve ses origines dans la riche collection de Lancelot-Théodore Turpin (1728-1859) de Crissé, artiste angevin et collectionneur passionné, léguée à la ville d’Angers en 1859. D’autres legs, des dons et des achats n’ont cessés d’enrichir les fonds du musée.
Cinq civilisations sont aujourd’hui mises à l’honneur dans le parcours permanent : l’antiquité grecque, étrusque et romaine, l’antiquité égyptienne, les civilisations précolombiennes, la civilisation chinoise et la civilisation japonaise.
Afin de préparer le nouveau parcours permanent, les oeuvres sélectionnées ont fait l’objet d’une étude scientifique et documentaire, conduisant parfois à de nouvelles attributions et de nouvelles datations. Les premiers versements des fiches d’œuvres dans Joconde (via la plate-forme ouverte du patrimoine) concernent ces objets. Les œuvres conservées en réserves feront également l’objet, dans un second temps, d’un travail similaire et d’un futur versement.
Informations fournies par le musée
Au coeur de la ville d’Arbois, capitale des vins du Jura, le musée de la vigne et du vin du Jura fut créé en 1970 à partir d’une première collecte d’outils par le « Groupe d’étude du vignoble d’Arbois ». Cette collection qui avait d’abord été rassemblée pour une exposition temporaire fut transformée en musée et installée dans les caves de l’hôtel de ville. En 1993, elle intégra, avec une nouvelle muséographie, le château Pécauld, classé Monument Historique (13e-18e). La collection (812 pièces dont 280 dépôts) a trait à la vigne, au vin, à la tonnellerie et aux vignerons jurassiens.
A la croisée des domaines entre ethnologie, science naturelle et histoire, le musée de la vigne et du vin du Jura présente les différentes méthodes de vinification dont les plus spécifiques : le macvin, le vin de paille et le fameux Vin jaune ! Sont évoquées également l’histoire et les traditions du monde vigneron : la grève de l’impôt au cours de l’hiver 1906 qui a conduit à la création des fruitières viticoles et de la première Caisse de Crédit agricole pour les financer ; la fête du Biou pour laquelle a été demandée l’inscription sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco ; saint Vernier et ses confréries ou encore la Percée du Vin jaune créée en 1995.
Le second récolement décennal de la collection s’est achevé en 2019. Sa diffusion, cinquante ans après sa création, sur le portail Joconde, marque une étape supplémentaire dans la valorisation du territoire jurassien, ses hommes (et femmes), son terroir et ses savoir-faire.
Informations fournies par le musée (Justine Sève-Brugnot, directrice des musées, des archives et du patrimoine)
Le musée municipal d’art et d’histoire présente au fil des collections le riche passé de la ville de Colombes.
Dès l’Ancien Régime, Colombes est le théâtre de destins exceptionnels : la reine Henriette (1609-1669), veuve de Charles Ier d’Angleterre, y passe ses dernières années. Sur l’île de Moulin Joly, Claude-Henri Watelet aménage un des premiers jardins pittoresques du siècle des Lumières.
Le développement industriel de Colombes aux 19e et 20e siècle (pneumatique, aéronautique, automobile, parfumerie) est marqué par des noms illustres tels Guerlain, Ericsson, Facel Vega...
Les collections racontent également l'épopée sportive du stade Yves-du-Manoir qui débuta son histoire avec les Jeux Olympiques de 1924 et resta le haut lieu des rencontres sportives en France jusqu'à la rénovation du Parc des Princes au début des années 1970.
La variété de la création artistique est perceptible à travers les dessins, peintures, estampes et sculptures du 17e au 20e siècle, avec des artistes aussi différents que Hendrich Van Balen, Gustave Bienvêtu, Victorine Meurent ou Asger Jorn.
Le premier versement sur Joconde a porté sur les collections liées aux Jeux Olympiques de 1924. Dans la perspective des Jeux de 2024, il est important de donner toute sa visibilité à cette collection de référence. Le deuxième versement met à l’honneur un peintre habitant de Colombes, qui a marqué la fin du 19e siècle par son indépendance tant de caractère que de style, Théodule Ribot.
Informations fournies par le musée
Créé par la volonté du peintre honfleurais Louis-Alexandre Dubourg (1821-1891), le musée municipal de Honfleur est officiellement ouvert au public en 1869 dans les locaux de l’hôtel de ville ; il est le plus ancien des musées de Honfleur. Transféré en 1924 dans le couvent des Augustines, il prend le nom de musée Eugène Boudin en 1960.
Il est ainsi constitué alors même que la ville est depuis quelques décennies déjà un carrefour artistique de premier plan, attirant là des peintres dont les travaux seront essentiels pour l’histoire de la peinture de paysage et la genèse de l’impressionnisme en particulier : on citera parmi d’autres Jean-Baptiste Camille Corot, Paul Huet, Charles-François Daubigny, Gustave Courbet, Johann Barthold Jongkind, Claude Monet mais aussi bien sûr Eugène Boudin, havrais depuis la prime adolescence mais qui nait à Honfleur en 1824. L’intérêt porté à la ville ne se dément pas au 20e siècle, les générations suivantes étant marquées par des peintres tels que Félix Vallotton, Paul-Elie Gernez ou encore Henri de Saint-Delis : le musée Eugène Boudin reflète ainsi par ses collections le succès artistique de cette ville et de la Normandie en général.
Souhaitant aujourd’hui donner une visibilité accrue à celles-ci en témoignant de leur importance, ce premier versement sur Joconde et les suivants ont choisi de privilégier les œuvres de l’artiste qui, entre tous, a probablement le plus marqué de son regard novateur le territoire : Eugène Boudin. Viendront ensuite ceux qui, au 19e siècle, assirent définitivement la place de la ville dans l’histoire de l’art.
Informations fournies par le musée (Benjamin Findinier, directeur des musées de Honfleur)
Créé en 1883, le musée d’Hyères présente la particularité d’avoir été pensé par ses créateurs avec cette indéniable volonté d’être tourné vers la Méditerranée. L'histoire de ses collections est fortement ancrée dans le territoire hyérois. D'abord, son fonds originel (plus de 6 000 spécimens naturalisés) regroupe des espèces vivant principalement dans le Var au 19ème siècle. Par la suite, le fonds s’enrichit de découvertes archéologiques réalisées sur le site gréco-romain d’Olbia. Enfin, en 1930, la collection Beaux-Arts prend son essor avec son quatrième conservateur Emmanuel-Charles Bénézit (fils du célèbre auteur du Dictionnaire des peintres). Riche d’environ 2 500 œuvres, ce fonds se consacre essentiellement à la peinture du 19ème siècle. Ainsi, par ses collections scientifiques, archéologiques, historiques et artistiques, le musée valorise la diversité des cultures et l’évolution du paysage hyérois. Après 18 ans d’absence, ces œuvres vont revoir le jour dans une ancienne succursale de la Banque de France située dans le centre-ville d’Hyères. En cours de réhabilitation, ce bâtiment ouvrira ses portes au public l’année prochaine.
Avant de pouvoir déambuler dans ce nouveau musée, ce versement de notre fonds sur la base Joconde constitue un premier pas vers la renaissance de cette collection originale qui relie nature et culture dans un même patrimoine.
Informations fournies par Amélie Bothereau-Gazaix, directrice de La Banque, musée des Cultures et du Paysage
Situé dans un ancien hôtel particulier, le musée d’Allard à Montbrison est l’un des plus anciens établissements uséographiques du département de la Loire. Fruit du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités constitué par Jean-Baptiste d’Allard dans la première moitié du 19e siècle, le musée a progressivement étendu ses collections au domaine des Beaux-Arts (fonds lié au poète Victor de Laprade et au peintre Albert Bréauté), ainsi qu’au thème des jeux et jouets. Constituée au milieu du 20e siècle à partir d’une donation de poupées anciennes et modernes, cette collection de jouets s’est structurée depuis ces dernière années autour de l’entreprise GéGé, valorisant ainsi le patrimoine industriel montbrisonnais. Le musée offre aujourd’hui à travers ses différentes collections un regard sur la nature, l’art et l’enfance.
En parallèle d’une campagne de récolement et de numérisation des fiches d’inventaires, le musée d’Allard a choisi de s’engager dans le versement de notices de quelques objets phares sur la base Joconde afin d’en offrir l’accès au plus grand nombre.
Informations fournies par le musée
Le Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) développe, depuis 2005, des collections pluridisciplinaires réparties en trois domaines : histoire, société et art contemporain. En perpétuel enrichissement, ce fonds compte aujourd’hui plus de 6.000 éléments, dont la mise en ligne représente un projet structurant de l’établissement.
Pour son premier versement sur POP, le MNHI a choisi un ensemble thématique en résonance avec l’année nationale de la bande-dessinée. A partir de 2012, dans le sillage de l’exposition Albums. Bande dessinée et immigration. 1913-2013, une cinquantaine de planches a rejoint les collections patrimoniales du MNHI, socle d’un fonds qui s’enrichit régulièrement et compte aujourd’hui 94 items. La bande dessinée constitue pour le MNHI un médium important du dialogue entre histoire et mémoire, à la confluence de ses trois domaines de collection. Son lien avec l’histoire de l’immigration est particulièrement fort, tant sur le plan des sujets que de l’origine des auteurs.
Les prochains versements du MNHI se feront l’écho de ses nouvelles acquisitions et des collections qui seront exposées dans le nouveau parcours permanent à partir de novembre 2021.
Informations fournies par le musée
Le musée archéologique de l’hôtel Goüin est constitué des collections de la Société archéologique de Touraine. Dès sa fondation en 1840, chaque nouveau membre était invité à lui offrir des objets ou des ouvrages relatifs à la Touraine. Ainsi s’est formé le fonds du musée, présentant un panorama de l’histoire tourangelle : archéologie préhistorique, gallo-romaine, sculptures et objets d’art du Moyen-Age et de la Renaissance, faïences et armes de l’époque moderne, rare ensemble d’objets de physique du 18e siècle, fonds de coiffes régionales, ainsi que quelques pièces « exotiques » provenant d’Egypte, de Grèce, ou de Mésopotamie.
Installé au centre de Tours, dans des bâtiments historiques successifs, le musée est abrité depuis le début des années 1970 dans l’hôtel Goüin, ancien hôtel particulier de la Renaissance, et doté de l’appellation « musée de France » depuis 2003.
Dans la perspective d’une modernisation du projet culturel et d’une rénovation du bâtiment, le musée est fermé en 2008, les collections sont confiées en gestion au Département et déménagées vers une réserve externalisée. Aujourd’hui, la réouverture d’un musée n’est plus d’actualité, certaines collections ont fait l’objet de dépôts dans des musées tourangeaux ou nationaux, d’autres sont présentées lors d’expositions temporaires.
A défaut d’un lieu dédié, la diffusion numérique de ces collections permet de développer une forme d’accessibilité et d’étendre leur valorisation.
Informations fournies par le musée
Inauguré en 1868 dans l’ancien hospice de la Ville, le musée municipal de Villeneuve-lez-Avignon permit d’accueillir les œuvres provenant des monuments religieux villeneuvois (Chartreuse du Val-de-Bénédiction, Collégiale Notre-Dame, Abbaye Saint-André), pour la plupart sauvées des pillages révolutionnaires.
Transféré en 1986 dans une ancienne livrée cardinalice, le musée présente aujourd’hui une sélection d’œuvres religieuses du 14e au 18e siècle dont une exceptionnelle Vierge en ivoire, Le Couronnement de la Vierge d’Enguerrand Quarton, chef-d’œuvre de la peinture médiévale, ainsi que des œuvres remarquables des 16e et 17e siècles, commandées par les moines chartreux aux plus grands artistes de leur temps : Simon de Châlons, Philippe de Champaigne, Nicolas Mignard ou encore Reynaud Levieux.
Des acquisitions plus récentes ont permis d’ouvrir la collection à la peinture moderne, à l’image du legs Hortense-Bourgue de 1998 comprenant 61 tableaux du peintre Joseph Meissonnier. En 2002, le fonds s’est considérablement développé avec l’acquisition d’une collection de 1.325 cartes postales anciennes de Villeneuve lez Avignon. Aux collections municipales, il convient d’ajouter quelques dépôts de l’Etat, dont la propriété a été récemment transférée à la Ville (céramiques antiques de la collection Campana, peintures déposées par le Louvre et le FNAC). Au total, ce sont environ 2.000 objets qui sont conservés dans les collections du musée, un peu plus d’une centaine étant présentée dans le parcours permanent.
Les travaux menés à l’occasion du récolement décennal ont permis d’approfondir la connaissance des collections et d’achever leur couverture photographique afin qu’elles puissent être diffusées le plus largement possible auprès du public et des institutions partenaires via le portail Joconde.
Informations fournies par le musée
Partager la page