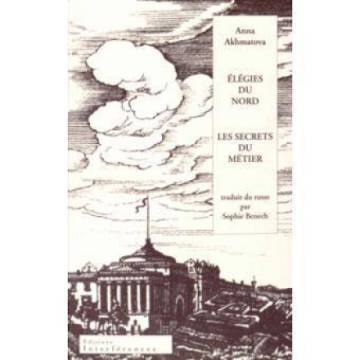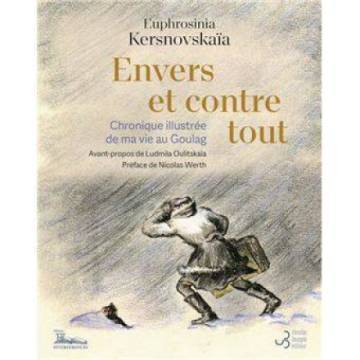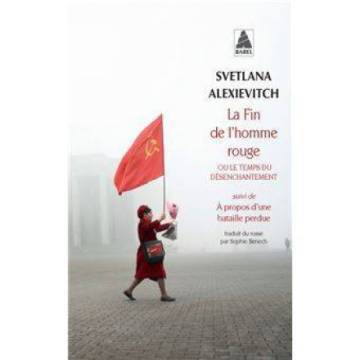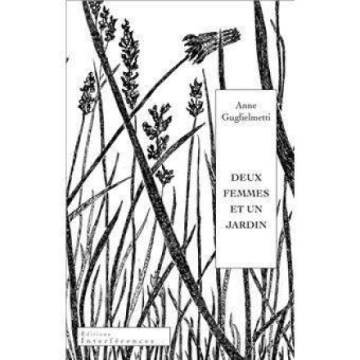C’est chez elle, en plein Paris, que Sophie Benech nous reçoit, autour d’un thé qui, déjà, fait signe vers la légendaire hospitalité russe. Car la Russie, son histoire, sa culture et surtout sa littérature, sont omniprésentes chez cette traductrice chevronnée, lauréate, fin 2021, du Grand Prix de la traduction, décerné conjointement par le ministère de la Culture et la Société des Gens de lettres (SGDL).
En témoignent les auteurs majeurs qu’elle a contribué à faire connaître ou à populariser en France, les Varlam Chalamov, Anna Akhmatova ou Isaac Babel, pour ne citer qu’eux, mais aussi, du côté des contemporains, l’emblématique prix Nobel de littérature 2013, Svetlana Alexievitch. Plus qu’un métier, la traduction est, à l’évidence, une passion fixe chez celle qui a également fondé, aux côtés de son père Alain Benech, ancien libraire, les éditions Interférences.
Comment êtes-vous venue à la langue russe ?
Par goût pour la littérature autant que par hasard, à moins que ce ne soit le destin ! Alors que je venais de terminer mes études, je suis allée voir une amie qui travaillait comme jeune fille au pair en Russie. Les gens que j’ai rencontrés m’ont tout de suite beaucoup impressionnée, c'est sans doute en partie grâce à eux que je me suis prise d'amour pour le pays. Un poste de standardiste se libérait au même moment à l’ambassade de France. Je ne parlais pas la langue, j’avais seulement pris quelques cours avec une vieille dame russe avant de partir, mais une fois en URSS, je n'ai fréquenté que des russes, j'ai donc appris « sur le tas », comme les enfants. Au téléphone, quand quelqu’un me parlait, je notais tout en phonétique, et si on me raccrochait au nez, je rappelais, je me débrouillais, comme je pouvais. Il faut dire que grâce à mes études de latin et de grec, j’avais le cerveau un peu entraîné ! En outre, le russe m'attirait déjà, Les Frères Karamazov a été une lecture marquante de mon adolescence.
Comment, ensuite, vous êtes-vous dirigée vers la traduction ?
À mon retour, je voulais travailler dans une maison d’édition, j’ai envoyé des lettres à droite et à gauche, et au bout de plusieurs mois, Gallimard m’a répondu en me proposant de rédiger des notes de lecture sur les livres en russe que la maison recevait. J’ai fait cela pendant deux, trois ans, et parallèlement, j'accompagnais des voyages en Union soviétique. On était alors en pleine perestroïka [mouvement de libéralisation de la société soviétique impulsé par Michaïl Gorbatchev de 1985 à 1991]. Les journaux et les revues étaient remplis de textes jusque-là interdits et je suis tombée sur un petit essai sur la lecture de Varlam Chalamov inédit en français. J’ai contacté la personne qui l’avait publié et qui n’était autre que son héritière. J’en ai aussitôt informé Gallimard, en leur proposant la correspondance entre Chalamov et Pasternak. Ma carrière de traductrice a débuté comme cela. Ils m’ont dit de choisir un texte qui n’avait jamais été traduit et j’ai commencé avec cet essai trouvé dans les journaux. J’y ai tout de suite pris goût : la traduction me permettait de faire connaître la culture russe aux Français et de travailler avec la langue française que j’adore. En somme, tout ce que j’aimais se trouvait réuni.
Le plus beau compliment, c’est lorsqu’une personne qui maîtrise les deux langues vous dit qu’en lisant en français, elle entend la voix de l’auteur russe
Qu’est ce qu’un bon traducteur ?
Il est difficile de dire à quoi cela tient. En fait, on n'en sait rien. Chaque traducteur a sa propre perception d’un texte et sa manière de le rendre. Parfois, on se dit que l’on aurait fait différemment mais c’est quand même formidable ; d’autres fois, on se rend compte que l’on perçoit le texte autrement : à part les contresens et les faux sens, qui sont l'équivalent des fausses notes, personne ne peut dire qu'une interprétation est meilleure qu’une autre - juste qu'elle nous touche davantage.
Qu’est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans la traduction ?
Peut-être le moment où l’on absorbe le texte dans la langue originale, où il se "décompose" à l'intérieur de vous, se recompose, et que vous le transposez dans votre langue. C’est un processus qui se déroule au-delà des mots. On est heureux si on a l'impression d’avoir saisi un peu de la musique de la langue, du style. Parfois, cela tient à presque rien. Il suffit d’intervertir deux mots, de changer ou de déplacer un adjectif pour que le texte se mette à vivre. Mais on transmet, ce que l'on ressent, toute traduction est donc obligatoirement subjective. Le plus beau compliment, c’est lorsqu’une personne qui maîtrise les deux langues vous dit qu’en lisant en français, elle entend la voix de l’auteur russe.
Le traducteur travaille sur le temps long…
Quand on traduit un livre, on vit pendant plusieurs mois avec l'auteur. Et s'imprégner du style d'un auteur, c'est pénétrer très profondément dans son univers, dans son être même. Alors, mieux vaut avoir affaire à une personne de valeur, à quelqu'un qui vous est proche ou sympathique. C'est une chance immense de pouvoir passer des mois en compagnie de gens comme Akhmatova ou Babel... En les traduisant, il m’est souvent arrivé d’avoir la sensation qu’ils étaient à côté de moi.
Vous le disiez à l’instant, vous avez traduit de nombreux auteurs qui ont tous été marqués par la terreur stalinienne, comme Anna Akhmatova, Isaac Babel ou Varlam Chalamov. Pourquoi est-il indispensable de faire connaître leurs témoignages aux jeunes générations ?
J’ai souvent l’impression qu’on a un peu tendance à oublier, aujourd’hui, les millions de morts imputables au régime soviétique. Les auteurs que vous venez de citer, qui sont traduits dans le monde entier, sont là pour faire entendre la voix de tous ces morts, et les traduire, c'est en quelque sorte honorer le souvenir de ces nombreuses victimes. J'ai aussi traduit Envers et contre tout - chronique illustrée de ma vie au Goulag d’Euphrosinia Kernovskaïa paru dans les années 1990 et réédité en 2021 (co-édition Christian Bourgois/Interférences). Les jeunes générations vont, je l'espère, découvrir ce livre à l’occasion de sa réédition.
En plus de l’importance de leur témoignage, il y a chez chacun d’eux une très grande qualité formelle…
Quand un auteur a longtemps travaillé ses textes et son style, quand on sait que chaque détail a été mûrement réfléchi, il est normal que l'on se creuse aussi la tête pour le traduire. Mais se creuser la tête pendant des heures sur une phrase bancale écrite à la va vite, c'est agaçant!
J'ai pour principe de rester fidèle le plus possible à l'original. Quand je traduis de grands auteurs, je ne me sens pas le droit de corriger ce qui me semble être des maladresses ou des lourdeurs. Après tout, c'est l'auteur l'écrivain, pas moi. Et qui sait ? Peut-être ce qui apparaît comme un défaut est justement un des éléments qui donne vie et beauté à un texte ?
Vous avez aussi traduit La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch. En quoi cette expérience a-t-elle importante pour vous ?
C’est un livre essentiel pour comprendre la Russie d'aujourd’hui, je pense qu'il peut nuancer et approfondir le regard que les Français portent sur ce pays et ses habitants. Pour le traducteur, le défi, ici, c’était de rendre l’oralité et la diversité des voix.
La traduction d'une œuvre littéraire, c'est comme l'interprétation d'une œuvre musicale : certaines nous touchent plus que d'autres
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Je suis en train de préparer un petit recueil de nouvelles de Tchekhov pour ma maison d’édition.
… Car vous êtes aussi éditrice. Dans le catalogue d’Interférences, la maison que vous avez fondée avec votre père, on trouve beaucoup d’auteurs russes. C’était pour vous une évidence ?
Éditer me permet de publier les textes que je découvre, et c’est une autre corde à mon arc. J’avais envie de traduire Tchekhov parce qu’il est apparemment simple à traduire mais ce n’est pas tout à fait vrai.
Dans votre catalogue, on trouve aussi des classiques français, Maupassant, Hugo, de la littérature anglo-saxonne…
Je voudrais ne pas me limiter à la littérature russe, même si la maison d'édition est davantage reconnue pour le domaine russe. Mais je suis avant tout guidée par mes goûts et mes découvertes.
Enfin, vous avez édité l’an passé un texte français de littérature contemporaine. Une première, pour vous ?
Oui. Le livre s'intitule Deux femmes et un jardin. Son auteur, Anne Guglielmetti, m’avait envoyé le texte et je l’ai lu d’une traite, il m’a tout de suite plu. Nous avons commencé par le tirer à mille exemplaires, mais nous avons dû réimprimer plusieurs fois depuis. Comme je vous l'ai dit plus haut, notre principe, c'est de ne pas en avoir et d'éditer ce qui nous plaît !
Que permet un prix comme celui qui vous a été remis ?
Ce prix est le signe que la traduction est soutenue et reconnue dans notre pays. Et puis, la somme qui l'accompagne est loin d'être triviale pour un traducteur. Anne Colin du Terrail, lauréate de la première édition, a dit que son montant équivalait à peu près à ce qu’elle gagnait en un an, je peux reprendre cette affirmation à mon compte !
Traduction : les soutiens du Centre national du livre contribuent au dynamisme du secteur
Opérateur du ministère de la Culture pour la mise en œuvre de sa politique en faveur du livre, le Centre national du livre contribue au dynamisme et à la diversité du secteur de la traduction en France.
Parmi ses principales initiatives, signalons la création, en 2012, de l’École de traduction littéraire (ETL) destinée à former, en partenariat avec l’Asfored, un organisme reconnu de formation aux métiers de l’édition, de nouvelles générations de traducteurs professionnels.
Par ailleurs, le Centre national du livre accompagne ces acteurs majeurs de la chaîne du livre que sont les traducteurs en proposant deux soutiens :
- la bourse aux traducteurs des langues étrangères vers le français a pour objet de permettre aux traducteurs de se consacrer, en France ou à l’étranger, à un projet individuel et personnel de traduction de grande ampleur, à des fins de publication ;
- la bourse de séjour aux traducteurs du français vers les langues étrangères a pour objet de développer le réseau des traducteurs professionnels du français ou d’une des langues de France vers les langues étrangères en leur offrant la possibilité de séjourner en France pour y mener un projet de traduction d’ouvrages français ou écrit dans une des langues de France à des fins de publication.
Partager la page