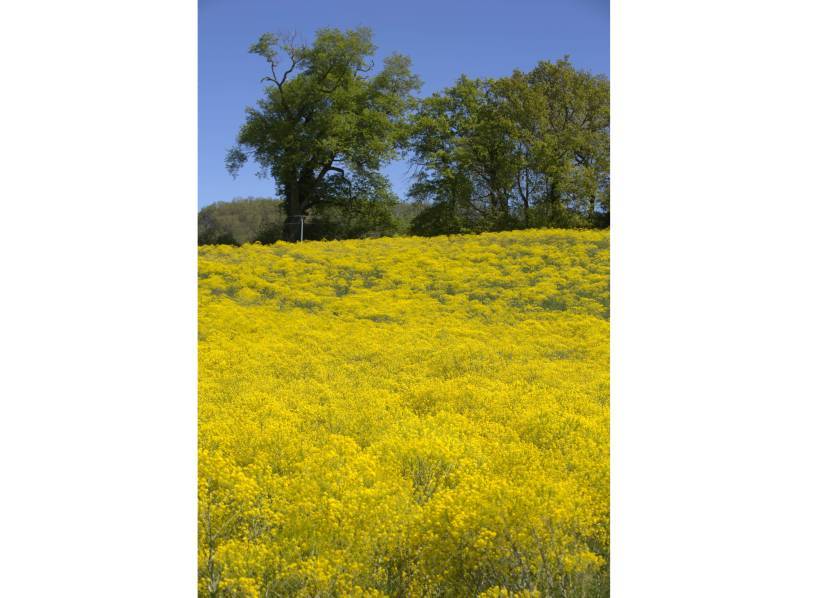Au Moyen Âge, le pastel est cultivé un peu partout en France et principalement en Picardie, pour obtenir des teintures bleues, vertes, violettes et brunes. À partir de la fin du Moyen Âge, le bleu gagne en importance dans la hiérarchie des couleurs et une forte demande émerge. C’est à ce moment-là que le pays de Cocagne – formé par le triangle Albi-Carcassonne-Toulouse, en Occitanie – tire son épingle du jeu grâce à son fort ensoleillement. La culture du pastel fait alors la richesse de ce territoire jusqu’au 16e siècle et lui donne même son nom : la cocagne désigne une boule de feuilles de pastel broyées et séchées.
Macération, fermentation, oxydation
Le pigment bleu est invisible des feuilles de pastel dont il est extrait. Il n’apparaît qu’au terme d’une série d’étapes qui demandent un savoir-faire rigoureux. Après la récolte, les feuilles sont mises à macérer dans de l’eau chaude. L’infusion obtenue est filtrée, puis mélangée à de la chaux avant d’être battue. Le précipité qui tombe au fond de la cuve est alors filtré et séché pour obtenir un pigment coloré solide. Pour pouvoir l’utiliser en teinture, il faut le rendre soluble. Il est alors dilué dans un bain composé d’eau, de chaux et de son. Les fibres textiles y sont plongées, puis retirées : c’est lors de leur exposition à l’air que la magie opère. L’oxydation révèle le bleu caractéristique, qui s’intensifie au fil des immersions.
Un renouveau au tournant du 21e siècle
Au 17e siècle, l’arrivée de l’indigo exotique, importé des Indes et d’Amérique, concurrence fortement le pastel. La découverte de l’indigo synthétique en 1897 marque un tournant : le pastel disparaît des chants et des teintureries. Aujourd’hui, la culture du pastel connaît un nouveau souffle en Occitanie. Ses usages se diversifient : textiles, cosmétiques, éco-matériaux, peintures… et les maîtres teinturiers, artisans d’art et créateurs designers, soutenus par les offices de tourisme, s’efforcent de faire vivre ce savoir-faire unique. Le marché reste cependant incertain, car la qualité et la quantité de pigment produit varient fortement d’une année à l’autre, en fonction des conditions climatiques et des méthodes culturales.
L’Académie des Sciences et des Arts du Pastel, fondée en 2004, a pour vocation d’étudier et de faire connaître au plus grand nombre le pastel, dans les domaines artistique, scientifique, social, économique et patrimonial. Les savoir-faire liés à la teinture au pastel, en pays de Cocagne, ont été inclus à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel en 2021 afin d’envisager plusieurs mesures de sauvegarde.
Annete Hardouin dans son atelier de teinturier. Elle travaille depuis 20 ans à la coloration du pastel et tient une boutique spécialisée dans le centre ville de Toulouse, AHPI. 29 avril 2025, Toulouse.
Crédits : Bertrand Fannonel/MC/Sipa Press
Chants, savoir-faire, jeux, fêtes... découvrez près de chez vous un patrimoine vivant et en perpétuel renouvellement : Vivre le patrimoine culturel immatériel.
Partager la page