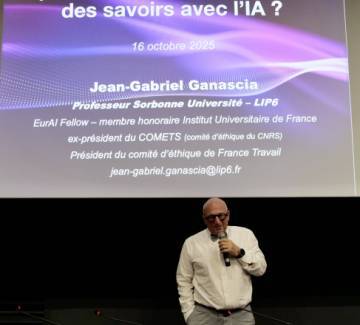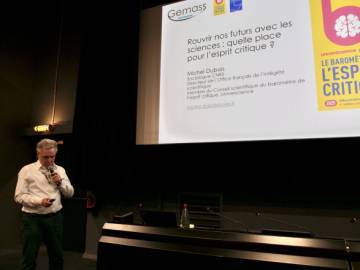La session actuelle du CHEC poursuit ses réflexions sur le futur en construction et le rôle de la culture dans les métamorphoses en cours pour promouvoir la diversité culturelle et favoriser la transmission des savoirs.
La journée du 15 octobre a permis aux auditrices et auditeurs de réfléchir à la portée et aux perspectives d’avenir de la Convention UNESCO de 2005 sur la diversité culturelle et au rôle que peut jouer la France dans la promotion de cette diversité.
La journée a débuté par une conférence de Vincent Billerey, administrateur du musée Guimet, qui a présenté les nouvelles formes de l’engagement de l’institution en faveur du dialogue interculturel. Après avoir rappelé l’histoire du musée Guimet, il a présenté les initiatives récentes mises en place par celui-ci pour faire face aux enjeux interculturels (programmation thématique, forums tenus par des fondations, Ateliers Guimet dans toute la France...), témoignant de la façon dont une telle institution, peut se renouveler tout en poursuivant son service de valorisation des arts asiatiques.
La journée s’est poursuivie avec une table ronde réunissant Didier Le Bret, ambassadeur et directeur de l’Académie diplomatique et consulaire, et Jean Musitelli, ambassadeur et ancien délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, tous deux revenant sur l’historique et les enjeux des négociations qui ont permis d’aboutir à la convention internationale de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2005. L’occasion de rappeler à toutes et tous que la France, pionnière dans la protection des biens et services culturels face au libre-échange, au travers du principe d’exception culturelle, a joué un rôle prépondérant dans cette convention historique, en plaidant pour le passage d’une simple déclaration à une convention, véritable instrument juridique international protégeant la diversité des expressions culturelles. Toussaint Tiendrebeogo, secrétaire de la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’UNESCO, a ensuite exposé les actions actuelles pour la diversité culturelle, issues de la Convention, menées par l’organisation. Cet inventaire des mesures actuelles pour garantir la diversité culturelle a rappelé aux auditrices et auditeurs des deux cycles présents l’importance des valeurs portées par la convention, non seulement dans les échanges diplomatiques, mais en tant qu’outil de développement économique, social et identitaire au sein de la société civile.
Les échanges suivants ont mis en perspective les difficultés d’application posant notamment la question de leur caractérisation dans les pays du Sud. Faisant dialoguer Ahlem Gharbi, ambassadrice et déléguée permanente de la France auprès de l’Unesco, Pascal Rogard, directeur général de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et président de la Coalition française pour la diversité culturelle, et Yannick Faure, chef du Service des affaires juridiques et internationales au Ministère de la Culture, cette table ronde intitulée « Quels chantiers pour l’avenir ? » a permis d’ouvrir le débat sur la place de la France dans la nouvelle diplomatie culturelle mondiale. Comment faire dialoguer, au sein de l’UNESCO, des pays aux histoires culturelles aussi différentes, et traduire une diversité de situations en un vocabulaire commun ?
L’après-midi de cette journée consacrée à la diversité culturelle a débuté par une visite guidée à travers les collections du musée Guimet, qui a mis en valeur l’extraordinaire circulation des thèmes, des histoires et des formes d’art entre les pays d’Asie, et la fonction essentielle de transmission historique et culturelle incarnée par le musée.
Dans le droit fil de ces réflexions sur les échanges interculturels, une intervention de Paul Petit, délégué général adjoint à la langue française et aux langues de France, a mis en exergue l’enjeu de préservation de la diversité des langues à l’ère de l’intelligence artificielle. L’outillage des IA pour le langage est en effet une question politique d’envergure, et un chantier qui s’ajoute à celui déjà entamé pour faire face à la prédominance de l’anglais dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Le thème de la transmission interculturelle a trouvé une autre expression dans le retour d’expériences des voyages d’études des auditeurs du CHEAD, cinq groupes partis respectivement au Maroc, en Chine, au Vietnam, au Mexique et au Brésil dans le but de documenter l’actualité des échanges interculturels entre la France et ces pays. Leurs témoignages, véritables retours d’étonnements ont permis de mettre en lumière de manière vivante les initiatives culturelles remarquables et l’organisation de la politique culturelle au sein de ces pays.
C’est à la Cité des Sciences et de l’Industrie que s’est poursuivi ce second module, le 16 octobre .
Les auditrices et auditeurs du CHEC y ont été accueillis le matin par l’équipe d’Universcience, avec d’abord une intervention de la directrice générale et présidente par intérim, Delphine Samsoen. Celle-ci a rappelé la nécessité vitale d’œuvrer pour la diffusion de la culture scientifique aujourd’hui, à l’heure où la confiance dans les sciences est parfois remise en cause et où la résignation devant le changement climatique progresse. Elle a énuméré les missions de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la découverte dans le champ de la transmission des savoirs culturels scientifiques, en dressant un état des lieux encourageant des données en matière d’intérêt pour les sciences et de fréquentation du musée (il s’agit du 3e musée français le plus fréquenté par les jeunes et classes populaires). La Cité tâche de rendre les sciences accessibles en proposant des expériences participatives et des rencontres visant à inscrire les disciplines scientifiques dans le champ des possibles de tous les jeunes.
La matinée s’est poursuivie avec une intervention foisonnante de Jean-Gabriel Ganascia, professeur émérite à Sorbonne Université, philosophe et informaticien expert en intelligence artificielle, président du comité d’orientation du CHEC. Replaçant le succès des IA génératives dans une histoire longue des (r)évolutions technologiques, allant de Pascal à Yann Le Cun, il a montré comment l’advenue des réseaux de neurones appliqués aux IA génératives avait découlé d’une évolution lente des consciences, préparée par un ensemble d’expérimentations culturelles et philosophiques. L’occasion d’instruire les auditrices et auditeurs au sujet de la question de la créativité des machines, qui, loin d’être nouvelle, alimente la culture scientifique depuis au moins trois siècles.
Approfondissant le thème de la réception des savoirs scientifiques, le sociologue Michel Dubois, directeur de recherche au CNRS et directeur du GEMASS (Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne), a présenté ses analyses issues des données recueillies grâce au baromètre de l’esprit critique. Ces dernières témoignent des nuances et précautions à adopter en évoquant l’esprit critique des français, puisque la critique à l’égard du progrès est consubstantielle au progrès même et ne signale pas nécessairement un recul de l’esprit critique. L’influence d’un positionnement idéologique anti-institutions peut par exemple mener à une méfiance à l’égard des sciences perçues comme une institution soumise à des pressions extérieures, sans pour autant signifier un recul de l’esprit critique. La France est à cet égard le pays présentant le plus haut taux d’ambivalence entre défiance et confiance.
Le déjeuner-buffet organisé par la Cité des Sciences et de l'Industrie a été l’occasion, pour les auditeurs de rencontrer les chercheurs accueillis en résidence dans le cadre du programme international Jeunes talents scientifiques.
Le 16 après-midi, Emmanuel Ethis, délégué interministériel à l’Éducation artistique et culturelle, est intervenu pour parler de l’importance de l’EAC en tant qu’éducation pour la vie. Il a présenté les points essentiels de la charte pour l’EAC en insistant sur les trois dimensions fondamentales que sont la pratique, la connaissance et la rencontre.
La journée s’est poursuivie par une visite de l’exposition sur l’Intelligence Artificielle accueillie par la Cité des Sciences et de l'Industrie, portant un regard critique sur les espoirs suscités par l’IA ainsi que sur la menace sociale (quels métiers sont en danger ?) et environnementale qu’elle représente. Les auditeurs ont ensuite pu découvrir le Fablab de la Cité des Sciences et de l'Industrie, laboratoire d’expérimentation collective accueillant les usagers porteurs de projets nécessitant l’utilisation d’imprimantes 3D et autres outils de fabrication numérique, un exemple concret de démocratisation de la culture scientifique.
Trois ateliers sur l’esprit critique ont enfin été proposés aux auditrices et auditeurs (sur le « greenwashing », les biais cognitifs et le vrai et le faux). Ces ateliers ont permis au groupe de comprendre comment l’institution menait sa politique de transmission des savoirs en s’adaptant à des publics scolaires divers. La journée s’est achevée par une séance de travail entre groupes.
La dernière journée du module s’est déroulée à la Sorbonne Nouvelle, sur le campus de Nation, ouvert en 2022. Mickaël Ribraud, maître de conférences et vice-président de l’université Sorbonne Nouvelle et Toni Legouda, directeur général des services, ont ouvert cette dernière journée, introduisant les missions de l’Université en matière de dialogue interculturel. C’est ensuite Kevin Jaglin, délégué à la culture à la Sorbonne Nouvelle et auditeur du CHEC 24-25, qui a présenté la grande richesse des initiatives mises en œuvre pour nourrir la vie culturelle et artistique du Campus (billetterie universitaire, ateliers de pratique artistique, statut d’étudiant-artiste, programmation d’une saison culturelle...).
Ces questionnements introduits sur le rôle des institutions pour faire vivre l’art et les jeunes artistes ont trouvé des prolongements féconds grâce à la table ronde sur l’avenir des formations aux carrières culturelles, faisant dialoguer Charles Personnaz, directeur de l’Institut National du Patrimoine, Charlotte Fouchet-Ishii, directrice de l’Ecole Nationale Supérieure d’art de Paris Cergy (ENSAPC), auditrice de la septième session du CHEC, et Mickaël Ribreau. Le débat s’est articulé autour de la tension entre la double exigence des formations artistiques, celle d’expérimentation et de professionnalisation.
Les échanges suivants ont décentré le regard des auditrices et auditeurs en introduisant à propos de l’Inde et des pays du Golfe la façon dont ces pays parient sur les industries culturelles et créatives pour leur avenir. Cécile Caillou-Robert, chargée de mission auprès du directeur de l’Afrique et du Moyen-Orient et auditrice de la septième session du CHEC, est intervenue aux côtés d’Hervé Barbaret, directeur général de France Muséums, pour témoigner de la façon dont ces pays s’engagent et se positionnent comme acteurs mondiaux de premier plan en matière de développement de la culture, que ce soit par l’ambition universelle de nouvelles structures (le Louvre Abu Dhabi) que par le soutien aux artistes émergents ou la lutte contre le trafic de biens culturels. Ces réflexions ont fait écho aux débats de la première journée sur la diplomatie d’influence et le nécessaire dépassement de l’universalisme ethnocentré pour entrer en dialogue avec les nouveaux acteurs culturels mondiaux.
L’après-midi du 17 octobre s’est ouvert par une intervention de Naomi Peres, directrice générale de la Démocratie Culturelle, des Enseignements et de la Recherche (DGDCER) au ministère de la Culture, au sujet de la transmission comme priorité des politiques culturelles. La présentation des dispositifs et des chantiers à mener au sein de cette direction nouvellement créée ont été l‘occasion d’un échange fécond avec les auditrices et auditeurs, dont certains ont aussi abordé les actions en faveur de la présence de l’art dans l’espace urbain, et la proposition de loi déposée au Sénat sur la mis en place d’une clause culture
C’est au groupe de travail « Culture des jeunes adultes, quelles inflexions générationnelles dans les pratiques ? » de la session 24-25 du CHEC qu’est revenue la tâche de clôturer cette journée, aux côtés du cinéaste et consultant en innovation culturelle et stratégies numériques Benoît Labourdette. Le groupe est revenu sur les principales conclusions et préconisations de son rapport (à découvrir en janvier 2026 sur le site du Ministère) — passage d’une politique de l’offre à une politique de la demande, considération et confiance à l’égard des jeunes qui doivent être associés à la programmation et à l’encadrement des manifestations culturelles — qui sont entrées en résonance avec les réflexions de Benoît Labourdette issues de ses rencontres sur le terrain avec les jeunes. Pour lui, il s’agit désormais pour les artistes-enseignants d’accepter de valoriser le processus en défaisant l’exigence de résultat et en se plaçant non plus en meneur mais en collaborateur aux côtés des apprenants.
Une belle conclusion à ce module ayant vocation à inspirer les auditeurs dans leur réflexion sur de meilleures façons de transmettre et de promouvoir les expressions culturelles de demain.
Partager la page