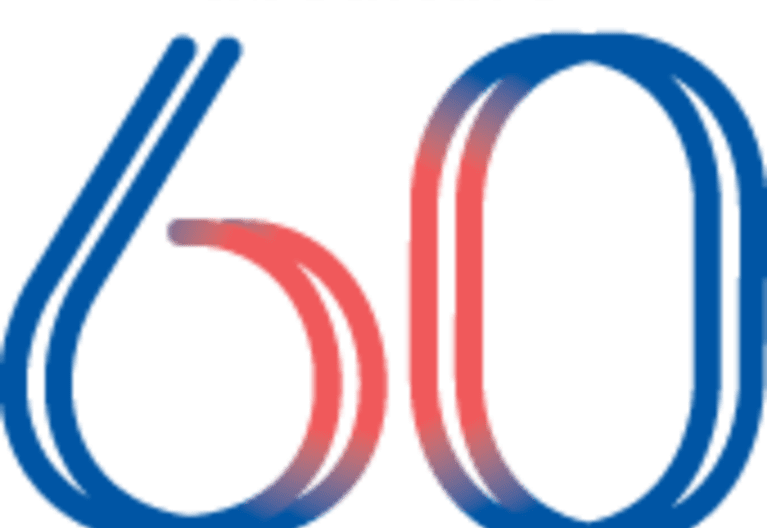Actes du colloque organisé à Paris, Auditorium du Louvre, les 19 et 20 décembre 2019, Agathe de Legge et Michel Kneubühler (coord.), Comité d'histoire du ministère de la Culture, éd. La passe du vent, 2020, 388 p.- (coll. Faire cité)
En 2019, le ministère de la Culture a fêté ses soixante ans et le Comité d’histoire, en partenariat avec le musée du Louvre, a organisé un colloque intitulé Du partage des chefs-d’œuvre à la garantie des droits culturels : ruptures et continuité dans la politique culturelle française. Le présent ouvrage restitue les différentes communications, discussions et tables rondes qui ont eu lieu durant les deux jours du colloque.
« Un débat à poursuivre »
Après sept décennies de réflexions ayant conduit à la rédaction de textes fondamentaux, il aurait pu paraître superflu que, pour clore l’année du soixantième anniversaire de sa fondation par André Malraux, le ministère de la Culture retienne précisément ce thème des droits culturels. Les contributions et les échanges retracés dans le présent ouvrage, qui doit énormément à son coordonnateur éditorial Michel Kneubühler, qui fut aussi celui du colloque, montrent au contraire que ce choix répond à des enjeux actuels et essentiels, pour la politique culturelle française comme pour celles que mènent d’autres États ou collectivités publiques, voire, plus généralement, pour les institutions, collectifs ou associations qui interviennent dans le champ de la culture. Il me semble donc que, grâce à la qualité de la trentaine d’intervenants sollicités – que l’on ne saurait trop remercier –, ces deux jours de colloque tenus dans le bel auditorium du musée du Louvre – lieu ô combien symbolique ! – ont permis d’aborder ce thème à travers un prisme inédit :
- d’abord, parce que, conformément à la mission que son fondateur, mon prédécesseur Augustin Girard, lui a assignée, le Comité d’histoire du ministère de la Culture a souhaité poser cette question des droits culturels dans une perspective historique, débordant du reste assez largement, comme l’ont montré plusieurs intervenants, tels Pascal Ory ou Guy Saez, les six décennies écoulées depuis Malraux – le titre choisi, « Du partage des chefs-d’œuvre à la garantie des droits culturels » exprime bien cette dimension diachronique ;
- ensuite, parce que, dans la diversité de leurs positionnements, les intervenants ont couvert un large spectre, à la fois en termes de disciplines académiques – histoire, sociologie, droit, philosophie, linguistique... – et de fonctions – responsables politiques (y compris deux anciens ministres, Jacques Toubon et Catherine Tasca), universitaires, élus, responsables administratifs, artistes, acteurs associatifs, porteurs de projet... sans oublier les étudiants de l’Université Grenoble Alpes ;
- enfin, parce que les contributions et les tables rondes ont pris en compte, au-delà de l’ensemble du champ d’intervention du ministère de la Culture – dans toute sa diversité, la création artistique, les patrimoines, les langues, l’action culturelle... –, la question de la démocratie culturelle, fondée sur une conception large de la culture, proche de celles que proposent l’UNESCO ou le groupe de Fribourg.
Extrait de la postface de Maryvonne de Saint Pulgent, présidente honoraire de section au Conseil d’État, présidente du Comité d’histoire du ministère de la Culture.
__________________
Contributions :
Catherine Blondeau, Marie Cornu, Mireille Delmas-Marty, Benoît de l’Estoile, Bernard Faivre d’Arcier, Anaïs Fléchet, Jérôme Fromageau, Michèle Gendreau-Massaloux, Jean-Marie Klinkenberg, Jean Lebrun, Yannick Lintz, André Markowicz, Marie-Claire Martel, Laurent Martin, Mourad Merzouki, Patrice Meyer-Bisch, Rozenn Milin, Jean-Baptiste Minnaert, Ariane Mnouchkine, Xavier North, Pascal Ory, Sonia Pignot, Isabelle Pypaert Perrin, Jean-Michel Rachet, Céline Romainville, Guy Saez, Maryvonne de Saint Pulgent, Catherine Tasca, Jacques Toubon, Olivier Van Hee, Noé Wagener.
Coordination éditoriale : Agathe de Legge et Michel Kneubühler