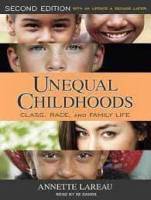Étudier la vie quotidienne des enfants pour mieux saisir la fabrique des inégalités culturelles, tel est le projet d'un ouvrage passionnant du ministère de la Culture.
Le ministère de la Culture (Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation) et les presses de Sciences Po rassemblent dans un livre, Inégalités culturelles : retour en enfance, sous la direction de Sylvie Octobre et Régine Sirota, les contributions d’une quinzaine de chercheurs qui ont pris le temps de recueillir auprès des enfants eux-mêmes ou de leurs familles ou encadrants, en les écoutant et en observant leur vie, tous les éléments constitutifs des inégalités culturelles qu’ils doivent ou devront affronter.
Cette publication fait suite à un colloque international qui s’était tenu à la Sorbonne en novembre 2019. Sylvie Octobre, chargée d’étude au DEPS et chercheuse associée au Centre Max-Weber, nous présente cet ouvrage qui rassemble sur ce sujet la fine fleur de la recherche actuelle.
Pour comprendre les inégalités culturelles dont les enfants font l’expérience, les chercheurs, dont les contributions sont réunies dans cette publication, ont une méthode : explorer la subjectivité enfantine. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Sylvie Octobre : Nous essayons d’écouter la parole des enfants. Chacun sait qu’ils ne voient pas les choses ni n’en parlent de la même manière que les adultes, mais encore faut-il s’y intéresser de près. C’est pourquoi nous avons essayé de rassembler des travaux qui étudient l’enfant non pas seulement comme objet mais comme sujet des inégalités. Il les vit et il y réagit différemment.
En revanche, si l’on se contente de considérer l’enfant comme un simple objet d’inégalités, on peut s’en tenir à une sociologie de la famille, par exemple, où il sera étudié indirectement. On s’éloigne alors de ce que l’enfant ressent et exprime en famille, on abandonne son propre point de vue.
En 2020, la pandémie a révélé brutalement l’existence d’une expérience enfantine bien spécifique. On l’a vu quand on a fermé des classes et que la fermeture des cantines a fait apparaître pour certains enfants des risques de malnutrition. On a vu aussi que certains enfants, notamment ceux des personnels soignants, devaient rester seuls à la maison, les aînés s’occupant des petits, pendant que leurs parents étaient au front de la pandémie. Les inégalités dans l’enfance sont apparues tout à coup au grand jour.
En quoi cette approche de la subjectivité enfantine permet-elle de mieux percevoir les inégalités ?
Elle permet de percevoir un certain nombre de différences. Par exemple, l’enfant vit la pauvreté à sa façon. Il n’a pas les mêmes besoins, il n’a pas les mêmes rapports à son environnement. Un de ses problèmes, c’est d’accéder à des jouets et à des jeux, par exemple.
Ne pas présupposer un adulte en miniature
De sorte que si l’on veut identifier les inégalités vécues par les enfants, il faut d’abord ne pas regarder ces derniers comme une prolongation de leur mère ou de leur père, ni comme un adulte en miniature. Il faut considérer leurs besoins propres et leurs relations subjectives avec le monde. Puis enfin trouver des outils pour arriver à saisir ces éléments, ce qui n’est pas toujours très simple !
Livre, goût, langue : trois exemples d’inégalités culturelles
Certaines contributions, dans ce recueil, semblent bien illustrer cette méthode…
En effet. 0n peut s’intéresser par exemple à l’article de Stéphane Bonnery (« Inégalités sociales, inégalités scolaires et littérature enfantine : lecture implicite et explicite »). Cet auteur montre que certains livres pour enfant – par exemple les albums de Claude Ponti – demandent ce qu’il appelle une « lecture implicite ». Cette lecture implicite suppose des références culturelles plutôt discriminantes, puisqu’elle implique que celui ou celle qui lit le livre à l’enfant ait appris cette gymnastique élaborée qui consiste non seulement à lire le texte, mais à identifier dans ce texte un autre texte (par exemple un conte bien connu dont le texte est une variation), non seulement regarder l’image mais aussi saisir son rapport au texte, et même son rapport à d’autres images. Bref, un niveau de lecture très élaboré qui, s’il est maîtrisé, permet ensuite d’affronter quasiment toutes les situations de décryptage de la vie (et pas seulement en matière de littérature) !
Et puis, en face de ce type d’album, il y a ceux qui mobilisent uniquement une lecture explicite, à un seul et premier degré. C’est par exemple les albums de Disney, assez plats, ou bien ceux de T’choupi. Typiquement, T’choupi vous explique comment aller vous coucher, mettre votre pyjama, vous brosser les dents, aller aux toilettes… c’est-à-dire qu’il enseigne à l’enfant, comment se conduire dans des situations très concrètes. Bien sûr c’est en ritualisant et traitant la chose avec humour, mais l’idée reste de discipliner l’enfant. C’est une part de l’éducation mais une part seulement, assez peu émancipatoire.
Alerter les parents sur l'importance de la lecture implicite
Or, Stéphane Bonnery montre très bien que personne n’évoque cette distinction lecture implicite/explicite, ni auprès des enfants, ni auprès des parents. Il n’y a pas d’accompagnement pour apprendre à lire de cette manière en famille et les familles font ce qu’elles savent faire : lecture implicite spontanée chez les uns et explicite chez les autres, ce qui fait que la seule mise en contact avec des textes requérant une lecture complexe ne suffit pas. Et comme les politiques culturelles de la lecture ne favorisent qu’implicitement, si j’ose dire, l’exercice de la lecture implicite, elles ne touchent que les familles qui en sont déjà averties…
Stéphane Bonnery, qui est professeur en sciences de l’éducation et qui, à ce titre, forme de futurs enseignants, alerte ainsi sur le fait qu’il faut signaler l’existence de ces deux types de lecture et y former les futurs enseignants, consciemment, sans quoi se reproduisent en permanence ce type d’inégalités entre ceux qui, pour le dire vite, pratiquent une lecture élaborée (apprennent à décrypter les sens à tous points de vue) et ceux qui n’expérimentent qu’une situation appauvrie, dont il n’est pas étonnant qu’ils puissent se désintéresser.
Rappelons l’enjeu : la lecture est l’un des loisirs culturels rentables scolairement. Par réussite scolaire, il ne faut pas entendre simplement « être un bon élève ». La culture, au sens de « culture générale », peut devenir discriminante, parce qu’elle produit des élèves qui ont une véritable aisance avec le langage, écrit comme oral, une forme d’aisance situationnelle qui leur permet de faire face à des expériences variées, y compris, auxquelles, a priori, ils ne connaissent pas grand-chose. Cette aptitude est donc très déterminante pour l’ensemble de la vie future.
Il y a aussi ce texte de Vincent Berry sur les jeux de sociétés…
Vincent Berry (« Une Bonne Paye, les enfants ? » La place du jeu de société dans les stratégies éducatives des familles ») identifie une dimension rarement étudiée : le goût. De nombreuses analyses insistent sur la transmission entre parents et enfants de diverses formes de capitaux (économiques, culturels, etc.). Ici, Vincent Berry met en évidence que cela ne suffit pas : un père ingénieur qui aime les jeux de sociétés n’a pas le même effet sur l’enfant qu’un père ingénieur qui ne les aime pas. Aussi simple que cela paraisse, c’est rarement évoqué. Or, il faut remettre en bonne place dans la réflexion sur les politiques culturelles l’idée qu’on ne transmet une pratique que si on l’aime soi-même. Les seules injonctions normatives ont de faibles effets en regard du goût (on transmet ce qu’on aime). Les enfants désirent généralement ce que les parents désirent… au moins jusqu’au moment où ils se rendent compte si cela est bon ou non pour eux.
Le plaisir, une valeur inutilement dépréciée
Or, les analyses peinent à faire prendre au sérieux cette valeur, qu’on attribue plutôt, à tort ou à raison, aux industries culturelles, en la dépréciant. On consommerait du divertissement par plaisir (cinéma, fictions audiovisuelles, musique numérisée…), et le plaisir serait vain, tandis qu’on irait vers les arts dits « légitimes » par recherche de connaissance et d’élévation intellectuelle, et cela aurait une forte rentabilité sociale.
Certains auteurs abordent la morale et même la politique…
Bertrand Geay (« De la socialisation familiale aux pratiques enfantines entre la naissance et 5 ans ») et Julie Pagis (« Quand le culturel construit le politique : le cas des représentations enfantines des Gilets jaunes ») montrent chacun à leur manière que selon le goût des enfants pour la culture, selon l’utilisation de certains médias plutôt que d’autres, ou selon la fréquentation de certains équipements culturels, l’enfant construit son rapport moral au monde et même son expérience du politique (au sens du vivre ensemble en société). Il y a du bien et du mal, du haut et du bas, du bon et du méchant, et l’enfant le perçoit très bien, à sa façon. Pas de meilleure apprentissage des rapports moraux qu’une partie de carte. Quant à regarder la télévision et chanter ensuite les chansons des Gilets jaunes comme on chanterait Barbe à papa, sans comprendre tout à fait de quoi il retourne, c’est déjà une initiation.
La parole, la morale et la politique au cœur des pratiques culturelles
Ainsi, ces deux études rendent aux pratiques culturelles leur sens éminemment politique ! Les pratiques culturelles, on ne le dit pas assez souvent, prennent part à la construction de la société, et leur choix commande un choix de société. C’est pourquoi elles sont dignes d’appartenir au débat politique.
D’autres chercheurs se sont intéressés au langage…
L’usage de la langue chez les enfants est bien sûr fondamental, comme tout ce qui relève de la culture au sens anthropologique du terme. La langue n’est pas seulement un outil de communication. Elle véhicule un « implicite culturel » qui a une importance considérable. Cela peut se jouer, chez l’enfant, le soir à la maison : qui a le droit de prendre la parole ? de quoi parle-t-on ? (voir l’article de Holly Hargis, « Parler à table. Une ethnographie en famille »). Et cela concerne au premier chef les politiques culturelles, car le langage est au cœur de tout ce qu’on peut construire culturellement (Marianne Woollven, Gaëlle Henri-Panabière, Olivier Vanhée, « Les langages de classe dans la petite enfance. Construction et effets des dispositions langagières d’enfants de grande section de maternelle »).
Peut-on tirer des préconisations de cet ensemble de travaux ?
Nous ne formulons pas de préconisations. Notre intention, ici, était surtout de déployer les inégalités culturelles de l’expérience enfantine dans leur plus grande variété. On a essayé de suivre les traces d’Annette Lareau [voir notre encadré] et d’ouvrir ainsi un champ d’investigation jusqu’ici peu visible ou du moins peu considéré. Si l’on prend au sérieux ces études, où les enseignements déterminants se trouvent logés parfois dans ce qui pourrait sembler être de menus détails, on s’aperçoit de la puissance considérable que peut receler la politique culturelle. Par ses effets, c’est elle qui tisse l’intégralité du champ social.
Un grand exemple : la chercheuse américaine Annette Lareau et le suivi longitudinal d’enfants et de leurs familles
« Les travaux d’Annette Lareau, nous explique Sylvie Octobre, au tournant des années 1990, l’ont engagée personnellement sur un suivi de plusieurs décennies avec une approche anthropologique qui l’a fait entrer dans les familles aux Etats-Unis. Dans des familles de diverses classes sociales et de diverses races, elle est parvenue dans la durée à les observer, en se faisant progressivement oublier, dans tous les moments banals de la vie quotidienne, depuis les repas, les jeux, les activités, jusqu’aux visites chez le médecin, etc.
« Elle montre très bien que la construction des inégalités se loge dans tous les actes du quotidien et par leur accumulation progressive. Elle a proposé un résultat inattendu aux Etats-Unis, où les inégalités raciales sont a priori considérées comme plus fortes que les inégalités sociales, en montrant que les proximités étaient grandes entre modes éducatifs des familles noires et blanches de classes supérieures, et entre modes d’éducation des familles noires et blanches pauvres. C’était un renversement de perspective.
« C’est pourquoi nous avons traduit un texte important d’Annette Lareau et l’avons placé en tête de ce recueil : Les inégalités invisibles. Classe sociale et « élevage » des enfants dans des familles noires et des familles blanches. C’est un texte passionnant qui expose l’originalité de sa méthode d’observation ainsi que les principaux résultats. L’approche d’Annette Lareau a inspiré de nombreux travaux ultérieurs mais ses écrits n’étaient jusqu’alors accessibles qu’en anglais.
« Les suivis longitudinaux de ce type s’opèrent aussi avec des méthodes quantitatives. Le ministère de la Culture, qui a commencé à faire des enquêtes spécifiques sur les enfants dans la décennie 2000-2010, participe ainsi au « suivi de cohorte national ELFE » depuis 2011, qui est la première cohorte française de naissance. Grâce aux études liées à ce suivi, on forge de vrais outils pour répondre aux questions fondamentales de la politique culturelle, et par exemple mesurer les effets de l’Education artistique et culturelle à court, moyen et long terme.
« Mais il faut être patient : les opportunités formidables qu’offrent ce suivi de cohorte demande d’attendre cependant que les enfants grandissent pour enrichir les observations ! »