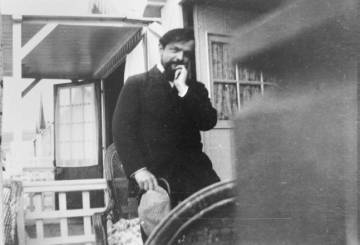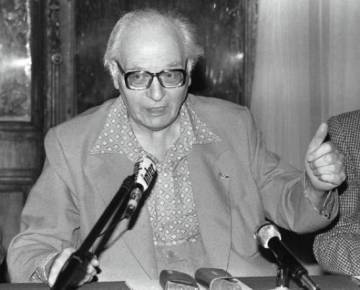Un cours d’eau qui ruisselle, le vent qui s’engouffre dans les arbres, le chant des oiseaux, le cri d’un animal… La vingtième édition des Rendez-vous aux jardins, qui se déroulent du 2 au 4 juin partout en France, met à l’honneur tous ces éléments qui forment la carte postale sonore de la nature. Cet événement invite aussi à la découverte de la richesse et de la variété des parcs et jardins, aux échanges entre visiteurs et propriétaires, jardiniers, paysagistes, botanistes, à la valorisation et la restauration de ces lieux et enfin à la transmission des savoir-faire.
De Jean-Baptiste Lully, musicien phare du Roi-Soleil au XVIIe siècle qui a illuminé le parc du Château de Versailles en composant la musique de la fête mémorable des Plaisirs de l’Ile Enchantée, à Franz Liszt et ses déambulations dans les jardins de la Villa d’Este sur les collines de Tivoli non loin de Rome en passant par des compositeurs contemporains comme François-Bernard Mâche, Bernard Fort, Aline Pénitot ou Florent Caron Darras qui enregistrent des sons au cœur de la nature, les jardins ont, de tout temps, inspiré nombre de compositeurs.
Le XXe siècle a notamment été prolifique en la matière avec quatre œuvres composées par John Cage, Debussy, Messiaen et Ravel, toutes s’inspirant des jardins, lieux propices à la rêverie et à l’imagination.
Claude Debussy, Jardins sous la pluie : de Java à la Normandie
Nous sommes en 1903. À cette époque, Claude Debussy apporte la dernière touche à son opéra Pelléas et Mélisande. Il passe la plupart de son temps en Bourgogne où il compose à cette époque La Mer, qui deviendra l’une de ses compositions orchestrales iconiques. Il entre alors dans une période de grande créativité, notamment pour le piano, et compose le triptyque Estampes, dont les sources d’inspiration empruntent tantôt à l’Orient, tantôt à l’Espagne. Un an plus tard, cette œuvre sera créée à Paris par son ami Ricardo Viñes. « Quel hasard, je lui ai dit que ces pièces me faisaient penser à des tableaux de Turner et il m’a répondu que précisément, avant de les composer, il avait passé un long moment dans la salle Turner, à Londres ! », relate le musicien dans son journal.
Après deux volets aux influences étrangères - Pagodes, hérité de la musique de Java et Bali que Debussy découvre lors de l’exposition universelle de Paris en 1889, et La Soirée dans Grenade – retour en France avec le troisième volet Jardins sous la pluie. Selon Henri Pellerin, historien du Pays d'Auge, c’est lors d’un séjour dans les jardins de l'hôtel de Croisy à Orbec dans le Calvados que Debussy compose ce morceau. Celui-ci transfigure musicalement des sons de la nature comme des gouttes de pluie ou le chant des oiseaux. Une véritable réussite, à laquelle il ajoute deux comptines enfantines populaires : « Nous n’irons plus au bois » et « Do do l’enfant dort ».
Maurice Ravel, Le Jardin féérique : l’apothéose d’un conte musical
Il est le sixième et dernier tableau de Ma mère l’Oye composé par Maurice Ravel en 1908. Le Jardin féerique est inspiré des Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault, mais aussi de ceux de la comtesse d’Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont. C’est donc un véritable continent enchanté, celui de la création pour le jeune public, que Ravel s’emploie à raviver en musique en le destinant à deux enfants : Jean et Marie Godebski. Le jardin féérique est l’apothéose de ce conte musical qui met en scène Laideronnette et Serpentin, une princesse et un prince victimes d’un sortilège qui se retrouvent, après bien des péripéties, à la fin de l’histoire libérés de leurs sorts respectifs. Les portes de ce jardin féérique, représentées par une série d’accords lumineux accompagnés de glissandi se referment, laissant imaginer une issue heureuse dans le parc d’un château somptueux où les héros vivront heureux très longtemps.
« Le dessein d’évoquer dans ces pièces la poésie de l’enfance m’a naturellement conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture », expliquait l’artiste. Le morceau a été écrit pour piano à quatre mains. Après sa composition, l’œuvre a été créée en 1910 à la salle Gaveau à Paris avant une version pour orchestre un an plus tard, elle-même enrichie pour devenir un ballet en 1912 dans lequel apparaît, dans le Jardin féerique, le réveil de la Belle au bois dormant, entourée par tous les autres personnages.
Olivier Messiaen, La fauvette des jardins : le chant d’oiseau comme matériau sonore
Pour Olivier Messiaen, les oiseaux étaient « les plus grands musiciens qui existent sur notre planète ». En 1970, le compositeur va passer quelques jours près du lac de Laffrey en Isère, au pied de la montagne du Grand Serre. Il y entend le chant de la fauvette, ainsi que de nombreux autres oiseaux (il en recensé pas moins de dix-huit, lors de ce voyage). Il décide de composer La Fauvette des jardins, une œuvre pour piano qui sera créée en 1972 à Paris à l'Espace Pierre Cardin et dédiée à la pianiste Yvonne Loriod.
Cette œuvre s’inscrit dans la technique d’écriture d’Olivier Messiaen depuis les années 40. « La reproduction du timbre des oiseaux m’a contraint à de constantes inventions d’accords, de sonorités, de combinaisons de sons et de complexes de sons qui aboutissent à un piano qui ne sonne pas "harmoniquement" comme les autres pianos », explique le compositeur qui annote ses partitions d’onomatopées et va même jusqu’à conseiller au pianiste de faire quelques balades en forêt pour découvrir les modèles. Outre les chants d’oiseau, Olivier Messiaen avait intégré à sa musique des sons de la nature : les chants d’insectes mais aussi les sons des éléments naturels comme l’eau ou le vent et quelques sons créés par les humains comme la sirène d’un phare.
John Cage, Ryoanji : le hasard fait musique
Quinze pierres placées au hasard sur une feuille de papier aux proportions équivalentes au jardin de pierres du temple Ryōan-ji (« Temple du repos du dragon »), à Kyoto. Dans cette série de dessins intitulée Where R=Ryoanji, on retrouve toute l’approche musicale de John Cage : le hasard, le Japon, l’indétermination, la virtuosité, l’accident. Et la musique expérimentale, donc. Quoi de plus profondément musical que le rythme, en effet ?
La série de dessins va s’accompagner d’une série de pièces musicales. La première est née d’une commande de l’hautboïste James Ostryniec. Très vite, Cage ajoute, entre 1983 et 1985, quatre autres compositions pour voix, flûte, contrebasse et trombone. Une dernière sera imaginée en 1992 pour une partie de violoncelle, mais ne sera jamais achevée.
Toutes ces pièces fonctionnent de la même manière que les dessins. « J’envisage le jardin ou l’espace dans lequel placer les quinze pierres comme quatre portées, ou deux pages – chacune avec deux portées. Et les portées sont en fait la surface du jardin », expliquait le compositeur. Chaque œuvre est composée de huit chansons (neuf pour la voix), chacune créée sur deux pages rectangulaires dans lesquelles John Cage a placé ses pierres - qui représentent le soliste – et tracé autour d’elles un périmètre. Cet arrangement aléatoire peut faire en sorte qu’à certains endroits, les contours se chevauchent, rendant ainsi les matériaux impossibles à jouer, auquel cas, le soliste est accompagné par un enregistrement sur bande pour jouer en duo ou en trio. Dans cette œuvre expérimentale de cette figure majeure de l’avant-garde musicale du XXe siècle, rien n’est figé et les sons évoluent de manière autonome.
Une 20e édition à l'écoute
des « musiques du jardin »
Chants d’oiseaux, cris d’animaux, tumulte des eaux, murmure du vent, bruissement des plantes... L’environnement sonore des jardins est le thème de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, vendredi 2 juin, samedi 3 et dimanche 4 juin. Les installations sonores contemporaines et la pratique des concerts jouées dans les kiosques à musique et les jardins seront également mises à l’honneur. À l’échelon européen, plus de vingt autres pays participeront à cet événement.
Chaque année, les Rendez-vous aux jardins offrent une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins en invitant le public à explorer la richesse et la variété de ces lieux. Certains ouvrent leurs portes pour des animations culturelles et pédagogiques avec des démonstrations, concerts, spectacles, expositions, ouvertures nocturnes...
Cette manifestation annuelle permet également de favoriser les échanges entre les visiteurs et les acteurs des jardins (propriétaires, jardiniers, paysagistes, botanistes…) et de valoriser les nombreuses actions mises en œuvre pour étudier, conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoirs et des savoir-faire.
Partager la page